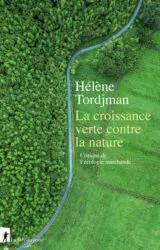Il y a déjà 50 ans, le rapport Meadows1 nous apprenait que notre trajectoire économique fondée sur une croissance débridée menait à l’effondrement. Sans surprise, le rapport fut qualifié de « catastrophiste » et une pléthore d’experts bien intentionnés se levèrent pour affirmer qu’un « développement durable » était possible. Face à l’urgence environnementale et climatique, le discours sur la croissance soutenable fait maintenant miroiter l’avènement d’une « économie verte ».
Or, la foi en l’accumulation infinie du capital s’oppose frontalement à la viabilité de l’écoumène et les preuves en ce sens ne cessent de s’accumuler. Parmi la mouvance vouée à faire tomber les masques, deux essais, l’un français et l’autre québécois, ont attiré notre attention.
La croissance verte, une croissance plus effrénée
Pour l’économiste française Hélène Tordjman, la plupart des solutions avancées par les promoteurs du verdissement de l’économie ne font que renforcer le modèle industriel à l’origine de nos problèmes environnementaux. Dans le cadre de ses cours et de ses recherches à l’Université Sorbonne Paris Nord, elle documente depuis plusieurs années, dans le détail, comment les propositions des grandes entreprises pour juguler la crise écologique ont avant tout pour effet d’accroître la marchandisation de notre monde et la maximisation des profits pour une minorité. Avec La croissance verte contre la nature2, l’économiste ajoute des arguments de poids en faveur d’une sortie du capitalisme.
Nourri à la surproduction et à la surconsommation, notre système socioéconomique pervertit toutes les sphères d’activité et de pensée. Hélène Tordjman ne prétend pas en couvrir tout le spectre, mais son essai vise à en donner une image à partir de deux points d’entrée, soit l’agriculture et les politiques environnementales. La chercheuse s’applique ainsi à dénoncer notamment l’instrumentalisation du vivant par la « bioéconomie », l’attribution d’une valeur monétaire au patrimoine naturel, de même que la prétention à la pureté écologique de certains secteurs financiers.
L’essai de Tordjman dénonce en premier lieu la « bioéconomie », ce programme dont les grandes institutions internationales font aujourd’hui la promotion et dont le but explicite est d’« augmenter la performance humaine ». En combinant les nanotechnologies, les biotechnologies, de même que les sciences de l’information et de la cognition, on serait bientôt en mesure de produire une espèce humaine améliorée, mieux à même de contrôler son environnement. Les promoteurs de cette orientation disent miser sur la complexité des interactions et, paradoxalement, croient pouvoir mettre au point des procédés prévisibles, en parfaite contradiction avec l’essence même des relations complexes, par définition imprévisibles. Dans le sillage de cette volonté de puissance, des industries s’emploient à assujettir les processus naturels aux impératifs économiques. « Dans les industries des biotechnologies, l’idée est d’exploiter et de détourner des mécanismes naturels comme la fermentation ou la photosynthèse pour leur faire servir des buts de production industrielle. La géo-ingénierie cherche quant à elle à peser sur les grandes interactions de la biosphère pour limiter le réchauffement climatique en déversant du fer et de l’urée dans les océans pour stimuler la croissance du phytoplancton, qui absorbe du CO2, en envoyant des nanoparticules de soufre dans l’atmosphère pour réfléchir le rayonnement solaire ou en fabriquant des plantes réfléchissantes pour jouer sur l’albédo. Quant aux conséquences adventices de ces manipulations, elles n’entrent pas en considération. » Autre exemple, les biocarburants, sur lesquels on mise pour remplacer les énergies fossiles et qui ont provoqué une ruée vers les terres arables en vue d’y multiplier les monocultures de plantes à carburant, au détriment des cultures vivrières, de la biodiversité et des populations.
Dans le discours économique dominant, une idée récurrente pour juguler la crise écologique consiste à donner une valeur monétaire à la nature afin de la protéger. « Dans le jargon des économistes, il s’agit d’internaliser les externalités environnementales, en faisant payer la pollution par exemple. » Cette vision a pris son essor dans la foulée de l’adoption de la Convention sur la diversité biologique, au Sommet de la Terre, à Rio de Janeiro, en 1992. Dans cette perspective, la biosphère est découpée en entités et en fonctions qui se transforment en « services écosystémiques » dont bénéficient les humains et auxquels on peut donner un prix. Il devient alors possible de réaliser leur valorisation dans divers mécanismes tels les « marchés du carbone » ou les « banques de biodiversité ». Nonobstant les problèmes méthodologiques insolubles soulevés par l’évaluation comparative des divers services rendus par la nature, l’approche est qualifiée de réductionniste et impérialiste par Tordjman. Réductionniste, parce que les interventions fondées sur une compartimentation de la nature ne tiennent pas compte des interdépendances complexes et encore méconnues à l’intérieur des écosystèmes et entre les écosystèmes. Impérialiste, parce qu’une telle vision considère tous les phénomènes naturels dans la seule optique d’en tirer des bénéfices pour les humains et, qui plus est, selon des catégories économiques et financières.
Dans le dernier chapitre de son essai, Tordjman discrédite complètement la redirection d’investissements vers les activités et les entreprises considérées comme écologiquement vertueuses. Elle y décortique le fonctionnement des indices boursiers dits « verts », mettant en lumière les imprécisions et les lacunes des critères pour y être admis. Selon l’autrice, le phénomène de la finance verte contribue surtout à verdir la réputation de certaines grandes firmes, alors que la majeure partie de leurs activités contribue toujours au réchauffement de la planète. Plutôt qu’une réelle solution aux problèmes environnementaux, la finance verte se révèle ainsi avant tout un élargissement de la sphère financière axée sur le profit à court terme.
Pour conclure son ouvrage sur une note plus optimiste, Tordjman dit vouloir « proposer quelques pistes de réflexion et d’action qui ne relèvent ni des high-techs ni du retour à la bougie ». Souscrivant à une idée générale qui semble faire de plus en plus d’adeptes dans divers milieux, l’économiste dit croire en la possibilité de saper progressivement les bases du capitalisme par la multiplication des expériences de nouvelles relations de production et de consommation, de même que par la mise en commun des leçons de ces expériences pour construire une nouvelle norme socioéconomique, davantage axée sur le bien commun.
En somme, si l’essai d’Hélène Tordjman n’est pas très réjouissant et si sa lecture peut s’avérer fastidieuse, son éclairage n’en est pas moins nécessaire.
Le capitalisme, réel obstacle à l’écologie
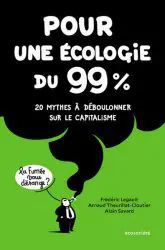 Pour une écologie du 99 %3 s’inscrit également dans un courant où l’on ose « poser la question qui dérange : celle de la sortie du capitalisme ». Ses auteurs sont tous trois spécialistes des théories sociales et politiques : Frédéric Legault enseigne la sociologie et termine une thèse sur l’économie post-capitaliste ; Arnaud Theurillat-Cloutier est doctorant en sociologie et enseigne la philosophie au collégial ; Alain Savard est docteur en sciences politiques et syndicaliste. L’ouvrage collectif, consciencieusement vulgarisé, vise manifestement un large public.
Pour une écologie du 99 %3 s’inscrit également dans un courant où l’on ose « poser la question qui dérange : celle de la sortie du capitalisme ». Ses auteurs sont tous trois spécialistes des théories sociales et politiques : Frédéric Legault enseigne la sociologie et termine une thèse sur l’économie post-capitaliste ; Arnaud Theurillat-Cloutier est doctorant en sociologie et enseigne la philosophie au collégial ; Alain Savard est docteur en sciences politiques et syndicaliste. L’ouvrage collectif, consciencieusement vulgarisé, vise manifestement un large public.
L’essai débute par une définition du capitalisme, suivie de vingt chapitres consacrés chacun à déconstruire une idée reçue quant aux solutions à l’urgence environnementale. Qualifiés de « mythes » ou de « fausses pistes », ces lieux communs sont critiqués notamment en mettant au jour leurs liens avec la contrainte structurelle, dans le système économique actuel, « à devoir réduire les coûts en polluant plus, à dégager du profit d’ici le prochain trimestre, à se démarquer de la concurrence ».
L’ensemble des fausses pistes examinées pourrait se répartir en trois thématiques : les mauvaises causes, les mauvaises solutions et le fatalisme. Parmi les mauvaises causes identifiées, on retrouve la culpabilité des consommateurs en raison de leurs mauvais comportements, la responsabilité des autres pays, la nature humaine égoïste et individualiste. Quant aux solutions illusoires, ou irréalistes, elles vont des nouvelles technologies salvatrices au rôle organisateur des médias sociaux, en passant par la transition énergétique et la solidarité au-delà des classes sociales. Enfin, le cadre fataliste inclut la peur d’une économie à la soviétique, la croyance dans le marché comme gage de liberté et le sentiment qu’il est trop tard pour une humanité qui court irrémédiablement à sa perte.
On remarquera que plusieurs thèmes recoupent les sujets couverts dans l’essai d’Hélène Tordjman, bien qu’ici les choses soient présentées dans une forme plus directe, à l’aide de descriptions plus facilement assimilables au vécu de la majorité. Chaque chapitre est en quelque sorte dynamisé par l’énoncé de questions appelant autant de réponses fondées dans le concret. Par exemple, au début du chapitre sur le marché du carbone, on trouve la question : « Donner un prix au carbone, n’est-ce donc pas une façon efficace de lutter contre les changements climatiques ? ». En réponse, les auteurs expliquent que la mesure revient à vendre aux entreprises le droit de polluer. Et puisque « le prix de la tonne d’équivalent CO2 est resté trop bas pour représenter une contrainte réelle pour les entreprises », la réduction des émissions de gaz à effet de serre due à cette solution demeure trop faible. Comme bien d’autres fausses pistes, les marchés du carbone représentent pour les auteurs un réel danger, car ils entretiennent l’illusion que les gouvernements agissent sérieusement pour contrer le réchauffement climatique.
Pour la démocratisation de l’économie
Tandis qu’Hélène Tordjman propose de s’atteler dès maintenant à la transformation en profondeur des systèmes agraires et alimentaires, Legault, Theurillat-Cloutier et Savard proposent en priorité de mettre un terme définitif à l’industrie des énergies fossiles. Les deux avenues sont assurément complémentaires, mais les auteurs de Pour une écologie du 99 % ont peut-être raison de dire qu’il faut d’abord parer au plus pressé et « éteindre le feu avant de reconstruire un nouvel habitat ».
Concernant le type de société qui pourrait advenir après le capitalisme, Pour une écologie du 99 % avance une idée à la fois simple et intellectuellement stimulante : la « planification démocratique de l’économie ». L’analyse du système économique dominant aujourd’hui montre que celui-ci induit un déficit de démocratie en octroyant un pouvoir démesuré à une minorité qui contrôle les moyens de production. De plus, la compétition entre grandes entreprises rend pratiquement impossible la coordination des activités économiques dans une direction plus écologique. Legault, Theurillat-Cloutier et Savard reprennent à leur compte l’hypothèse déjà explorée par quelques auteurs avant eux4, selon laquelle l’avènement d’un système plus démocratique, où les communautés seraient partie prenante aux décisions économiques qui les concernent, serait plus susceptible d’être orienté vers la satisfaction des besoins du plus grand nombre, en tenant compte des ressources limitées de la planète. La forme précise d’un tel type de société reste à concevoir et, évidemment, à soumettre au débat démocratique.
Les deux essais, bien que fort différents dans leur forme, l’un rédigé comme un long rapport de recherche, l’autre comme un cours pratique d’autodéfense intellectuelle, se rejoignent par ailleurs en proposant d’agir sur plusieurs fronts, toujours avec une large participation des communautés concernées. Plus explicite sur le plan de la stratégie, Pour une écologie du 99 % invite à investir simultanément « le front étatique, le front social (mouvements sociaux) et le front économique ».
On pourrait ajouter que rien n’est à négliger pour relever l’immense défi environnemental et économique d’aujourd’hui. Surtout pas les livres.
1. Publié en 1972 sous le titre Halte à la croissance ? Rapport sur les limites à la croissance,l’ouvrage a été l’objet de plusieurs rééditions, notamment au Québec : Dennis Meadows, Donella Meadows et Jørgen Randers, Les limites à la croissance, Écosociété, Montréal, 2013, 432 p. ; 34 $.
2. Hélène Tordjman, La croissance verte contre la nature. Critique de l’écologie marchande, La Découverte, Paris, 2021, 344 p. ; 34,95 $.
3. Frédéric Legault, Arnaud Theurillat-Cloutier et Alain Savard, Pour une écologie du 99 %. 20 mythes à déboulonner sur le capitalisme, Écosociété, Montréal, 2021, 208 p. ; 22 $.
4. Un des auteurs de Pour une écologie du 99 %, Frédéric Legault, est également cosignataire d’une note de recherche proposant une synthèse de modèles théoriques d’organisation sociale fondée sur une planification démocratique de l’économie : Frédéric Legault et Simon Tremblay-Pepin, « A brief sketch of three models of democratic economic planning », Centre de recherche sur les innovations et les transformations sociales – CRITS, Université Saint-Paul, 2021.
EXTRAITS
Nous déployons des prodiges d’ingéniosité technique pour « réparer » des écosystèmes et même la biosphère en intervenant encore plus massivement et agressivement dans la nature. Cela ne pourra qu’accentuer les destructions.
La croissance verte contre la nature, p. 7.
Dédier d’immenses surfaces de terres agricoles aux voitures qui nous asphyxient alors qu’une bonne partie de la population mondiale ne mange pas à sa faim est typique de l’aveuglement et du déni vis-à-vis des conséquences profondes de notre mode de développement et de notre incapacité à tirer les conclusions de bon sens qui devraient s’imposer.
La croissance verte contre la nature, p. 56.
Les choix institutionnels qui ont été faits ces dernières décennies et qui régissent nos rapports avec la nature reflètent la dynamique profonde du capitalisme contemporain, y compris dans ses aspects idéologiques.
La croissance verte contre la nature, p. 159.
[C]e n’est pas demain qu’on mettra fin à l’agriculture industrielle. Il faut néanmoins commencer dès aujourd’hui à entamer la transition vers une production et une consommation de nourriture plus saines pour tous, respectueuses des grands équilibres de la biosphère, plus harmonieuses, créatrices de travail, d’emplois et de beaux paysages.
La croissance verte contre la nature, p. 299.
Dans la logique capitaliste, la nature a une valeur lorsque les forêts sont abattues, les animaux morts, les plantes déracinées, les rivières harnachées, les montagnes éventrées, les sous-sols évidés.
Pour une écologie du 99 %, p. 23.
Dans l’économie capitaliste, toute opération doit être rentable, y compris la séquestration du carbone. Il faut donc pouvoir transformer ce carbone en marchandise à consommer. Climeworks revend par exemple du gaz carbonique pour les boissons de Coca-Cola. Il peut aussi servir à produire des carburants à faible émission (synthétique ou à base d’algues), ou être projeté dans les serres pour accélérer la croissance des plantes. Mais ces solutions n’éliminent pas le CO2 : elles ne font que le déplacer dans le temps.
Pour une écologie du 99 %, p. 62.
En cherchant à tout prix à rallier tout le monde et en fermant les yeux sur les réels intérêts en jeu, le mouvement pour la justice climatique risque de se mettre à genoux devant le capital. Après tout, la paix sociale n’existe qu’au son de la douce musique d’un centre d’achats.
Pour une écologie du 99 %, p. 99.
Le capitalisme ne représente qu’un hoquet sur l’ensemble de l’histoire. Il y a d’autres façons d’imaginer l’organisation économique des sociétés.
Pour une écologie du 99 %, p. 168.