Dans la nuit du 26 décembre 2018, un incendie a entièrement détruit la maison de Robert Lalonde. Sa conjointe et lui se sont retrouvés, comme au premier jour, seuls et nus dans la nuit. L’illustration qui apparaît en couverture de son dernier carnet évoque éloquemment la fureur des flammes dévastatrices.
Au-delà de la destruction, du sentiment immense de perte éprouvé à la suite de cet incident tragique, il faut surtout retenir la volonté et le courage de (se) reconstruire, ce que traduit le titre, La reconstruction du paradis1. Et, telle une promesse, l’aurore boréale qui nimbe le ciel.
Le lecteur est d’emblée frappé par le caractère syncopé des premières phrases, Lalonde cherchant à reprendre appui sur les mots pour émerger de sa torpeur, comme le nageur qui remonte à la surface après une immersion prolongée. L’appel d’air se fait sentir, entendre. Le sauvé des flammes, comme il se qualifiera plus loin en ces pages, a miraculeusement échappé au gouffre qui s’ouvrait sous ses pieds. Le ciel, hier menaçant, s’éclaircit à nouveau. Au fracas des vitres qui explosent sous la chaleur intense du brasier succède le chant des oiseaux d’un nouveau territoire. Dans l’entreprise de reconstruction qui s’amorce, deux figures accompagnent et soutiennent l’écrivain. En premier lieu, sa conjointe qui, comme lui, a échappé aux flammes et doit également tourner la page sur un éden disparu ; puis, un complice de toujours, Walt Whitman, qui lui souffle à l’oreille : « There are millions of suns left… À venir encore, des millions de soleils… ».
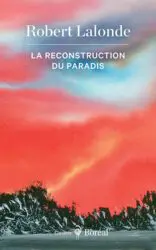 La reconstruction doit être tangible, palpable ; elle doit s’appuyer sur ce qui a été et y trouver écho, tout en permettant la venue de ce qui doit maintenant advenir. Un avenir plus que jamais possible, désiré, appelé de toutes leurs forces. Accompagné de Whitman et de tous les autres écrivains dont il s’est efforcé au fil des ans de déchiffrer les partitions, de maintenir, autant avec les disparus qu’avec ses pairs, une conversation sans fin, Lalonde annonce à sa conjointe, comme un charpentier qui vient de décider sur quel terrain il bâtira sa nouvelle maison, qu’il va traduire Whitman, tout Leaves of Grass. La vie peut reprendre, poursuivre son cours. L’embâcle est levé. L’écrivain reprend pied, retrouve son souffle, sa phrase s’accordant à nouveau à son pas impatient de vacarmeur.
La reconstruction doit être tangible, palpable ; elle doit s’appuyer sur ce qui a été et y trouver écho, tout en permettant la venue de ce qui doit maintenant advenir. Un avenir plus que jamais possible, désiré, appelé de toutes leurs forces. Accompagné de Whitman et de tous les autres écrivains dont il s’est efforcé au fil des ans de déchiffrer les partitions, de maintenir, autant avec les disparus qu’avec ses pairs, une conversation sans fin, Lalonde annonce à sa conjointe, comme un charpentier qui vient de décider sur quel terrain il bâtira sa nouvelle maison, qu’il va traduire Whitman, tout Leaves of Grass. La vie peut reprendre, poursuivre son cours. L’embâcle est levé. L’écrivain reprend pied, retrouve son souffle, sa phrase s’accordant à nouveau à son pas impatient de vacarmeur.
Bien sûr, reviennent les hanter les images de la maison détruite, calcinée, les odeurs de fumée asphyxiante, comme celles des souvenirs heureux. En l’espace d’une nuit, tout leur a été enlevé. Tout ce qui peut être arraché, brûlé, rasé, l’a été. L’ardoise d’une vie totalement effacée. D’abord les livres et tout ce qui témoigne du parcours d’une vie, mais également ce que recèlent les tiroirs, les armoires, les coffres, les cartons où s’entassaient pêle-mêle tout ce qui constitue le poids d’une vie. Poids rassurant parce que matériel, familier, apaisant. Mais voilà que Lalonde et sa conjointe prennent soudainement conscience qu’ils se trouvent désormais libérés de l’effrayante pesanteur des habitudes. L’occasion d’un nouvel élan leur est donnée, sans pour autant qu’ils aient à renier les différentes couches de vie qui se superposent, l’enfance, les années d’apprentissage, l’ancienne maison et les bonheurs qui y étaient engrangés, les livres écrits à ce jour. Tout le vécu d’une vie partie en fumée doit maintenant servir aux nouvelles fondations, à la construction du nouveau paradis qui leur permettra d’entreprendre le prochain tournant qui se présente à eux : « […] les années qui nous restaient seraient en accointance avec la nécessité d’une métamorphose qui déjà s’était pointée, mais à notre insu ».
Le lecteur familier des carnets de Robert Lalonde se retrouve rapidement en terrain connu, en territoire ami, pourrais-je dire. L’ombre de Colette n’est jamais loin, comme celle de Virginia Woolf, de Gabrielle Roy, de Giono, sans compter celle de Karen Blixen pour le partage des paradis perdus. En compagnie de Sylvain Tesson, il redécouvre la nécessaire patience pour pouvoir capter la beauté du monde qui se décline parfois en fugaces instants. À mesure que progresse la traduction de Leaves of Grass, les réflexions sur l’écriture, sur l’art de voir et de savoir percer la nature des choses et du monde, remontent à la surface et abondent tout en s’imprégnant des nouvelles expériences qui s’offrent à lui : « Écrire, c’est se ‘défixer’ et non se centrer, c’est aller voir ailleurs pour regarder en soi ».
Se profilent en ces pages le passage des saisons, le vol des busards et des outardes, le pistage des chevreuils qui observent les nouveaux arrivants et qu’à leur tour ils épient au crépuscule, l’ondoiement de hautes herbes caressées par le vent, l’éclat des monts enneigés à escalader, sans oublier celui du quotidien qui accueille à nouveau les rires d’enfant. Apprivoiser un lieu prend du temps, comme celui nécessaire à la connaissance du ciel, à la reconnaissance des diverses constellations qui s’y déploient. « Nommer n’est pas posséder, nous rappelle Lalonde, c’est connaître, reconnaître, c’est aimer, c’est célébrer. »
Au moment où s’achève le carnet, après nous avoir offert maints passages de Leaves of Grass, traduits avec la même liberté créatrice à laquelle l’auteur du Monde sur le flanc de la truite nous avait habitués, Lalonde et sa conjointe revoient fleurir avec une joie indicible les plantes qu’ils ont pu sauver des flammes. Autant est-ce pour eux un bonheur de voir leur jardin revivre à nouveau, autant c’en est un pour le lecteur d’assister à la reconstruction du paradis. « Le petit livre que vous êtes en train de lire ne célèbre pas autre chose que la menace et la splendeur. »
1. Robert Lalonde, La reconstruction du paradis, Boréal, Montréal, 2021, 182 p. ; 19,95 $.
EXTRAITS
Depuis plus de six mois, je vois un gouffre dans une égratignure. Alors j’écris. C’est ma façon à moi de respirer. Avant de respirer, on ne sait pas qu’on est dans un état d’asphyxie.
p. 12
À tout bout de champ, nous nous pinçons : le nouveau pays, la nouvelle maison, le plein été, les feux doux du couchant, à neuf heures du soir, le poudroiement des étoiles à minuit, les voltiges des oiseaux fuyant, incolores, dans la brunante, les chevreuils qui, par groupes entiers, nous épient à l’orée du bois.
p. 51
Il y a de ces matins où l’accord se fait spontanément entre nous, l’univers et moi.
p. 179
Tiens, ceci encore : il faut être prudent avec le feu ! Il attire, fascine, réchauffe et détruit. Il peut rendre fou…
p. 182











