Depuis 2010, à travers quatre livres et plusieurs fanzines, Maude Veilleux construit une œuvre bicéphale faite de poésie et de fiction, une œuvre cohérente qui interroge sans détour le quotidien, l’amour, la sexualité, la littérature et les manières de survivre au gouffre du monde qui menace sans cesse de nous avaler.
 Maude Veilleux est née en Beauce, parfois en 1986, parfois en 1987. Là-dessus, ses livres ne s’entendent pas. Le territoire fait toutefois consensus, la Beauce se retrouvant d’ailleurs dans ses poèmes et dans ses romans, la Beauce d’où « on [ne] revient peut-être pas » et que la poète essaie de transformer en « expérience » pour ne pas être « une autre fille de la rive-nord / dans une maison swell swell / où aucun enfant ne mange des cadavres de mouches » (Last call les murènes). La démarche autobiographique de l’auteure permet en outre de l’imaginer libraire, bisexuelle et écrivaine, grâce à des recoupements souvent vaseux faits entre des détails tirés de ses différents textes. Mais tout cela n’a que peu d’importance, finalement, puisque c’est l’œuvre qui nous intéresse ici et non pas son auteure, même si le flou artistique entretenu par le paratexte éditorial ainsi que les curieuses ressemblances entre les personnages et le « je » que Veilleux fait entendre piquent la curiosité. Dominic Tardif, dans Le Devoir, écrivait récemment, à propos du dernier livre de l’auteure, qu’il est « complètement, presque violemment, tyrannisé par l’idée de la vérité, quête à la fois chimérique, éternelle et hypercontemporaine1 » ; cette vérité appelle une certaine cruauté qui anéantit tout ce qu’elle touche et devant laquelle Veilleux ne s’incline définitivement pas.
Maude Veilleux est née en Beauce, parfois en 1986, parfois en 1987. Là-dessus, ses livres ne s’entendent pas. Le territoire fait toutefois consensus, la Beauce se retrouvant d’ailleurs dans ses poèmes et dans ses romans, la Beauce d’où « on [ne] revient peut-être pas » et que la poète essaie de transformer en « expérience » pour ne pas être « une autre fille de la rive-nord / dans une maison swell swell / où aucun enfant ne mange des cadavres de mouches » (Last call les murènes). La démarche autobiographique de l’auteure permet en outre de l’imaginer libraire, bisexuelle et écrivaine, grâce à des recoupements souvent vaseux faits entre des détails tirés de ses différents textes. Mais tout cela n’a que peu d’importance, finalement, puisque c’est l’œuvre qui nous intéresse ici et non pas son auteure, même si le flou artistique entretenu par le paratexte éditorial ainsi que les curieuses ressemblances entre les personnages et le « je » que Veilleux fait entendre piquent la curiosité. Dominic Tardif, dans Le Devoir, écrivait récemment, à propos du dernier livre de l’auteure, qu’il est « complètement, presque violemment, tyrannisé par l’idée de la vérité, quête à la fois chimérique, éternelle et hypercontemporaine1 » ; cette vérité appelle une certaine cruauté qui anéantit tout ce qu’elle touche et devant laquelle Veilleux ne s’incline définitivement pas.
Poésie
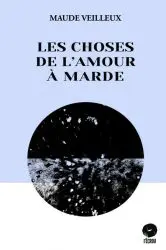 En 2013, après les fanzines Automne ton cul, Gros poèmes mauves, Les filles de la Beauce et Salon de l’ésotérisme de Mtl, réalisés pour la plupart en collaboration avec l’artiste Guillaume Adjutor Provost maintes fois évoqué dans l’ensemble de son œuvre, Veilleux publie Les choses de l’amour à marde, son premier livre, aux éditions de l’Écrou. L’Écrou, maison dirigée par Carl Bessette et Jean-Sébastien Larouche, c’est « la poésie qui serre la vis », « la bolt qui vous manquait2 » ; ce sont des livres crus, souvent près de l’oralité et du slam, autodistribués par l’éditeur ; une maison D.I.Y., donc, lo-fi, punk même, dans laquelle les poèmes de Veilleux ne détonnent pas. Les choses de l’amour à marde est à cet effet un titre programmatique qui annonce une poésie brute, boueuse, sans filtre, explorant l’amour et, surtout, ses échecs. La poète se révèle ainsi dans un devenir-écrivain signalé à de multiples reprises, notamment dès le premier vers qui place le recueil « à l’extérieur » du poème, dans le monde, là où la poésie peut naître et advenir : « C’était pas un poème / C’était pas un rêve / C’était à Woodstock en Beauce ». « Je découvre la fin de la magie », écrit-elle encore, « le début de l’ère adulte / Je hais ça. Chus triste ». Elle continue : « Je rêve du grand couteau, / j’espère le noir, / j’ai même pas peur de me faire fesser par un char / ou tuer par un junkie ». Son quotidien est triste et le récit qu’elle en fait est celui de l’amoureuse éconduite, enfoncée dans les souvenirs douloureux du corps de l’autre. Elle est « en amour avec un absent » et l’exprime d’une manière tout à fait décomplexée ; le désir sexuel est libéré des vieilles contraintes sociales et littéraires : du corps de l’autre, c’est « l’odeur de [l]a sueur » que la poète regrette d’avoir oubliée. Dans Les choses de l’amour à marde, la misère côtoie la drogue et l’alcool, les voitures bonnes pour la casse et le « temps lent » du quotidien dans une atmosphère qui n’est pas sans rappeler celle des chansons de Richard Desjardins ou des poèmes de Marjolaine Beauchamp.
En 2013, après les fanzines Automne ton cul, Gros poèmes mauves, Les filles de la Beauce et Salon de l’ésotérisme de Mtl, réalisés pour la plupart en collaboration avec l’artiste Guillaume Adjutor Provost maintes fois évoqué dans l’ensemble de son œuvre, Veilleux publie Les choses de l’amour à marde, son premier livre, aux éditions de l’Écrou. L’Écrou, maison dirigée par Carl Bessette et Jean-Sébastien Larouche, c’est « la poésie qui serre la vis », « la bolt qui vous manquait2 » ; ce sont des livres crus, souvent près de l’oralité et du slam, autodistribués par l’éditeur ; une maison D.I.Y., donc, lo-fi, punk même, dans laquelle les poèmes de Veilleux ne détonnent pas. Les choses de l’amour à marde est à cet effet un titre programmatique qui annonce une poésie brute, boueuse, sans filtre, explorant l’amour et, surtout, ses échecs. La poète se révèle ainsi dans un devenir-écrivain signalé à de multiples reprises, notamment dès le premier vers qui place le recueil « à l’extérieur » du poème, dans le monde, là où la poésie peut naître et advenir : « C’était pas un poème / C’était pas un rêve / C’était à Woodstock en Beauce ». « Je découvre la fin de la magie », écrit-elle encore, « le début de l’ère adulte / Je hais ça. Chus triste ». Elle continue : « Je rêve du grand couteau, / j’espère le noir, / j’ai même pas peur de me faire fesser par un char / ou tuer par un junkie ». Son quotidien est triste et le récit qu’elle en fait est celui de l’amoureuse éconduite, enfoncée dans les souvenirs douloureux du corps de l’autre. Elle est « en amour avec un absent » et l’exprime d’une manière tout à fait décomplexée ; le désir sexuel est libéré des vieilles contraintes sociales et littéraires : du corps de l’autre, c’est « l’odeur de [l]a sueur » que la poète regrette d’avoir oubliée. Dans Les choses de l’amour à marde, la misère côtoie la drogue et l’alcool, les voitures bonnes pour la casse et le « temps lent » du quotidien dans une atmosphère qui n’est pas sans rappeler celle des chansons de Richard Desjardins ou des poèmes de Marjolaine Beauchamp.

Le deuxième recueil de Maude Veilleux, Last call les murènes, paraît en 2016, toujours aux éditions de l’Écrou, et s’ouvre encore une fois sur une sorte de « dénudement du procédé » : « [J]e pensais faire un recueil sur la beauce / c’est ce que j’avais dit au calq / mais là, alexandre dostie l’a fini avant moi ». La poète continue d’explorer la mince ligne entre la beauté et la laideur : « [L]es mouches de l’année passée / sont encore sur le rebord des fenêtres / elles vont fondre à un moment donné / pis ça va faire une croûte noire / un lit de mort / pour les mouches de l’année d’après ». Ce faisant, elle délaisse un peu le registre alangui du premier recueil pour investir davantage les zones de colères, les endroits plus sombres de son âme toujours en détresse : « [J]’avais fait l’épicerie / je l’ai crissée dans le canal lachine // une femme pas gérable ». Toujours amoureuse, elle s’adresse directement à celui qu’elle désire : « [E]n vérité, je ne sais pas combien t’en as fourré des filles / je m’en crisse / je veux juste que tu me fourres / encore / une fois de temps en temps ». Entre Montréal et la Beauce, Maude Veilleux se met en scène dans des poèmes-brouillons, emblématiques de la confusion dans laquelle elle baigne, caressant sans cesse sa propre fin du monde : « [L]’hiver s’éternise / et, je me bats encore / pour pas lâcher / un toaster dans mon bain ». Aux portes du suicide, « au walmart de saint-georges-de-beauce », elle est « à deux / doigts d’être aussi laide que tout le monde » ; « les flaques d’eau du stationnement » lui renvoient la « vision très juste [d’]une adolescente attardée / pas de job pas de char pas d’enfant ».
Fiction
 Le vertige des insectes, premier roman de l’auteure, est paru chez Hamac en 2014. Il s’agit sans doute de ce que Maude Veilleux aura fait de plus « traditionnel ». Il ne faut toutefois pas entendre quelque sens péjoratif que ce soit à cet adjectif ; par là je pointe plutôt la « propreté » du roman, plus soigné que la poésie de Veilleux, et sa construction linéaire rassurante. Alors qu’elle arrive difficilement à faire le deuil de sa grand-mère, Mathilde perd son amoureuse ; Jeanne quitte leur appartement pour mener un stage au Yukon. Obsédée par son désir de mettre un enfant au monde, déroutée par l’ennui et la tristesse, Mathilde manipule alors son entourage en même temps qu’elle s’enfonce dans le malheur. Le roman, infusé des thèmes à venir et de ceux déjà présents dans l’œuvre, se permet la tragédie comme on le voit rarement. Pas de bons sentiments pour clore l’histoire, ici ; même si l’écriture du Vertige des insectes, toute en douceur et en précision, contraste avec la brutalité des poèmes parus à l’Écrou, la finale du roman glace le sang et coupe le souffle. Je n’en dirai pas plus.
Le vertige des insectes, premier roman de l’auteure, est paru chez Hamac en 2014. Il s’agit sans doute de ce que Maude Veilleux aura fait de plus « traditionnel ». Il ne faut toutefois pas entendre quelque sens péjoratif que ce soit à cet adjectif ; par là je pointe plutôt la « propreté » du roman, plus soigné que la poésie de Veilleux, et sa construction linéaire rassurante. Alors qu’elle arrive difficilement à faire le deuil de sa grand-mère, Mathilde perd son amoureuse ; Jeanne quitte leur appartement pour mener un stage au Yukon. Obsédée par son désir de mettre un enfant au monde, déroutée par l’ennui et la tristesse, Mathilde manipule alors son entourage en même temps qu’elle s’enfonce dans le malheur. Le roman, infusé des thèmes à venir et de ceux déjà présents dans l’œuvre, se permet la tragédie comme on le voit rarement. Pas de bons sentiments pour clore l’histoire, ici ; même si l’écriture du Vertige des insectes, toute en douceur et en précision, contraste avec la brutalité des poèmes parus à l’Écrou, la finale du roman glace le sang et coupe le souffle. Je n’en dirai pas plus.
 Prague, paru chez Hamac en 2016, confirme le talent de Maude Veilleux et l’écart qu’elle creuse entre une certaine littérature bien-pensante et sa production violente, intransigeante et hautement littéraire. Une scène de sodomie occupe la troisième page du livre et, très vite, le roman commence à se déconstruire, à s’écrire en même temps qu’il est vécu par la protagoniste, sorte d’avatar de l’auteure, parfois libraire, souvent saoule, désirante, amoureuse, confuse, désordonnée, qui veut être poète (« pas une femme poète »), qui veut aimer deux hommes à la fois, qui veut déconstruire la « vision assez binaire de la sexualité » qu’elle avait jusqu’alors. Elle tente l’expérience du couple ouvert et souhaite en faire un matériau littéraire : « Il fallait que je ramène mon expérience à la littérature, écrit-elle. Quand je terminais un bon paragraphe, peu importait ma peine, mon manque, ma culpabilité. Il y avait le texte. Le texte salvateur. Celui par lequel tout existe, même moi ». L’écriture devient donc pour la narratrice la « validation de l’expérience humaine » qu’elle éprouve avec son mari et son amant ; elle « subordonn[e] le désir à la littérature » et fabrique ainsi un tissu intertextuel subsumant le singulier (chacun de ses livres précédents) sous le roman que le lecteur tient entre ses mains, Prague, et qui oblige son auteure à « [s]e bousiller pour rendre l’histoire meilleure ». S’engage alors un combat entre la réalité et la littérature qui ne peut se solder par la victoire de l’un ou de l’autre, la seule issue étant la fusion la plus complète possible entre le sujet écrivant et son texte – autofiction, au sens ou Serge Doubrovsky l’entendait sans doute lors de l’écriture de Fils, dans les années 1970. Vérité, sincérité, intimité et censure sont convoquées, retournées, examinées et mises à profit dans cette œuvre brutale qui affirme, finalement, qu’aucun mensonge n’est possible et qu’il n’existe rien d’autre que la littérature. La profession de foi est sidérante et redoutable.
Prague, paru chez Hamac en 2016, confirme le talent de Maude Veilleux et l’écart qu’elle creuse entre une certaine littérature bien-pensante et sa production violente, intransigeante et hautement littéraire. Une scène de sodomie occupe la troisième page du livre et, très vite, le roman commence à se déconstruire, à s’écrire en même temps qu’il est vécu par la protagoniste, sorte d’avatar de l’auteure, parfois libraire, souvent saoule, désirante, amoureuse, confuse, désordonnée, qui veut être poète (« pas une femme poète »), qui veut aimer deux hommes à la fois, qui veut déconstruire la « vision assez binaire de la sexualité » qu’elle avait jusqu’alors. Elle tente l’expérience du couple ouvert et souhaite en faire un matériau littéraire : « Il fallait que je ramène mon expérience à la littérature, écrit-elle. Quand je terminais un bon paragraphe, peu importait ma peine, mon manque, ma culpabilité. Il y avait le texte. Le texte salvateur. Celui par lequel tout existe, même moi ». L’écriture devient donc pour la narratrice la « validation de l’expérience humaine » qu’elle éprouve avec son mari et son amant ; elle « subordonn[e] le désir à la littérature » et fabrique ainsi un tissu intertextuel subsumant le singulier (chacun de ses livres précédents) sous le roman que le lecteur tient entre ses mains, Prague, et qui oblige son auteure à « [s]e bousiller pour rendre l’histoire meilleure ». S’engage alors un combat entre la réalité et la littérature qui ne peut se solder par la victoire de l’un ou de l’autre, la seule issue étant la fusion la plus complète possible entre le sujet écrivant et son texte – autofiction, au sens ou Serge Doubrovsky l’entendait sans doute lors de l’écriture de Fils, dans les années 1970. Vérité, sincérité, intimité et censure sont convoquées, retournées, examinées et mises à profit dans cette œuvre brutale qui affirme, finalement, qu’aucun mensonge n’est possible et qu’il n’existe rien d’autre que la littérature. La profession de foi est sidérante et redoutable.
Avec audace
L’œuvre de Maude Veilleux n’en est qu’à ses balbutiements ; on le sait, puisque ces choses se sentent – elles se lisent à même le texte, à travers la dégaine et le cran des mots. Il y a, dans les quatre livres qu’elle a publiés en autant d’années, le germe d’une production artistique puissante qui défie le conventionnel, non seulement en présentant des univers extérieurs au couple hétéronormatif à propos duquel on glose depuis des millénaires, mais aussi en osant aborder avec sincérité et absoluité la dèche, l’adversité, l’amour en déglingue et les ruines du monde tout autour. Il faut lire Maude Veilleux avec sérieux, puisque c’est ainsi qu’elle envisage la littérature et sa toute-puissance : avec une soif absolue de transcendance.
1. Dominic Tardif, « Le roman comme acte de courage kamikaze », Le Devoir, 27 août 2016 [en ligne].
2. Site Web de l’éditeur, Les Éditions de l’Écrou [http://lecrou.com/].
EXTRAITS
Vomir dans le bain chez Bertrand Laverdure
Pour l’instant,
ce que j’ai fait de plus littéraire.
Les choses de l’amour à marde, p. 36.
je pense que je vais
scraper tous mes poèmes
je vais commencer un nouveau recueil
ça va s’appeler « jambon »
pis ça va juste parler de déjeuner
Last call les murènes, p. 68.
Elle pesa ses mots longuement, puis, dans un effort pour se libérer, elle lança :
– Je m’ennuie déjà. L’absence, c’est comme la mort.
Elle se revit, à peine une heure plus tôt, assise devant le réfrigérateur à pleurer sur un pot de sauce à spaghetti maison laissé par Jeanne – de la sauce que personne ne mangerait – et animée par la peur d’anéantir ce qui lui restait de son amoureuse si elle s’en débarrassait.
Le vertige des insectes, p. 57.
J’arrivais très bien à aimer deux hommes en même temps. J’avais mon mari et j’avais mon amant. Je ne sentais aucune culpabilité. Je ne mentais à aucun des deux, je gardais certains détails pour moi, mais je ne mentais pas. Mon amant me disait souvent : c’est impossible que ton mari ne soit pas jaloux.
J’adorais qu’il me dise cela. C’était le signe que ce que nous vivions avait de la valeur pour lui. Je lui répondais : il n’est pas du tout jaloux, ce n’est pas dans son caractère.
Prague, p. 27.











