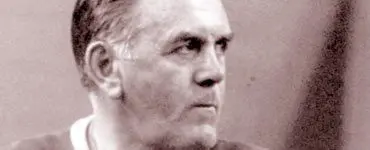Véritable symbole populaire, grand héros sportif, Maurice Richard a suscité, toute sa vie durant et depuis sa mort, un engouement jamais démenti. Les biographies s’accumulent, tant en français qu’en anglais, les livres hommages aussi, de même que les albums souvenirs et les films. Dans cette panoplie de titres, deux nouveaux bouquins se proposent d’analyser le mythe Maurice Richard, une façon d’affirmer que le hockey est intimement lié au discours national.
Les yeux de Maurice Richard1 de Benoît Melançon et Maurice Richard, Le mythe québécois aux 626 rondelles2 de Paul Daoust postulent en effet tous les deux la présence d’un mythe entourant le célèbre numéro 9 des Canadiens de Montréal. De prime abord, on pourrait croire que les deux ouvrages sont de la même eau et que les redondances abondent. Or, il n’en est rien, tant les visées, les moyens et les méthodes diffèrent entre l’histoire culturelle de Melançon et le plaidoyer sociopolitique de Daoust. D’un côté, une analyse discursive tente de déterminer la portée mythique du hockeyeur et son utilisation dans les discours culturel et littéraire, de l’autre, un portrait emphatique inscrit le mythe au cœur des exploits du Rocket. Entre les deux, un monde, celui de l’interprétation.
La figure Richard
Benoît Melançon insiste dès le départ sur le regard de Maurice Richard. Au-delà des qualités athlétiques de ce dernier prime un désir de vaincre : marquer des buts, c’est abattre l’adversité. Le regard de Richard indique bien une telle motivation, cette soif de scorer. Reconnu pour sa vitesse d’exécution et ses qualités autour des filets adverses, le Rocket a surtout un regard de feu, fait de force, de désir, d’acharnement. Ainsi, Melançon, après avoir déterminé les 12 travaux herculéens du numéro 9, s’intéresse au discours tenu sur le Rocket : ce dernier devient une icône parce qu’il est lu, vu, considéré comme une force de la nature, comme un être au désir vif, au caractère impulsif, au courage exemplaire. Son regard de feu n’est pas inné, mais serait une construction culturelle édifiée par les joueurs affrontés, les coéquipiers, les journalistes, les instructeurs, les partisans, les écrivains, etc. Melançon puise avec bonheur dans un large bassin de textes pour décrire le numéro 9. Il fait ressortir, dans un style concis, juste et maîtrisé, un portrait plus grand que nature du Rocket. Il montre l’entreprise commerciale qui amène Richard dans tous les foyers canadiens. Il souligne la portée mythologique de son surnom, après avoir pris soin d’en déterminer l’origine et les résonances symboliques. Richard, à travers les documents écrits et iconographiques (nombreux, magnifiques et éclairants) consultés, est présenté comme un homme silencieux, un taciturne qui s’exprime par son regard, ses exploits sur la glace et sa passion pour son sport. Son silence ouvre la porte aux commentateurs. Ceux-ci prennent le relais et sont les dépositaires des exploits du fougueux joueur. Les journalistes, les chansonniers et les écrivains deviennent alors les passeurs d’une histoire culturelle, celle de Maurice Richard. C’est cette transmission d’une génération à l’autre qui assure la portée du Rocket et sa permanence culturelle.
Paul Daoust s’y prend autrement : le mythe de Richard réside dans ses exploits (Daoust propose, quant à lui, quinze prouesses richardiennes), son caractère et son origine ethnique. Richard est talentueux, alerte, féroce et opportuniste sur la glace : il marque à un rythme jamais connu jusqu’alors. Il attire les foules par son jeu électrisant (description clichée, certes, mais totalement intégrée au mythe) et il fait des Canadiens de Montréal l’équipe la plus puissante de la Ligue nationale de hockey. Sa valeur, son instinct de marqueur et sa volonté proviennent d’un caractère courageux (ce qui nous vaut des pages et des pages pour défendre les gestes violents et agressifs du Rocket, actes qui font passer les Marty McSorley et autres Todd Bertuzzi de ce monde pour des anges : autre époque, autres mSurs, semble-t-il). Pour Paul Daoust, Richard est un mythe puisque le hockeyeur est un Canadien français qui a été plébiscité par la population, qu’il a su se défendre et prendre le dessus sur les anglophones, alors en position dominante. Le phénomène est donc toujours vu dans une optique québécoise : Richard incarne, aux yeux de Daoust, celui qui transmue la défaite des plaines d’Abraham en victoire, celui qui montre la voie aux Canadiens français et qui riposte aux agressions. Victime possible, Richard répond par l’insoumission et la révolte. Il devient ainsi un modèle pour la population, prête à se lever, qui attend seulement l’appel du sauveur.
L’émeute, moment clé du mythe
S’il y a un point commun entre ces deux livres, c’est assurément la place centrale accordée à l’émeute du 17 mars 1955, moment de contestation sociale et nationale à travers le sport. Par cet événement, Richard devient un symbole qui transcende son sport et incarne des valeurs collectives. Il étend sa domination à l’extérieur des cercles du hockey. L’émeute du Forum survient à la suite du jugement rendu par le président de la ligue Clarence Campbell qui suspend Richard pour les trois derniers matchs de la saison et les séries éliminatoires en raison de sa charge contre Hal Laycoe et un juge de ligne. Campbell, dans un geste qualifié de provocation, se rend au Forum le match suivant : une bombe lacrymogène est lancée, la partie est concédée à Detroit et la colère gagne la rue. L’émeute dure toute la nuit et s’y exprime l’injustice, considérée comme nationale, ressentie par la population. Pour André Laurendeau, Richard devient un Louis Riel contemporain : il est la victime de l’arbitraire anglo-saxon, et la réaction vive et furieuse de la foule indique qu’une telle injustice n’est plus permise. Cette émeute est fréquemment vue comme un moment précurseur de la Révolution tranquille.
Paul Daoust endosse totalement cette vision des événements : l’émeute est le temps premier de la Révolution tranquille, la colère de 1955 est nationaliste. Les Canadiens français, grâce à Richard, se lèvent pour s’opposer à leur domination. Le mythe de Maurice Richard s’affirme alors de façon explicite pour la première fois sous la plume d’André Laurendeau : le Canada français défait riposte par la figure de Richard, éveilleur de conscience sans le vouloir. Daoust, qui a trouvé la formulation du mythe chez le directeur du Devoir, ne dépasse jamais l’argumentaire énoncé en 1955. Le mythe est immuable. Richard représente une compensation : la douleur vive de la domination est suppléée par la victoire sportive, et lorsque ce dédommagement sportif est lui-même remis en cause, la colère explose. Dès lors, Richard n’est plus le « possesseur » du mythe, il appartient à la population, ce qui permet à Daoust d’expliquer la contradiction centrale de sa démonstration. En effet, les exploits de Richard rendent explicite la revalorisation d’une identité canadienne-française au détriment de son altérité anglo-saxonne. Or, les positions politiques conservatrices (Union nationale) et fédéralistes du Rocket contredisent la posture nationaliste (et péquiste) défendue par Daoust. En faisant passer la légende des exploits sportifs à la vindicte populaire, l’essayiste cherche surtout à ancrer son mythe sociopolitique et à défendre sa thèse nationaliste. Cependant, il ne parvient pas à dépasser le discours de Laurendeau, et son analyse minutieuse, mais bancale des journaux québécois de l’époque, région par région, ne nous aide pas à comprendre réellement la signification culturelle de Richard.
La démarche de Benoît Melançon est beaucoup plus fructueuse. L’émeute est pour lui le moment fort d’un discours soutenu sur la grandeur du Rocket. En analysant les journaux, tant du Québec que du Canada et des États-Unis (ce qui multiplie les perspectives et apporte de nouvelles dimensions au discours commun formulé à propos de l’émeute), en ouvrant son analyse aux publicités, aux objets, aux films, aux chansons, aux témoignages et aux œuvres littéraires de fiction, Melançon indique plus aisément d’où vient le récit mythique autour de Richard et comment l’émeute y joue un rôle central. Certes, l’émeute est au cœur de ce récit, l’événement qui lui donne son ampleur, et l’auteur des Yeux de Maurice Richard consacre au discours de l’émeute une section de son essai. Mais Melançon s’intéresse moins aux réactions immédiates et à la transcription journalistique d’une fureur passagère. Il privilégie plutôt une analyse, décennie par décennie, des discours qui mettent en scène ce moment crucial. Contrairement à ce qu’en dit Daoust, l’histoire culturelle est alors progressive et montre que rien n’est immuable, dans la représentation du mythe. Chaque époque, en fonction de ses intérêts et de son contexte énonciatif, propose une lecture singulière du personnage et de l’émeute déclenchée en son nom. Si, pour Daoust, la contradiction entre la position politique de Richard et la signification sociopolitique du mythe fait problème (parce qu’aucune médiation ne s’établit entre les exploits et l’interprétation de l’essayiste), Melançon, lui, montre comment, dans le temps, le mythe se déploie, par le recours à un récit qui conserve toujours des éléments récurrents, mais qui se transforme au gré des modifications sociales et s’adapte à son nouveau contexte.
Quel mythe Maurice Richard ?
Les deux essais ont donc pour objet un mythe qui n’est pas lu de la même façon. Benoît Melançon cherche à écrire une histoire culturelle du Québec à partir d’un mythe, celui du joueur de hockey Maurice Richard, icône québécoise importante qui transcende l’espace discursif depuis 60 ans. Richard lui permet de réfléchir sur la mémoire, sur la manière dont un objet culturel peut être interprété d’une génération à l’autre, les modifications même substantielles n’altérant pas la transmission. Melançon étudie la constitution du mythe et ses déplacements, qui sont nombreux et instructifs. En ce sens, il insiste sur la durée du mythe, sa fonction de transition, sur sa narrativité (le mythe est un « récit kamikaze » qui se modifie selon les besoins et s’appuie sur des éléments récurrents qui laissent suffisamment de place à l’interprétation). Sa démarche lui permet aussi de comparer la représentation de Richard en français et en anglais pour souligner la prégnance du mythe tant au Québec qu’au Canada : d’un côté, il est tout à tour légende sportive, figure de proue de l’éveil national des Canadiens français, modèle pour les jeunes (où sa violence est atténuée ou expurgée) ; de l’autre, il est un partisan de la rencontre des cultures, un exemple de volonté et de dépassement, un galvaniseur de foules, celui qui rassemble les deux solitudes, tout en sauvant par ses prouesses le sport national. Il faut souligner la richesse de l’interprétation de Melançon : non seulement met-il le mythe en perspective (culturelle et historique), mais il présente un fonds culturel important, des œuvres d’imagination qui reprennent à leur compte la figure de Richard pour réfléchir sur des questions contemporaines (identitaires ou sociales). En cela, Melançon nous fait découvrir la richesse du discours sur Richard et la façon dont nous transmettons, de génération en génération, des récits qui nourrissent l’imaginaire et créent des espaces de débats, même si cette entreprise bouscule un discours figé sur la portée de l’héritage compensatoire du Rocket.
Paul Daoust, quant à lui, demeure au cœur de ce mythe de la compensation, celui de la défaite historique transformée en gain sur la patinoire. En présentant longuement et platement une galerie de héros défaits (de Samuel de Champlain à Armand Lavergne – qui est-il donc ? – en passant par Henri Bourassa et autres martyrs canadiens-français de la cause nationale), Daoust s’inscrit dans une téléologie souverainiste figée et fait de Maurice Richard le sauveur d’un peuple. Il associe le Rocket à un discours du ressentiment, où toutes les injustices sont commises envers les Canadiens français. Dans son essai, Daoust fait de Richard un mythe québécois, le seul possible, parce que la rancœur en est la base. Toutes les occasions sont bonnes pour montrer la domination du Canada et pour souligner la nécessité du projet souverainiste. Richard devient alors une porte d’entrée pour expliciter les griefs de l’auteur (de la Loi sur les mesures de guerre aux commandites). Daoust participe de plain-pied à ce mythe, il ne l’analyse pas, il l’alimente, le nourrit et l’entretient pour qu’il demeure immuable et favorable à la quête d’affirmation des francophones. Avec ses renvois fréquents à « l’inconscient collectif », à ce « subconscient souterrain québécois », l’essai Maurice Richard, Le mythe québécois aux 626 rondelles tire inlassablement sur une seule ficelle, celle d’un « nous » à créer autour de la figure centrale et modélisée du Rocket, celui qui s’est tenu debout contre la malveillance du dominant. Ce qui explique, avec les répétitions et les multiples digressions historico-souverainistes inutiles, l’agacement soutenu et constant provoqué par cet essai marqué par le ressentiment.
Encore la nation, cette fois-ci consensuelle
En contrepoint à ces deux essais sur Maurice Richard, Michael McKinley propose une histoire du hockey canadien. Texte paru en traduction et initialement conçu comme un support historique à une télésérie sur le hockey présentée à la CBC, Hockey, La fierté d’un peuple3 est un compte rendu intéressant d’une passion vite qualifiée de nationale. Le bouquin cherche à valider la portée identitaire de ce sport, à en faire une image de la spécificité canadienne, un lieu de rassemblement des deux solitudes. Remplie d’une mine d’informations, d’anecdotes intéressantes, de témoignages de première main tirés des entrevues effectuées pour la série télévisée, l’histoire de McKinley est surtout un outil culturel qui sert à démontrer le poids identitaire du hockey au Canada. L’histoire collective est souvent lue à l’aune du hockey, véritable creuset de la collectivité, dont elle reprend le caractère. Sont alors célébrées les vertus associées à ce sport et transmises aux citoyens du pays : courage, vitesse, adaptation au froid, sens de la fête, soif de vaincre. Le hockey devient un miroir pour affirmer qu’un ciment collectif lie les partisans.
À la manière d’un Ken Burns qui a consacré une télésérie et un livre à l’histoire du baseball4 dans une perspective étatsunienne pour en faire une vertu civique, Michael McKinley traque les moments charnières du hockey pour chanter les prouesses d’inventifs citoyens qui ont offert au monde un sport intense, heureux mélange d’élégance, de vitesse et de force. C’est du moins en ce sens qu’il faut lire les digressions nombreuses autour d’équipes amateures sillonnant l’Europe, apportant les joies du hockey, des clubs universitaires, des missionnaires de ce sport, des légendes culturelles plus importantes hors glace que sur la patinoire comme Tim Horton. Sans aucun doute, la perspective adoptée permet de constater la vigueur de l’attachement à ce jeu, de même que son imbrication dans le développement du pays. Le hockey est ainsi un héritage culturel qui se transmet de génération en génération, grâce à de grands héros sportifs qui ont galvanisé les foules et marqué les mémoires. Ainsi, la description de Maurice Richard montre bien comment ce joueur fut à la fois un héros sportif canadien, un athlète spectaculaire qui charmait les foules partout sur son passage et une légende canadienne-française. En ce sens, la lecture de McKinley, sur ce point, entérine la position de Benoît Melançon.
Toutefois, en se centrant sur la construction d’une référence identitaire appréciée des Canadiens à travers le sport national, McKinley se concentre sur le Canadien et les Maple Leafs, seules équipes du pays pendant une longue période, au détriment des autres formations de la Ligue nationale de hockey. Ce choix, conséquent avec la perspective nationale adoptée, laisse un peu de côté les multiples interactions entre le Canada et les États-Unis dans la construction du hockey. En effet, nombre d’initiatives proviennent des voisins du Sud (professionnalisme, parties télévisées, etc.), ce qui montre l’imbrication continuelle entre ces entités nationales.
Le hockey n’est pas uniquement un jeu qui s’exerce hors des frontières du monde social, dans une enceinte protégée des vicissitudes de la nation. Au contraire, des discours sociaux, culturels et identitaires traversent ce sport. Ceux-ci sont alimentés par les journaux, les compagnies, les médias, les partisans, les écrivains, les politiciens, et ils construisent des représentations culturelles fortes et endossées par de multiples personnes. Le mythe du Rocket est exemplaire à cet égard et il souligne la force du discours sur le hockey et la dimension culturelle des pratiques sportives.
*Après avoir complété un mémoire de maîtrise sur Luis Sepulveda et Victor-Lévy Beaulieu à l’Université du Québec à Montréal, Michel Nareau poursuit actuellement des études doctorales à la même université.
Il s’intéresse aux rapports entre littérature et baseball dans les Amériques selon une perspective identitaire. Il a déjà participé à des colloques au Québec, au Canada et au Brésil. Depuis 2004, il est également secrétaire à la rédaction de la revue de littérature québécoise Voix et Images.
1. Benoît Melançon, Les yeux de Maurice Richard, Fides, Montréal, 2006, 279 p. ; 29,95 $.
2. Paul Daoust, Maurice Richard, Le mythe québécois aux 626 rondelles, Trois-Pistoles, Trois-Pistoles, 2006, 302 p. ; 27,95 $.
3. Michael McKinley, Hockey, La fierté d’un peuple, Fides, 2006, Montréal, 344 p. ; 59,95 $.
4. Ken Burns et Geoffrey C. Ward, Baseball, An Illustrated History, Alfred A. Knopf, New York, 1994, 483 p.
EXTRAITS
En matière de mythe, il y aurait eu, dans un premier temps, à la fin des années 1950, rapprochement et éloignement. Rapprochement : Maurice Richard est un homme comme les autres, un familier. Éloignement : Maurice Richard aurait été un joueur différent des autres, une légende, peut-être un mythe. Dans un deuxième temps, durant les années 1970, Richard aurait été transformé en un être hors du commun sur beaucoup de plans : personnage mythique pour de plus en plus de gens, incarnation de la nation pour la plupart.
Les yeux de Maurice Richard, p. 200.
Comme Richard s’illustre contre des Anglais au point de les surpasser tous, le Canadien français finit par voir en ce héros celui qui lui fait oublier sa condition d’infériorité, de Canadien français « pepsi ». J’ignore comment s’effectue ce passage de l’individuel au collectif, de la rêverie particulière à l’imprégnation dans le subconscient collectif.
Maurice Richard, Le mythe québécois aux 626 rondelles, p. 48.
La société canadienne-française des années 40 [sic] souffrait de sa condition. Il fallait trouver quelqu’un à qui imputer ce mal et quelqu’un pour la venger de cet immense malaise. Le mal fut imputé à l’Anglais et Richard fut choisi comme héros-vengeur avec d’autant plus de facilité qu’il était presque toujours vainqueur contre eux.
Maurice Richard, Le mythe québécois aux 626 rondelles, p. 284.
Des personnalités respectées du monde de la culture ont vu dans cette soirée de hockey l’un des événements fondateurs de la Révolution tranquille au Québec. Richard au cœur d’une émeute allait orienter dans un certain sens la pensée politique au Québec, dévoilant du coup le lien très fort entre le hockey et la psyché canadienne.
La bataille fut déclenchée par l’affrontement d’une idole francophone, Maurice Richard, et du président anglophone de la LNH, Clarence Campbell, chargé d’un symbolisme culturel incendiaire. Une idole canadienne-française issue de la classe ouvrière, un homme passionné avait à plusieurs reprises affronté Dieu lui-même dans la LNH : Clarence Campbell, formé à Oxford, et dont la parole faisait loi.
Hockey, La fierté d’un peuple, p. 147.