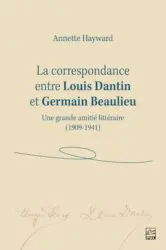La connaissance qu’on a de Louis Dantin se limite ordinairement au fait qu’il a réuni les poèmes d’Émile Nelligan et qu’on lui doit ainsi d’avoir permis à un jeune homme trop tôt écarté de la vie littéraire et de la vie sociale d’exister ; quant à Germain Beaulieu, son correspondant pendant une trentaine d’années, cofondateur de l’École littéraire de Montréal et entomologiste de talent, estimé du frère Marie-Victorin, il appartient à la liste de ceux dont l’histoire n’a pas retenu le nom.
Ce déficit de notoriété est désormais corrigé par la parution, par les soins d’Annette Hayward (Université Queen’s), de La correspondance entre Louis Dantin et Germain Beaulieu. Une grande amitié littéraire (1909-1941)1. Ouvrage incomplet, dans la mesure où les lettres de Beaulieu sont absentes de la première partie du livre, c’est-à-dire avant 1920, mais fort utile en raison de l’éclairage que les 174 lettres nous étant parvenues jettent néanmoins sur le début du XXe siècle.
Étrangement, on s’habitue à la position pour ainsi dire de soliste de Dantin, vu le vide consécutif à la perte de onze ans de lettres de son correspondant. À la lecture, l’effet rappelle La voix humaine de Cocteau, une partition qui permet presque de deviner ce qui se dit à l’autre bout, grâce au travail de reconstitution des pièces perdues auquel se livre la professeure Hayward dans d’essentielles notes infrapaginales. De toute façon, sa substantielle introduction (120 pages) avait au préalable reconstitué le cadre de la vie intellectuelle de leur époque et permis d’aller plus loin que les idées reçues auxquelles trop souvent on se limite pour tout ce qui précède le manifeste artistique Refus global, voire la Révolution tranquille. Les revues abondent, souvent éphémères, toujours précaires. Les motifs de discussions, de débats, de différends et de querelles ne manquent pas : la langue, le régionalisme, la morale, l’instruction.
Et la censure. Oui, elle existe, Mgr Paul Bruchési, archevêque de Montréal de 1897 à 1939, s’avérant un digne successeur de Mgr Ignace Bourget, figure centrale de l’ultramontanisme du siècle précédent. Comme on le sait, les procédés d’interdiction (ce qu’il ne faut pas faire), par le canal de lettres apostoliques, de mandements lus en chaire et de congédiements, s’accompagnent de prescriptions (ce qu’il faut faire quand on écrit de la poésie, du théâtre, des textes d’opinion ou des romans). À cet égard, on prônait à Montréal à peu près la même chose que Mgr Camille Roy à Québec, avec des effets de cape peut-être plus spectaculaires, ce qu’on résumera par la sujétion de l’esthétique à des impératifs religieux, à savoir catholiques de la plus stricte obédience. Anecdote : Alfred DesRochers refuse l’exemplaire des Confessions de Rousseau que lui offre Dantin, vu que le livre est à l’index. La passion, pièce de Beaulieu, lui dont on avait pourtant loué les qualités « aussi artistiques qu’édifiantes et réconfortantes », se heurte à l’interdit de Mgr Bruchési. Les cas de cette sorte sont légion. La veine de prédilection de Beaulieu ayant été la satire, on devine que sa vie professionnelle a été mouvementée. Ses adversaires et ses ennemis ne portaient pas tous la soutane, ce qui finit par faire pas mal de monde. Ce qui explique aussi en partie qu’on ait oublié son œuvre : quand les références se perdent, la lame de ce genre s’émousse.
Parmi les dommages que cause la censure figure l’autocensure. Dantin en reconnaît la présence dans ses contributions à l’hebdomadaire Le Jour, alors dirigé par Jean-Charles Harvey, pourtant l’un des esprits les plus libres de son temps : « On ne me défend pas d’exprimer mes idées, mais quand je les vois si contraires aux principes, à la rédaction du journal, j’y mets de moi-même une sourdine ». On sait que Harvey sera par la suite lui-même immolé par la censure.
Montréal et Boston
La dimension factuelle (grandeurs et misères de la littérature québécoise d’il y a un siècle…) n’est pas tout : d’abord peu familiers l’un avec l’autre, Dantin et Beaulieu deviendront des amis au sens fort et noble du terme grâce, et seulement grâce, à leurs échanges épistolaires. À certains moments, le récit des misères de l’un et de l’autre, hautement mélodramatique, semble avoir été écrit par un émule d’Hector Malot. À la fin, toutefois, les deux hommes se livreront à une réflexion non seulement sur leur vie, leur sort (Beaulieu, né dans un dénuement extrême, perd graduellement la vue), mais sur la vie elle-même. De grands passages sur le mysticisme et l’occultisme, tous deux exempts d’attaches religieuses, mettent en évidence un caractère fondamental de l’amitié : Beaulieu, que ces questions fascinent, se sent autorisé à en parler même si Dantin avoue tôt se sentir trop blasé, revenu de tout pour vraiment s’y intéresser, sans pour autant cesser d’être attentif au propos. Il admire d’ailleurs le désir de Beaulieu de « découvrir des éléments cachés, des lois secrètes derrière les phénomènes ».
D’un bout à l’autre, ils commenceront leurs missives en s’excusant de n’avoir pas répondu plus vite, ce qui finit par devenir un agaçant incipit obligé, mais on se dit alors que la vérité de l’exercice épistolaire ne va pas sans ces appels à la consolation que cela signifie aussi (auxquels le destinataire répond toujours). Il faut cependant noter, sur la foi de la correspondance entre Liliane Beaulieu, qui a servi de secrétaire et de lectrice à son père quand il a été frappé de cécité, et Gabriel Nadeau, premier biographe de Dantin, que celui-ci avait quelques secrets pour son ami. Sous ce rapport, Beaulieu paraît plus limpide.
Les deux hommes ne se rencontreront qu’une fois, et dans des circonstances horribles. Après être venu à Montréal afin de faire la paix avec sa famille, Dantin, né Eugène Seers, retournera dans son exil bostonien (il travaille comme typographe aux Presses de l’Université Harvard), la correspondance avec Beaulieu et d’autres écrivains restant son seul lien avec le pays qui l’avait vu naître et qu’il avait dû quitter dans l’opprobre : père du Très-Saint-Sacrement, il avait traversé à la fin de la vingtaine une crise sentimentale et religieuse. Défroquer n’était pas précisément au goût du jour. Non plus que vivre en concubinage. Qu’un homme de cette stature intellectuelle soit exclu de la scène aurait été catastrophique, ce qui serait arrivé n’eût été la main patiemment tendue par Beaulieu.
D’une certaine manière, la polarité Boston-Montréal fait le sel de leur correspondance. D’un côté, un observateur extérieur, éloigné, pétri de silence, commentant à froid les ouvrages qu’on lui envoie et cherchant, en vain, à intéresser les écrivains québécois à Walt Whitman, à la littérature des États-Unis et à notre commune américanité – ce qui en fait un lointain prédécesseur de Pierre Nepveu et de Pierre Hébert, auteur d’une biographie de Seers/Dantin ; de l’autre, un homme qui mettait la main à la pâte, dans des revues et la vie associative, au péril de ses emplois et de sa sécurité économique. En somme, Dantin observait à distance sur la base d’informations de première main.
La mêlée générale
Les acteurs de la scène littéraire, souvent collaborateurs à plus d’une revue, utilisaient à foison des pseudonymes. Passer de Seers à Dantin (l’auteur a utilisé d’autres noms) marque l’écart entre l’homme d’avant, le prêtre défroqué, le fils réprouvé, d’une part, et l’homme de lettres, d’autre part. Chez les écrivains et critiques, leur utilité varie : parfois, ils réussissent à faire illusion quant à l’identité réelle de celui qui se cache derrière ; il arrive aussi que le procédé n’abuse personne. On peut toutefois se demander si, en soi, au-delà de la coupure voulue par Dantin en raison de sa vie exécrable, il n’y aurait pas dans cet usage généralisé une affirmation dont nom de plume témoigne : écrire, dans un milieu où la littérature, historiquement, ne va pas de soi, n’exigerait-il pas qu’on se rebaptise soi-même ?
Le plus célèbre pseudonyme de ces années-là est sans doute Valdombre, dont Claude-Henri Grignon signait ses écrits polémiques. En voilà un qui avait la dent dure. De nombreuses pages sont consacrées à l’horreur qu’a inspirée à Beaulieu l’accusation (mais était-elle plutôt le fait d’Olivar Asselin ?), copieusement relayée par Valdombre, selon laquelle Dantin était le réel auteur des poèmes de Nelligan. Détail éclairant : à l’origine, Beaulieu ignorait qu’« un certain typographe, bohème, ivrogne à ses heures, poète aux heures des autres » désignait son ami et, s’il s’est objecté, c’est au nom de la probité de l’École littéraire de Montréal et de l’intégrité d’un homme devenu incapable de se défendre, ce qui ajoute au drame2. Cela dit, de tous ces bretteurs, c’est Claude-Henri Grignon qui s’est imposé le plus durablement dans la mémoire collective, en raison essentiellement de son roman Un homme et son péché (1933), auquel les deux correspondants ne font d’ailleurs jamais allusion, et des multiples produits dérivés que la radio, le cinéma et la télévision en ont tiré.
Même si Dantin exhortait son touche-à-tout d’ami à publier ses textes (poésie, satires, essais, romans, nouvelles), pour l’essentiel la timidité de Beaulieu a prévalu. Il faut dire que la vie littéraire de l’époque était rythmée, on l’a compris, par la profusion critique au regard du nombre d’œuvres publiées. Les uns et les autres écrivaient (surtout de la poésie), se lisaient, se commentaient, se louangeaient, se pourfendaient, se démolissaient. Les amitiés se faisaient et se défaisaient. Pareil climat est aujourd’hui inimaginable, les tribunes critiques s’étant dégarnies et réduites comme peau de chagrin.
Il faut savoir gré à des presses universitaires, ici les PUL, de considérer qu’il leur incombe de faire paraître de tels livres, davantage destinés à la recherche qu’à la lecture courante, à l’historiographie qu’à l’exploration de l’intimité, qu’au dévoilement de deux âmes que permet le genre épistolaire, encore que la dernière partie de l’ouvrage justifie le sous-titre, Une grande amitié littéraire. Nous voilà plus riches de connaissances sur les Jean Bruchési, Albert Pelletier, Charles Gill, Jean Charbonneau, Albert Ferland, Albert Laberge, Louvigny de Montigny et autres figures actives d’un monde révolu.
1. Annette Hayward, La correspondance entre Louis Dantin et Germain Beaulieu. Une grande amitié littéraire (1909-1941), Presses de l’Université Laval, Québec, 2023, 548 p.
2. Le motif a été repris il y a dix ans par Yvette Francoli, Le naufragé du vaisseau d’or. Les vies secrètes de Louis Dantin, Del Busso, Montréal, 2013, 448 p.
EXTRAITS
Plutôt être brisé sous les ruines des ambitions brisées et des affections mortes que de n’avoir jamais senti l’étreinte des grands désirs et des grandes passions. La souffrance est par elle-même une noblesse : elle est la seule science de la vie, et tous ceux qui ne la connaissent pas restent étrangers au grand mystère.
Louis Dantin, p. 141.
À quoi servirait une École littéraire, si elle n’aidait chacun des membres à se corriger de ses insuffisances et de ses défauts ?
Louis Dantin, p. 157.
Je subis le fait d’être sceptique comme celui d’être pauvre ou malade, sans pouvoir rien y changer.
Louis Dantin, p. 164.
Votre amitié a été plus grande que vos fatigues.
Germain Beaulieu, p. 283.
J’espère ne pas mourir avant d’avoir lu la reculade des dictatures et le reflux des masses vers le sens de leur dignité et de leur liberté. Autrement, il faudrait juger le genre humain destiné à tourner en cercle et se plaisant à reprendre les plus horribles jougs du passé.
Louis Dantin, p. 395.
Grignon, à qui j’ai reconnu du talent, beaucoup de talent, quand il avait vingt ans, n’est plus qu’un grotesque bouffon.
Germain Beaulieu, p. 398.
Le Canadien français ressemble à ces avortons qui sont des vieillards à vingt ans.
Germain Beaulieu, p. 492.
Dieu n’existe et ne peut exister que par la science occulte, et son existence est indéniable parce qu’elle devient nécessaire.
Germain Beaulieu, p. 453.
Je ne suis pas jeune. Je voudrais l’être… Ce qui est pis, je n’ai jamais eu de jeunesse : ma vie s’est passée toute à la recherche d’idéals austères dont le mirage s’est lentement évanoui, me laissant enfin désenchanté, seul avec moi-même, et vieux avant d’avoir vécu.
Louis Dantin, p. 131.