Sexe, drogue et rock and roll. La formule est usée, mais ô combien ancrée dans l’imaginaire populaire, surtout lorsqu’il s’agit d’évoquer cette aube libertaire qui se lève au Québec avec la fin des années 1960. Au-delà des poncifs, que sait-on vraiment de la contreculture ?
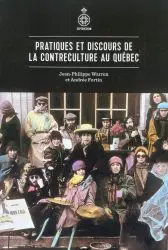 En 2013, à l’occasion d’un entretien mené par le sociologue Jean-Philippe Warren pour le compte de la revue Liberté, lequel titre sans ambages « Terra incognita », Karim Larose avance que les années 1970 demeurent au Québec « le parent pauvre de l’histoire des arts et de la culture1 ». Deux ans plus tard, le message a été entendu : le même Warren cosigne avec Andrée Fortin Pratiques et discours de la contreculture2, un ouvrage de synthèse qui enrichit la compréhension de cette période à la fois bouillonnante et méconnue. Ni genèse à proprement dit ni histoire au sens chronologique du terme, le tableau qu’ils brossent de l’époque vise plutôt à mettre en lumière les diverses incarnations d’une réalité multifacette.
En 2013, à l’occasion d’un entretien mené par le sociologue Jean-Philippe Warren pour le compte de la revue Liberté, lequel titre sans ambages « Terra incognita », Karim Larose avance que les années 1970 demeurent au Québec « le parent pauvre de l’histoire des arts et de la culture1 ». Deux ans plus tard, le message a été entendu : le même Warren cosigne avec Andrée Fortin Pratiques et discours de la contreculture2, un ouvrage de synthèse qui enrichit la compréhension de cette période à la fois bouillonnante et méconnue. Ni genèse à proprement dit ni histoire au sens chronologique du terme, le tableau qu’ils brossent de l’époque vise plutôt à mettre en lumière les diverses incarnations d’une réalité multifacette.
Un temps pour la révolte
Phénomène de portée mondiale propre à l’économie des pays postindustriels, la contreculture entre au Québec par la porte américaine. Le néologisme apparaît d’ailleurs en 1969, sous la plume de Theodore Roszak, dans son livre intitulé The Making of a Counter Culture. La génération psychédélique voit progressivement le jour en pleine guerre du Vietnam, au moment où les draft dodgers, ces déserteurs de l’armée américaine, envahissent les quartiers du ghetto McGill, le Haight-Ashbury montréalais. Ils répandent avec eux leurs idées subversives, qui trouvent une oreille attentive chez les étudiants des environs, puisque l’allongement de la jeunesse, phénomène nouveau provoqué par la poursuite d’études supérieures et le report du mariage, est en quelque sorte une incitation supplémentaire à refaire le monde.

L’abondance des années 1965-1975 favorise non seulement l’émergence d’une société de loisirs, mais aussi un climat marqué d’une certaine insouciance quant à l’avenir. Le taux de chômage est bas, les perspectives d’emploi semblent ne jamais manquer et le salaire minimum garantit un niveau de vie appréciable. Les tenants de l’improductivité de la « bof génération3 » peuvent ainsi s’épanouir librement sans avoir à en éprouver trop durement les contrecoups financiers, ce qui explique en partie leur désintérêt pour les luttes syndicales ou socialistes.
La grande foire ou comment refaire le monde en ne faisant rien
Sorte d’« apolitisme militant4 », la contreculture se veut avant toute chose une posture existentielle adoptée en réaction à la société bourgeoise dont une bonne partie de la faune hippie est par ailleurs issue. Plusieurs avenues s’offrent à la jeunesse pour s’affranchir des valeurs de la classe moyenne. Si le triptyque sexe, drogue et rock and roll s’avère réducteur en sous-estimant l’étendue des manifestations contreculturelles, il n’en est pas moins fondé. La musique est sans contredit l’outil le plus important d’une expérience à la fois individuelle et tribale du monde. La diffusion du rock bénéficie à la même époque de l’avènement du microsillon, et la sortie de l’album Sgt. Pepper’s des Beatles marque un précédent, tandis que Janis Joplin, Robert Charlebois ou Grateful Dead trônent au haut du palmarès musical des freaks.
La drogue offre quant à elle aux hippies une connexion directe à leur corps et à leur esprit, décuple leur sensibilité et provoque une euphorie libératoire qui se veut un pied de nez à la rationalité aliénante de la société. La dissociation entre sexualité et procréation est également à mettre au compte de cette quête de libération et de plaisirs inédits. Forme de contestation de la famille traditionnelle, de l’institution du mariage et de la morale judéo-chrétienne, l’amour libre vise à briser les interdits qui dépossèdent tant les hommes que les femmes de leur propre corps. Jouissance et liberté sont désormais les nouveaux mots d’ordre d’une révolution qui est avant tout intime et privée.
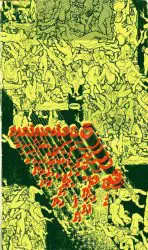
Ces pratiques et les discours qui les sous-tendent profiteront de l’effloraison de publications underground, dont l’ouvrage offre un riche panorama, pour contribuer à les propager. Il n’est qu’à penser à des réussites telles que Mainmise, qui au plus fort de son existence est tirée à près de 26 000 exemplaires, pour nous convaincre de leur importance. Pendant plus de huit ans (1970-1978), la revue aborde des sujets aussi divers que le féminisme, l’homosexualité, l’écologie et l’éducation alternative.
Les paradoxes de la pensée freak
Quiconque tente une définition stricto sensu de la contreculture s’avance sur une pente savonneuse. L’une des raisons tient à ce qu’elle évoque des influences disparates et des pratiques qui le sont tout autant. À tel point que Warren et Fortin, à la suite d’autres observateurs, en viennent à suggérer de recourir à la forme plurielle : les contrecultures. Loin d’être unifiée donc, la philosophie hédoniste des freaks récupère tout un cortège de propositions hétéroclites, parfois même contradictoires. Pour une bonne part, c’est la dissection méticuleuse de ces paradoxes de la pensée libertaire qui retient les auteurs dans leur essai.
Les hippies vont par exemple prêcher le retour à la nature, jugée plus authentique, comme l’alimentation biologique, tout en étant fascinés par les avancées de la cybernétique et les plaisirs de la télévision. Ils insistent sur la liberté de l’individu, remis au centre de toutes les préoccupations, en même temps qu’ils souhaitent fonder un modèle de vie alternatif basé sur le bien-être communautaire. À ce titre, le développement de communes, qu’elles soient rurales ou urbaines, illustre peut-être de la meilleure façon le profond clivage séparant le discours de son application concrète. Plusieurs tentatives de vie en groupe virent effectivement à l’anarchie, les uns se dédouanant de leurs responsabilités à l’égard des travaux ménagers au nom de leur sacro-sainte liberté, les autres reproduisant littéralement les rapports de domination et le partage sexué des tâches. Aussi, n’est pas Euchariste Moisan qui veut et l’épreuve du réel n’épargne pas non plus l’utopie du retour à la terre, qui se solde dans la plupart des cas par un échec lamentable. Est-ce à dire que la contreculture disparaît du paysage québécois avec ses derniers grands idéaux ?
Que reste-t-il de nos amours (libres) ?
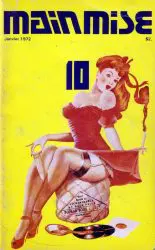 Comme toute fête, la contreculture s’étiole lentement après avoir battu son plein. Seuls demeurent quelques irréductibles qui à l’usure rejoindront eux aussi les rangs serrés de la « bonne » société. À long terme, la position marginale semble tout simplement intenable. Le contexte économique florissant qu’était celui du début des années 1970 cède à un climat d’incertitude. Peu à peu, des pratiques qui ont pu paraître anticonformistes aux yeux de la majorité sont ravalées par la culture de consommation mainstream. Si bien qu’aujourd’hui, de nombreux legs de cette époque, au rang desquels le rock, la marijuana et l’alimentation bio, prennent place dans notre quotidien sans que nous le soupçonnions. Victime de son succès, la contreculture s’est érigée au goût du jour et certains de ses aspects ont été institutionnalisés : les groupes écologiques, les coopératives d’habitation ou les relations sexuelles libres en sont tous un héritage direct.
Comme toute fête, la contreculture s’étiole lentement après avoir battu son plein. Seuls demeurent quelques irréductibles qui à l’usure rejoindront eux aussi les rangs serrés de la « bonne » société. À long terme, la position marginale semble tout simplement intenable. Le contexte économique florissant qu’était celui du début des années 1970 cède à un climat d’incertitude. Peu à peu, des pratiques qui ont pu paraître anticonformistes aux yeux de la majorité sont ravalées par la culture de consommation mainstream. Si bien qu’aujourd’hui, de nombreux legs de cette époque, au rang desquels le rock, la marijuana et l’alimentation bio, prennent place dans notre quotidien sans que nous le soupçonnions. Victime de son succès, la contreculture s’est érigée au goût du jour et certains de ses aspects ont été institutionnalisés : les groupes écologiques, les coopératives d’habitation ou les relations sexuelles libres en sont tous un héritage direct.
Plusieurs facettes de cette période restent certainement à creuser, que l’essai de Warren et Fortin, deux sociologues au long cours, laissent volontairement en plan. S’ils explorent rapidement les arts de la scène, les performances d’artistes et de troupes telles que L’Enfant fort et Le Grand Cirque ordinaire, le corpus littéraire plus particulièrement romanesque est mis de côté. Il faut dire que le travail accompli est déjà considérable. Les auteurs ont fouillé une panoplie de périodiques, de revues, de documents audiovisuels, rassemblé les thèses, articles et monographies éparses, en plus d’avoir mené quantité d’entretiens auprès de freaks défroqués pour parvenir à nous offrir ce tour d’horizon synoptique qui en appellera d’autres à sa suite. En fait, un engouement pour la contreculture semble déjà retenir l’attention des chercheurs universitaires : en octobre dernier, un colloque international ayant pour titre « Contre-culture : existences et persistances » a été tenu à Montréal ; un collectif sous la direction de Karim Larose vient également de paraître. Nul doute que ce n’est qu’un début.
1. Karim Larose, propos recueillis par Jean-Philippe Warren, « Terra incognita », Liberté, n° 299, 2013, p. 14.
2. Jean-Philippe Warren et Andrée Fortin, Pratiques et discours de la contreculture au Québec, Septentrion, Québec, 2015, 244 p. ; 24,95 $.
3. Pratiques et discours de la contreculture au Québec, p. 151.
4. Ibid., p. 45.
EXTRAITS
Celui ou celle qui s’habille avec des chemises fleuries, laisse pousser ses cheveux, consomme de la drogue, travaille à la pige ou passe ses journées à ne rien faire incarne, par son mode de vie, son refus de la société libérale.
p. 44
Une fois dépassées les images d’Épinal véhiculées dans le grand public par le triptyque du sex, drugs and rockn’roll, on s’aperçoit en effet que la contreculture englobe un univers au sein duquel les opinions les plus disparates s’entrechoquent et qu’il n’est pas toujours facile de faire tenir ensemble les mondialistes et les régionalistes, les politisés et les décrocheurs, les artistes d’avant-garde et les partisans du retour à la terre ou, plus généralement les « purs » de la contreculture et les simples tripeux.
p. 61
Par ailleurs, la contreculture n’échappe pas à un autre versant de la culture populaire, celui de la culture de masse. Les hippies consomment une certaine culture standardisée quand ils s’habillent des mêmes vêtements, arborent la même coupe de cheveux et la même barbe, écoutent les mêmes albums ou laissent se glisser dans leur vocabulaire des expressions communes à l’ensemble de la jeunesse nord-américaine. […] Des habitudes de consommation marginales sont désormais mainstream et s’institutionnalisent.
p. 230
Plusieurs des utopies de cette époque ont en effet été réalisées dans les années suivantes : des garderies coopératives, des cours d’éducation permanente, des coopératives d’habitation, des centres d’information pour le consommateur, des pistes cyclables, des services de recyclage des déchets, des aliments biologiques, des salles de loisirs, des événements artistiques sur tout le territoire du Québec.
p. 239











