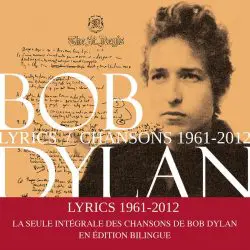Bob Dylan s’est vu décerner le prix Nobel de littérature le 13 octobre 2016, « pour avoir créé de nouvelles expressions poétiques dans la grande tradition de la chanson américaine1». On pourrait croire que l’Académie suédoise récompensait davantage le parolier et le chansonnier que le chanteur ou le musicien, ou que la création l’emportait sur la performance ; mais en fait, toutes ces composantes – paroles, musiques, chants et sonorités – forment un tout indissociable.
Cette annonce créait un précédent : Dylan est le premier auteur-compositeur américain à recevoir ce prix littéraire, le plus prestigieux d’entre tous, habituellement réservé à des écrivains. Parmi les lauréats précédents du Nobel de littérature, on trouve la Biélorusse Svetlana Alexievitch, le Français Patrick Modiano, la Canadienne Alice Munro, mais aussi au siècle précédent des écrivains au style plus hermétique, privilégiant les phrases sans fin, comme Claude Simon ou encore Camilo José Cela.
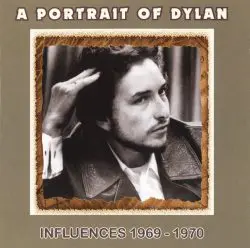 Cette reconnaissance littéraire accordée à un artiste n’ayant pas écrit plus de cinq livres (si on écarte les partitions, les catalogues d’art et les livres reproduisant ses toiles) a déclenché des félicitations et des approbations de tous horizons, mais a également occasionné des remous et des jalousies. Des objections sont venues par exemple de la part de l’écrivain Pierre Assouline, de l’académie Goncourt, et d’Alain Finkielkraut, qui contestaient le statut de la chanson au sein de la catégorie de la littérature2. Cette désapprobation perpétuait l’éternel débat entre « haute culture » et culture de masse, à laquelle sont associées la musique populaire et les expressions traditionnelles. D’autres commentateurs ont reproché à Dylan d’avoir tardé à réagir à sa nomination3. Quelle ironie pour celui qui a écrit tant de chansons de protestation (« protest songs ») ! Car c’est la poésie musicale de Dylan qui a été récompensée : plusieurs centaines de chansons créées et enregistrées sur un demi-siècle, et reprises par plus de mille artistes dans des versions et des traductions en tous genres. Lors de la réception de son prix, Bob Dylan a prononcé un discours, fidèle à la tradition, discours enregistré aux États-Unis et par la suite publié dans plusieurs langues, dont le français. Certains commentateurs l’ont alors accusé d’avoir plagié des passages d’un site Web analysant certaines des œuvres littéraires qu’il mentionne dans son discours4.
Cette reconnaissance littéraire accordée à un artiste n’ayant pas écrit plus de cinq livres (si on écarte les partitions, les catalogues d’art et les livres reproduisant ses toiles) a déclenché des félicitations et des approbations de tous horizons, mais a également occasionné des remous et des jalousies. Des objections sont venues par exemple de la part de l’écrivain Pierre Assouline, de l’académie Goncourt, et d’Alain Finkielkraut, qui contestaient le statut de la chanson au sein de la catégorie de la littérature2. Cette désapprobation perpétuait l’éternel débat entre « haute culture » et culture de masse, à laquelle sont associées la musique populaire et les expressions traditionnelles. D’autres commentateurs ont reproché à Dylan d’avoir tardé à réagir à sa nomination3. Quelle ironie pour celui qui a écrit tant de chansons de protestation (« protest songs ») ! Car c’est la poésie musicale de Dylan qui a été récompensée : plusieurs centaines de chansons créées et enregistrées sur un demi-siècle, et reprises par plus de mille artistes dans des versions et des traductions en tous genres. Lors de la réception de son prix, Bob Dylan a prononcé un discours, fidèle à la tradition, discours enregistré aux États-Unis et par la suite publié dans plusieurs langues, dont le français. Certains commentateurs l’ont alors accusé d’avoir plagié des passages d’un site Web analysant certaines des œuvres littéraires qu’il mentionne dans son discours4.
L’œuvre de Bob Dylan est immense et contient plusieurs centaines de chansons de contestation, de revendication ou d’amour. Lorsque paraît son premier 33 tours intitulé simplement Bob Dylan (1962), enregistré en deux journées de novembre 1961, le jeune Robert Zimmerman n’a que vingt ans et ne se doute aucunement qu’il deviendra l’auteur-compositeur le plus influent des États-Unis. Il a su puiser aux sources des musiques populaires émergeant de tous les styles : folklore, blues, country, musique sacrée et surtout rock. Au terme de sa sixième décennie de production artistique, Bob Dylan a enregistré une quarantaine de disques, mais si on ajoute ses concerts endisqués, les compilations et les archives de ses enregistrements inédits (The Bootleg Series), on dépasse la centaine de disques. Et le chanteur se produit régulièrement sur scène encore en 2018.
Trois livres des éditions Fayard peuvent aider à comprendre pourquoi Dylan méritait le Nobel, les raisons de ses réticences à le réclamer et le caractère exceptionnel de son œuvre littéraire.
Le discours de Bob Dylan à l’Académie suédoise
Dans son discours paru chez Fayard en 20175, Dylan explique sa vocation d’artiste de la chanson et commence son exposé par un souvenir de jeunesse : un spectacle du légendaire Buddy Holly. Ce point de départ axé sur un pionnier du rock contraste avec beaucoup de déclarations dans lesquelles le jeune Dylan plaçait le chansonnier folk Woody Guthrie au sommet de ses inspirations. Le discours ajoute plusieurs influences littéraires : L’Odyssée, Don Quichotte, Moby Dick, Shakespeare, ou encore le roman d’Erich Maria Remarque, À l’Ouest rien de nouveau. Dylan explique aussi la façon dont il conçoit son art : « Si une chanson vous émeut, c’est tout ce qui compte. Je n’ai pas besoin de savoir ce que veut dire une chanson. J’ai écrit toutes sortes de choses dans mes chansons. Et je ne vais pas m’en soucier – de savoir ce que tout ça signifie ».
Ce bref exposé met entre autres en évidence le passage entre la culture populaire dans laquelle le jeune Dylan était plongé (Buddy Holly, les romans populaires qu’il a étudiés à l’école primaire) et sa découverte des cultures alternatives et des musiques traditionnelles, notamment dans le réseau des étiquettes indépendantes comme Folkways, qui lui font découvrir un autre monde, loin de la culture de masse et du mainstream. À propos du disque du chanteur afro-américain Leadbelly paru chez une compagnie indépendante, il déclare : « Il était sorti sur un label dont je n’avais jamais entendu parler – dans la pochette, une brochure faisait la promotion d’autres artistes du label : Sonny Terry et Brownie McGhee, les New Lost City Ramblers, Jean Ritchie, des string bands ».
La traduction de Nicolas Richard semblera très parisienne pour le lecteur non hexagonal (par exemple : « Défourailler puis remettre le flingue dans ta poche »). Mais ne boudons pas notre plaisir. On sent chez Dylan une authentique volonté de partager des dizaines de références à des créateurs obscurs mais inspirants. En attirant l’attention sur ces artistes ayant vécu la pauvreté, le racisme, ou n’ayant pas connu la reconnaissance méritée, Dylan rejoint en d’autres mots l’hommage fait par Albert Camus dans son magnifique Discours de Suède, au moment de recevoir la même distinction : « […] je voudrais la recevoir comme un hommage rendu à tous ceux qui, partageant le même combat, n’en ont reçu aucun privilège, mais ont connu au contraire malheur et persécution6».
L’œuvre de Bob Dylan
Mais revenons aux chansons. D’un format équivalant à une pile de 33 tours, le livre Lyrics/Chansons 1961-20127 contient l’intégrale des compositions endisquées depuis « Talkin’ New York » et « Song to Woody », enregistrées sur son premier disque sorti en 1962.
Cette édition bilingue est indispensable au lecteur non anglophone, non seulement pour mesurer l’ampleur et la profondeur des paroles des chansons qui couvrent parfois plusieurs pages (« I Shall Be Free », « Hurricane », « Joey », « Jokerman », « Highlands »), mais également pour saisir les nuances et le sens de certaines expressions idiomatiques ou à double sens. En outre, les traducteurs Robert Louit, Didier Pemerle et Jean-Luc Piningre ont pris soin de préciser dans leurs notes – toujours pertinentes – les allusions aux chansons d’autres artistes et à des personnages mythiques comme John Wesley Harding (en réalité : Hardin’) : « un célèbre hors-la-loi du Texas » qui a inspiré un western à Raoul Walsh et une chanson à Dylan. Ailleurs, dans la chanson « Changing of the Guards » (« Relève de la garde »), Dylan évoque les dog soldiers, surnom donné à certains guerriers cheyennes ; une traduction littérale sans contextualisation n’aurait pas suffi à préciser la portée historique de cette expression issue du XIXe siècle.
Une édition uniquement en français (sans les textes originaux) ne serait pas aussi pertinente ; c’est précisément en ayant la possibilité de comparer les deux versions par une lecture en parallèle sur une même page que cette édition prend tout son sens. Mais ici encore, il faut rappeler que les chansons ne sont pas de prime abord faites pour être lues isolément ; leur musicalité, leur sonorité, le phrasé et la performance de l’interprète (de Dylan lui-même ou d’autres) donnent un amalgame et une structure qui dépassent la simple écriture.
Il faut relire les chroniques de Bob Dylan
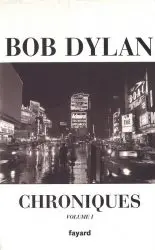 On se demande encore pourquoi Bob Dylan était si réticent à recevoir le Nobel, et pourquoi il a tant tardé avant d’accepter officiellement son prix. Une esquisse de réponse se trouve sans doute dans son livre Chroniques8, sorte d’autobiographie partielle en quatre moments, rédigée en 2004, bien avant la décision de l’Académie suédoise. Lors de la réception d’un doctorat honorifique de l’Université de Princeton, le 9 juin 1970, Bob Dylan s’était senti catalogué, réduit à un stéréotype, à une caricature de lui-même ; les institutions semblaient lui imposer une image artificielle et une mission qu’il n’avait jamais revendiquées, particulièrement au moment où le maître de cérémonie avait présenté le nouveau docteur à l’assemblée en mentionnant son âge (indiscrétion suprême que Dylan ne supportait pas) : « […]il approche du cap difficile des trente ans, cependant il demeure l’expression authentique de la conscience perturbée et inquiète de la jeune Amérique ». C’est vraisemblablement pour éviter de telles dérives et ne plus réentendre de telles proclamations infondées que Dylan refuse souvent ce genre d’honneur ou les accepte à la condition que ce soit sans la présence de journalistes ou de photographes, comme il l’avait exigé pour un doctorat d’honneur de l’UQAM. Dans ses mémoires rédigés en 2004, Dylan s’explique longuement sur sa désillusion à propos de son premier doctorat d’honneur : « La conscience perturbée de la jeune Amérique ! Ça recommençait. Je n’arrivais pas à le croire. Je m’étais encore fait avoir. Il [le présentateur] aurait pu aborder toutes sortes de choses, attirer au moins l’attention sur ma musique ».
On se demande encore pourquoi Bob Dylan était si réticent à recevoir le Nobel, et pourquoi il a tant tardé avant d’accepter officiellement son prix. Une esquisse de réponse se trouve sans doute dans son livre Chroniques8, sorte d’autobiographie partielle en quatre moments, rédigée en 2004, bien avant la décision de l’Académie suédoise. Lors de la réception d’un doctorat honorifique de l’Université de Princeton, le 9 juin 1970, Bob Dylan s’était senti catalogué, réduit à un stéréotype, à une caricature de lui-même ; les institutions semblaient lui imposer une image artificielle et une mission qu’il n’avait jamais revendiquées, particulièrement au moment où le maître de cérémonie avait présenté le nouveau docteur à l’assemblée en mentionnant son âge (indiscrétion suprême que Dylan ne supportait pas) : « […]il approche du cap difficile des trente ans, cependant il demeure l’expression authentique de la conscience perturbée et inquiète de la jeune Amérique ». C’est vraisemblablement pour éviter de telles dérives et ne plus réentendre de telles proclamations infondées que Dylan refuse souvent ce genre d’honneur ou les accepte à la condition que ce soit sans la présence de journalistes ou de photographes, comme il l’avait exigé pour un doctorat d’honneur de l’UQAM. Dans ses mémoires rédigés en 2004, Dylan s’explique longuement sur sa désillusion à propos de son premier doctorat d’honneur : « La conscience perturbée de la jeune Amérique ! Ça recommençait. Je n’arrivais pas à le croire. Je m’étais encore fait avoir. Il [le présentateur] aurait pu aborder toutes sortes de choses, attirer au moins l’attention sur ma musique ».
Sans cesse, ses admirateurs, les journalistes, les musiciens et même ses collaborateurs les plus proches comme le guitariste canadien Robbie Robertson interrogeront Dylan sur la voie à suivre, lui demanderont dans quelle direction aller, alors que lui-même n’en a aucune idée. Les Chroniques fournissent une clef pour comprendre l’artiste et son œuvre. Le style est éblouissant et lyrique. Une suite (titre provisoire : Expecting Rain) est annoncée par l’éditeur new-yorkais Simon & Schuster pour la fin de 2019.
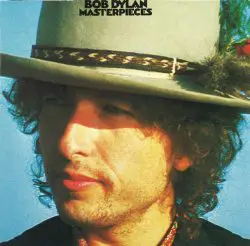 En somme, plus d’une centaine de livres ont été consacrés à Bob Dylan, dont deux encyclopédies, plusieurs cahiers de partitions et des catalogues de ses toiles9. En dépit de sa qualité, le Discours à l’Académie suédoise risque de décevoir par sa brièveté, surtout si on le compare aux Chroniques, beaucoup plus approfondies et nuancées ; il faut voir l’un comme une invitation à lire l’autre. Mais c’est naturellement dans l’œuvre que l’on retrouve la richesse et l’originalité de cet artiste immense, inclassable et indépassable. L’édition bilingue des paroles (Lyrics/Chansons 1961-2012) ne prétend pas remplacer les disques, mais elle constitue un complément fort utile pour en accompagner l’écoute et mettre en contexte des textes ancrés dans la tradition folklorique étatsunienne. Sans cette traduction fidèle, la poésie de Dylan n’est pas aussi facilement accessible au lecteur non anglophone.
En somme, plus d’une centaine de livres ont été consacrés à Bob Dylan, dont deux encyclopédies, plusieurs cahiers de partitions et des catalogues de ses toiles9. En dépit de sa qualité, le Discours à l’Académie suédoise risque de décevoir par sa brièveté, surtout si on le compare aux Chroniques, beaucoup plus approfondies et nuancées ; il faut voir l’un comme une invitation à lire l’autre. Mais c’est naturellement dans l’œuvre que l’on retrouve la richesse et l’originalité de cet artiste immense, inclassable et indépassable. L’édition bilingue des paroles (Lyrics/Chansons 1961-2012) ne prétend pas remplacer les disques, mais elle constitue un complément fort utile pour en accompagner l’écoute et mettre en contexte des textes ancrés dans la tradition folklorique étatsunienne. Sans cette traduction fidèle, la poésie de Dylan n’est pas aussi facilement accessible au lecteur non anglophone.
1. « The Nobel Prize in Literature 2016 ».
2. Élena Scappaticci, « Pierre Assouline mène la fronde des écrivains contre le Nobel de Dylan », Le Figaro, 14 octobre 2016.
3. Marie-Hélène Miauton, « Dylan, Prix Nobel de la muflerie », Le Temps, Suisse, 9 juin 2017.
4. Andrea Pitzer, « The Freewheelin’ Bob Dylan: Did the singer-songwriter take portions of his Nobel lecture from SparkNotes? », Slate, 13 juin 2017.
5. Bob Dylan, Discours à l’Académie suédoise, trad. de l’anglais par Nicolas Richard, Fayard, Paris, 2017, 32 p.
6. Albert Camus, Discours de Suède, Folio, Paris, 2017 [1957], p. 21.
7. Bob Dylan, Lyrics/Chansons 1961-2012, trad. de l’anglais par Robert Louit, Didier Pemerle et Jean-Luc Piningre, nouvelle édition augmentée, Fayard, Paris, 2017, 512 p.
8. Bob Dylan, Chroniques. Volume 1, traduction et glossaire par Jean-Luc Piningre, Fayard, Paris, 2005, 316 p.
9. Michael Gray, The Bob Dylan Encyclopedia, Continuum, New York, 2006 ; Oliver Trager, Keys to the Rain: The Definitive Bob Dylan Encyclopedia, Billboard Books, New York, 2004 ; en français : Jérôme Pintou, Dictionnaire Bob Dylan, Camion Blanc, Rosières-en-Haye, 2013.