Tout comme la quinzaine de romans de Philippe Claudel1, Crépuscule, le dernier opus du secrétaire général de l’Académie Goncourt, est une intrigue policière fortement métissée de saga historique, de fable philosophique et même d’essai politique.
Dramaturge, cinéaste, mais aussi auteur de récits, d’essais et de poésie, Claudel évoque à l’infini le même postulat que proposait il y a 2 000 ans le dramaturge latin Plaute2, qui a par ailleurs inspiré Shakespeare et Molière : l’homme serait-il un loup pour l’homme ?
La sinistre question demeure d’actualité et le prolifique romancier ne cesse d’y faire référence, par exemple dans son œuvre récente : « [S]ur les haines anciennes se déposeront des haines neuves, les unes et les autres composant un terreau inépuisable et fertile pour le mal à venir ». Où l’espoir se terre-t-il donc ?
« On entend les loups hurler au loin3 »
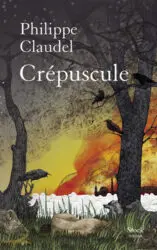 Fable intemporelle dans un lieu aux frontières mal définies, Crépuscule est au cœur d’une géographie incertaine où on pense reconnaître l’un des pays de l’ex-Yougoslavie, peut-être à l’époque des Habsbourg. Son intrigue n’en est pas moins émouvante de réalité. Et comme dans toute fable, il y a le bon, soit le grand, gros, fort et doux Baraj, l’Adjoint du Policier véreux, lequel tient quant à lui le rôle du méchant.
Fable intemporelle dans un lieu aux frontières mal définies, Crépuscule est au cœur d’une géographie incertaine où on pense reconnaître l’un des pays de l’ex-Yougoslavie, peut-être à l’époque des Habsbourg. Son intrigue n’en est pas moins émouvante de réalité. Et comme dans toute fable, il y a le bon, soit le grand, gros, fort et doux Baraj, l’Adjoint du Policier véreux, lequel tient quant à lui le rôle du méchant.
Le Capitaine Nourio, ce triste sire, « connaissait assez bien notre langue, mais ce n’était pas la sienne à l’évidence. […] on ne l’aimait pas, car on n’aime jamais tout à fait ce qui est différent de nous et vient d’ailleurs ». Alors que le gentil géant Baraj, poète à ses heures, « était quant à lui du pays ». Est-il pour autant une meilleure personne ? ou plus facile à aimer ? Aux temps présents, sur tous les continents affluent les migrants, expatriés politiques ou économiques, alors que la planète s’apprête à accueillir les premiers réfugiés climatiques ; les origines de chacun prennent une importance dramatiquement vitale.
La haine de l’inconnu se fait de plus en plus vive.
C’est ainsi qu’un jour on retrouve dans la neige le Curé assassiné, « la tête fracassée à coups de pierre ». « Lui-même alors devait enfin savoir s’il avait eu raison de consacrer son existence à Dieu, ou s’il avait gâché ses jours pour des fariboles. » En examinant le corps, le sage Médecin comprend que « cela va faire du bruit, à n’en pas douter. Et Dieu sait ce qui pourra sortir de ce bruit ». Il n’avait pas tort.
Se met donc en branle la terrible machine des mensonges, des manipulations, de la cruauté, des ignobles bassesses menées entre autres par le Maire, « sans conteste le plus timoré de tous les hommes de la ville, et un des plus idiots », et même des meurtres, car le sang coulera à nouveau pour le plaisir du maléfique Nourio. Bref, il se passait finalement quelque chose et le Capitaine, assisté de Baraj, devra mener une enquête.
Bien que la communauté musulmane vécût en bon voisinage dans la petite ville depuis la nuit des temps, ses adeptes ainsi que son imam deviendront les boucs émissaires de cette tragédie. « Hier on souillait nos portes. Aujourd’hui on détruit une de nos maisons, et demain ? » Demain, ils devront fuir et le Policier découvrira que, de manipulateur doué, il devient à son tour le manipulé des puissants de l’Empire, jusqu’à ce que ce dernier n’implose, en s’effondrant sur lui-même.
Philippe Claudel aura mis neuf ans à imaginer Crépuscule, ce noir thriller bouleversant et magnifiquement écrit, dont les revendications en résonance avec le présent rappellent plusieurs phénomènes récents : le mouvement #MeToo, l’invasion brutale de l’Ukraine par Poutine, la désinformation galopante ou l’opinion sans fondement étalée sur tous les réseaux sociaux en guise de vérité.
Autant les fascinants personnages de ce dernier opus que la richesse de la réflexion de l’auteur sur la nature humaine évoquent plusieurs grands de la littérature, dont les prix Nobel Ivo Andrić (1961), Gabriel García Márquez (1982) et Orhan Pamuk (2006), ou encore certains conteurs est-européens, tels que Jaroslav Hašek dans la série Le brave soldat Chvéïk (Švejk) (1921-1923).
« Le ciel les boudait. Le soleil ne paraissait plus4. »
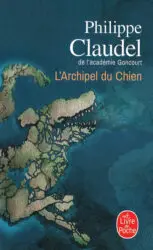 Il y a quelques années, Philippe Claudel avait proposé une autre fable, L’archipel du Chien (Choix des libraires en littérature du Prix des lecteurs du Livre de poche 2019), qui traitait en particulier de la problématique tellement actuelle des migrants. Là encore, une époque et un lieu incertains, mais qu’on croit aussi reconnaître. « L’histoire se passe sur une île. Une île quelconque. Ni grande ni belle. Guère éloignée du pays dont elle dépend mais qui en est oubliée, et proche d’un autre continent que celui auquel elle appartient, mais qu’elle ignore ». Bref, quelque part en Méditerranée, près de l’Afrique. En Italie, peut-être ?
Il y a quelques années, Philippe Claudel avait proposé une autre fable, L’archipel du Chien (Choix des libraires en littérature du Prix des lecteurs du Livre de poche 2019), qui traitait en particulier de la problématique tellement actuelle des migrants. Là encore, une époque et un lieu incertains, mais qu’on croit aussi reconnaître. « L’histoire se passe sur une île. Une île quelconque. Ni grande ni belle. Guère éloignée du pays dont elle dépend mais qui en est oubliée, et proche d’un autre continent que celui auquel elle appartient, mais qu’elle ignore ». Bref, quelque part en Méditerranée, près de l’Afrique. En Italie, peut-être ?
Sur la plage de l’une de ces îles, on découvre un jour les corps de trois jeunes hommes qui avaient vraisemblablement tenté de fuir la guerre ou la misère, dans l’espoir d’une vie meilleure. « Ils n’avaient pas vingt ans. Leurs paupières étaient closes. Ils semblaient dormir d’un sommeil dur qui avait tordu leurs lèvres et marbré leur peau. » Terrible découverte qu’il faut se garder d’ébruiter, car elle pourrait contrecarrer les plans de développement de l’île, affirme le Maire, qui est prêt à tout et à n’importe quoi pour soutenir sa communauté de pêcheurs et de paysans, et surtout pour asseoir son autorité.
On fera disparaître les cadavres dans le ventre du volcan local, mais ce dernier se rebellera un jour devant les crimes que les responsables de l’archipel commettaient. Seul l’Instituteur se révoltera : « Mais je rêve ! Je rêve ! J’ai l’impression qu’on me berce avec une histoire ! […] Vous vous débarrassez des corps de ces pauvres hommes comme s’il s’agissait de poussières qu’on fourre sous un tapis ! » Mal lui en prit, car il ne savait pas, lui, l’honnête homme, jusqu’où le Maire était prêt à aller.
Rien n’arrêtera le magistrat, qui osera franchir les frontières de la morale la plus élémentaire pour parvenir à ses fins ; il ira jusqu’à l’odieux, jusqu’à l’insoutenable, jusqu’à l’indicible. Avec la complicité du Docteur et du Curé, le Maire fera corroborer ses dégoûtants gestes et mensonges par un Commissaire de police venu de l’extérieur.
On accusera de faux coupables, jusqu’à ce que la nature en soit elle-même écœurée. « Ce n’était pas encore tout à fait l’île des morts, mais c’était l’île des mourants. » Cette fable d’actualité grinçante, une critique féroce de l’hypocrisie internationale, revient sur l’égoïsme, l’avidité, la violence et la lâcheté dont les êtres humains sont capables.
« J’ai ressorti la vieille charrette5 »
Le rapport de Brodeck s’est quant à lui révélé être une véritable bombe, tant littéraire que politique et historique. Plus de quinze années se sont écoulées depuis la parution de cette parabole proposée par Claudel, attaquant à la fois la xénophobie et les atrocités commises au nom de la pureté de la race. La fable conserve encore toute son horreur lucide. Intemporelle et terrible. L’œuvre a obtenu le prix Goncourt des lycéens 2007, le Prix des libraires du Québec 2008 et le Prix des lecteurs du Livre de poche 2009. Il existe aussi une version en roman graphique6.
L’action se passe peu après la Deuxième Guerre, sans doute en France, près de l’Allemagne, dans une zone qui avait été occupée. Le narrateur Brodeck revient dans son village après avoir été déporté dans un camp de concentration, et avoir connu la descente aux enfers. « Pourquoi ai-je dû, comme des milliers d’autres hommes, porter une croix que je n’avais pas choisie, endurer un calvaire qui n’était pas fait pour mes épaules et qui ne me concernait pas ? » Les notables du lieu l’avaient eux-mêmes dénoncé à l’occupant, pour « ne pas être né au village, de ne pas ressembler à ceux d’ici, yeux trop sombres, cheveux trop noirs, peau trop bistre » ; il avait commis la faute d’être « d’un passé obscur et d’une histoire douloureuse, errante et séculaire ».
Inattendu, son retour du camp à la fin des hostilités en étonnera plus d’un. Brodeck n’est pas mort. Il retrouvera femme et enfant, et Fédorine, sa vieille nounou qui l’avait amené vivre en ce village de montagne il y a longtemps. Parce qu’il savait écrire, on avait assigné au revenant un travail « sans importance pour [s]on Administration ».
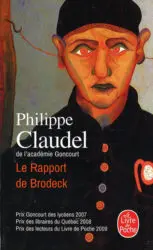 Lorsque le crime sera commis, lorsqu’un étranger, Der Anderer, sera assassiné, c’est tout naturellement à lui, Brodeck le scribe, que les villageois confieront la responsabilité de rédiger le fameux rapport, racontant sa version de l’histoire aux autorités. L’Anderer, véritable miroir grossissant, avait osé dire la vérité aux villageois, dénoncer leurs lâchetés, leurs trahisons, leurs compromissions. Nul ne savait qui il était, ni d’où il venait, et encore moins comment il connaissait toutes les laideurs commises par les habitants du coin, mais tous étaient d’accord, il devait mourir.
Lorsque le crime sera commis, lorsqu’un étranger, Der Anderer, sera assassiné, c’est tout naturellement à lui, Brodeck le scribe, que les villageois confieront la responsabilité de rédiger le fameux rapport, racontant sa version de l’histoire aux autorités. L’Anderer, véritable miroir grossissant, avait osé dire la vérité aux villageois, dénoncer leurs lâchetés, leurs trahisons, leurs compromissions. Nul ne savait qui il était, ni d’où il venait, et encore moins comment il connaissait toutes les laideurs commises par les habitants du coin, mais tous étaient d’accord, il devait mourir.
Entremêlant ses aventures passées aux drames plus récents, l’antihéros Brodeck racontera sa vie, incluant son séjour au camp où le « chien Brodeck » devait suivre le kapo dans ses inspections quotidiennes, une laisse autour du cou et à quatre pattes. Il partagera ses réflexions sur la dignité humaine et l’instinct de survie. « On m’a enfermé au loin, dans un lieu d’où toute humanité s’était retirée. »
Après avoir remis au Maire son rapport sur les faits entourant la mort de l’Anderer, Brodeck comprendra qu’il doit à nouveau quitter le village. Il dira à ses proches : « Nous partirons demain ». Il ressortira la charrette dans laquelle Fédorine et lui étaient arrivés au village il y a plusieurs décennies et ils iront à nouveau refaire leur vie ailleurs.
Un livre-choc, dont l’écriture efficace de Philippe Claudel souligne la portée universelle, et qui ne laissera personne indifférent.
« Il faut tout de même que j’essaie de dire7 »
Précédant Le rapport Brodeck de quelques années, Les âmes grises a été écrit il y a vingt ans et a été célébré dès sa sortie : prix Renaudot 2003, élu Livre de l’année 2003 par la rédaction du magazine Lire et Grand Prix des lectrices de Elle 2004. Traduit dans plus de trente pays, le roman a été adapté en 2005 dans un film éponyme.
Là encore, un narrateur, cette fois anonyme, écrit à sa femme décédée depuis longtemps, et revient sur ce qu’il a vu et entendu vingt ans plus tôt, lors de l’assassinat en 1917 de Belle de jour, une enfant du village. Il était alors officier de police à V., un coin de pays frontalier, au nord-est de la France, peut-être à Verdun, qui sait.
 La Grande Guerre passe et repasse dans cette enquête, car V. est situé aux portes de l’enfer. « Bien sûr il y avait la guerre. Et qui durait. Et qui avait déjà fait des cadavres à ne plus pouvoir les compter. » Deux déserteurs seront d’ailleurs soupçonnés d’avoir tué la petite fille. Mais où se situe la vérité ? Claudel dépeint, comme il sait si bien le faire, le monde des petites gens et celui des notables ainsi que la douleur du narrateur, dont la femme Clémence, son grand amour, lui aura été enlevée trop tôt. Un deuil dont l’officier de police ne se remettra jamais.
La Grande Guerre passe et repasse dans cette enquête, car V. est situé aux portes de l’enfer. « Bien sûr il y avait la guerre. Et qui durait. Et qui avait déjà fait des cadavres à ne plus pouvoir les compter. » Deux déserteurs seront d’ailleurs soupçonnés d’avoir tué la petite fille. Mais où se situe la vérité ? Claudel dépeint, comme il sait si bien le faire, le monde des petites gens et celui des notables ainsi que la douleur du narrateur, dont la femme Clémence, son grand amour, lui aura été enlevée trop tôt. Un deuil dont l’officier de police ne se remettra jamais.
Il confiera sa peine et son sentiment de culpabilité à son amie Joséphine, qui lui expliquera : « Les salauds, les saints, je n’en ai jamais vu. Rien n’est ni tout noir, ni tout blanc, c’est le gris qui gagne. Les hommes et leurs âmes, c’est pareil… » On ne peut que penser au maire, au juge, au procureur, au directeur de l’usine, au curé qui tous savaient, mais ont préféré se taire. La mort de l’institutrice et celle du vieux docteur ajoutent une énième touche de tristesse au roman.
Né en Lorraine en 1962, autre lieu frontalier faut-il le préciser, Philippe Claudel entraîne ses lecteurs dans un tourbillon d’Histoire et d’histoires pour dénoncer les égarements de l’époque actuelle. Sa plume, élégante, est superbe, ses univers toujours riches et soignés.
De grands moments de lecture.
* A. J. Cronin (1896-1981), Les clés du royaume, Le Livre de poche, Paris, 1953.
1. Livres lus pour cet article : Crépuscule, Stock, Paris, 2023, 507 p. ; L’archipel du Chien, Stock/Livre de Poche, Paris, 2019, 230 p. ; Le rapport de Brodeck, Stock/Livre de Poche, Paris, 2007, 374 p. ; Les âmes grises, Stock/Livre de Poche, Paris, 2003, 279 p.
2. En latin Titus Maccius Plautus, né vers 254 av. J.-C. et mort en 184 av. J.-C. à Rome.
3. Crépuscule, Stock, Paris, 2023, p. 265.
4. L’archipel du Chien, Stock/Livre de Poche, Paris, 2019, p. 222.
5. Le rapport de Brodeck, Stock/Livre de Poche, Paris, 2007, p. 371.
6. Le rapport de Brodeck, Manu Larcenet (dessin), tome 1, L’autre (2015), et Manu Larcenet (scénario et dessin), tome 2, L’indicible (2016), Dargaud, Paris, 160 et 168 p.
7. Les âmes grises, Stock/Livre de Poche, Paris, 2003, p. 11.
EXTRAITS
Sa femme en l’apercevant lisait sa folie dans ses yeux. Elle soupirait. Il la prenait là où elle était, sans plus de façon et sans rien lui demander. Porc efflanqué, il venait en elle, soufflant, grognant, tandis qu’elle se laissait faire, muette, soumise et sans joie, continuant à éplucher debout les légumes pour la soupe si telle était sa tâche au moment où il avait surgi.
Crépuscule, p. 29.
Un vieux monde s’affaissait, dans un sommeil épais, et s’enroulait dans sa léthargie comme un escargot fainéant bâille dans sa coquille, en faisant reluire de bave ses souvenirs de vermeil oxydé.
De l’autre côté de la Frontière, dans le pays dont la bannière se frappait d’un croissant d’or, c’était au contraire un sang jeune qui faisait trembler les temps, et qui puisait sa force dans une ferveur fougueuse, turbulente et fanatique.
Crépuscule, p. 109.
Vous avez bien compris ma pensée, reprit le Maire, et vous savez bien que je ne suis ni un salaud ni un homme dénué de cœur. Mais ce n’est pas moi qui ai créé la misère du monde, et ce n’est pas à moi seul non plus de l’éponger. Inhumer ces trois corps dans notre cimetière n’a aucun sens. Déjà parce que ces hommes ne faisaient pas partie de notre communauté, mais aussi parce que nous ne savons même pas quelle était leur croyance.
L’archipel du Chien, p. 49.
Il était impossible que trois cadavres enfouis à des dizaines, voire peut-être des centaines de mètres dans la terre, parviennent à saturer l’air de toute l’île avec leurs miasmes, mais l’air empuanti semblait manifester leur présence, leur colère et leur ressentiment. […] les morts allaient faire payer aux vivants leur indifférence. […] Ils avaient choisi le silence plutôt que la parole. Ils allaient en être punis.
L’archipel du Chien, p. 159.
La guerre… Peut-être les peuples ont-ils besoin de ces cauchemars. Ils saccagent ce qu’ils ont mis des siècles à construire. On détruit ce qu’hier on louait. On autorise ce que l’on interdisait. On favorise ce que jadis on condamnait. La guerre, c’est une grande main qui balaie le monde.
Le rapport de Brodeck, p. 164.
C’est sans doute cela la grande victoire du camp sur les prisonniers : les uns sont morts, et les autres comme moi qui ont pu en réchapper gardent toujours une part de souillure au fond d’eux-mêmes. Ils ne peuvent plus jamais regarder les autres sans se demander si au fond des regards qu’ils croisent il n’y a pas le désir de traquer, de torturer, de tuer. Nous sommes devenus des proies perpétuelles, des créatures qui, quoi qu’elles fassent, verront toujours le jour qui se lève comme une longue épreuve à surmonter et le soir qui tombe avec un sentiment curieux de soulagement.
Le rapport de Brodeck, p.178.
Jamais je ne l’aurai connue laide, et vieille, ridée, usée. Je vis depuis toutes ces années avec une femme qui n’a jamais vieilli. Je me voûte, je crachote, je me brise, je me ride, mais elle, elle demeure, sans fêlure ni disgrâce. La mort m’a laissé cela, au moins, que rien ne peut me ravir, même si le temps m’a volé son visage, que je bute à le retrouver tel qu’il était vraiment.
Les âmes grises, p. 205.
C’est bien curieux la vie. Sait-on jamais pourquoi nous venons au monde, et pourquoi nous y restons ? Fouiller l’Affaire comme je l’ai fait, c’était sans doute une façon de ne pas me poser la vraie question, celle qu’on refuse tous de voir venir sur nos lèvres et dans nos cerveaux, dans nos âmes, qui ne sont, il est vrai, ni blanches ni noires, mais grises, joliment grises comme me l’avait dit jadis Joséphine.
Les âmes grises, p. 274.











