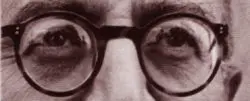Il semble difficile de cerner la pensée de Vassili Grossman et de rendre pleine justice à l’homme et à l’œuvre. Quarante ans après sa mort, survenue en 1964, on se demande s’il fut surtout correspondant de guerre ou plutôt romancier ou plutôt essayiste. Ou encore si cet Ukrainien de naissance fut plus spontanément russe, soviétique, juif ou citoyen du monde.
C’est tout juste si l’on parvient à ranger en ordre chronologique les textes qui ont circulé selon les caprices du hasard ou au gré des soubresauts politiques. L’essentiel, heureusement, se situe ailleurs : Vassili Grossman mérite une place parmi les grands que sont, par exemple, Alexandre Soljénitsyne et Boris Pasternak.
Étonnante discrétion
Le titre dont la collection « Bouquins » coiffe l’ouvrage consacré à Vassili Grossman ne dissipe pas les équivoques. Œuvres1, dit laconiquement la page couverture. Venant d’une collection généreuse en informations périphériques, en éclairages historiques et sociaux, qui se soucie de tout dire de ses auteurs, il est étonnant qu’à peu près aucune mention ne soit faite d’Années de guerre (Autrement, Paris, 1993), ouvrage substantiel qui regroupe les textes rédigés par Grossman à titre de correspondant de guerre entre 1941 et 1945. On justifiera peut-être cette exclusion en distinguant entre les articles offerts à chaud au public soviétique et les œuvres lentement fignolées ; on ne convaincra que ceux qui veulent l’être. Autre chose a conduit à cette décision douteuse et c’est probablement dans les susceptibilités des maisons d’édition que se cache le secret. La Pléiade, déjà, avait succombé à l’arbitraire maison en choisissant les romans de Georges Simenon appelés à l’honneur de ses reliures. Que le préfacier des Œuvres de Grossman, Tsvetan Todorov, ne juge pas utile d’expliquer pourquoi l’admirable Années de guerre en est exclu ne relève ni de la meilleure élégance ni de la plus rigoureuse analyse. Années de guerre, en effet, constitue la base sur laquelle s’édifieront les œuvres de Grossman.
La naissance à soi
Cela dit, la trajectoire de Vassili Grossman est elle-même déroutante. Sa famille a totalement perdu conscience de sa judéité et s’est modelée, bien qu’ukrainienne, selon les usages et les façons de penser russes et soviétiques. Il faudra à l’auteur le nazisme et la sanglante persécution des juifs pour que ce versant de son identité lui apparaisse nettement. D’autre part, l’adhésion de l’homme au credo soviétique le projette dans l’ambivalence. Il croit à l’avènement d’un monde, mais comment peut-il se taire devant les exactions ? La peur explique-t-elle les silences scandaleux de ses débuts ? On peut le penser, même si Grossman donnera au cours de sa carrière de multiples preuves de courage. Le préfacier Todorov formule une hypothèse plausible quand il note ce que fut pour Grossman l’attaque nazie de 1941 : « Grossman et d’autres intellectuels comme lui, qui avaient été ébranlés dans leur foi soviétique par la terreur stalinienne, semblent éprouver un soulagement : en défendant la patrie, ils peuvent lui offrir ce qu’elle leur demande sans avoir à se mentir à eux-mêmes ».
Les reportages de Vassili Grossman, surtout pendant l’interminable bataille de Stalingrad, font de lui un journaliste admiré des lettrés et vénéré des soldats et de la population entière. Grâce à son grade de lieutenant-colonel, il interroge aussi bien les quartiers généraux que les troupiers. Dans les textes qu’il transmet à L’Étoile rouge, journal central de l’Armée soviétique, il insiste sur l’exemplaire entêtement des soldats plus que sur les calculs des généraux. Il décrit en témoin oculaire l’enfer des privations et de la famine et donne écho aux sentiments des humbles. Il aide à faire voir Stalingrad comme la ligne de partage des eaux entre l’irrésistible offensive de la Wehrmacht et la farouche résistance soviétique. Selon que les troupes nazies poursuivront leur avancée ou qu’elles se heurteront à un mur, le sort de millions d’humains et de plusieurs pays sera différent, un deuxième front deviendra ou non possible du côté de l’Atlantique. Dès la fin des hostilités, Années de guerre parut à Moscou. En 1946, les Éditions en langues étrangères de Moscou offrirent une version française, mais il faudra attendre 1993 pour qu’un éditeur français, Autrement, en reprenne l’essentiel.
L’enfantement de Vie et destin
Le journaliste n’avait pas attendu la fin de la guerre pour transcender l’actualité et réfléchir, à la manière d’un Tolstoï ou d’un Dostoïevski, aux enjeux essentiels. Il lui fallait comprendre les parentés et les différences entre le nazisme et le goulag, sonder l’acharnement de l’un et de l’autre contre l’identité juive. Il lui fallait, à partir des crimes commis par les Russes contre des Russes, s’expliquer une telle honte. Autre mystère à percer, la dérive du socialisme à prétention universelle vers ce que Grossman désignera comme le socialisme national. « Lénine se prenait pour le fondateur de l’Internationale, alors qu’il était en train de fonder le grand nationalisme du XXe siècle. » L’écrivain voulait, plus profondément encore, confesser « l’âme russe ». La moindre de ces réflexions pouvait remplir une vie d’homme.
Vassili Grossman attendit des années avant de pouvoir se consacrer à son maître livre. Il était encore correspondant de guerre quand Moscou, désireux de se démarquer de l’antisémitisme nazi, lui confia ainsi qu’à Ilya Ehrenbourg le mandat d’en colliger les manifestations. Le « livre noir » commandé par le gouvernement soviétique occupa le peu de loisir et d’énergie que ne brûlait pas le quotidien du journaliste ; Vie et destin patientait. C’est seulement quand intervint la capitulation allemande et que Moscou perdit tout intérêt pour le « livre noir » que Grossman put se plonger dans son immense récit.
Le décor avait changé, mais aussi l’auteur. Non seulement l’URSS pratiquait désormais son propre antisémitisme, mais Vassili Grossman s’était laissé piéger dans la cynique volte-face du Kremlin. Todorov écrit : « C’est à ce moment que se situe l’ultime geste que, plus tard, Grossman ne voudra pas se pardonner ». Présent à une réunion où la Pravda recueille des signatures pour dénoncer le complot inexistant de médecins juifs, Grossman s’associe à l’ignominie. Jusque dans ses profondeurs, Vie et destin retentit des reproches que l’auteur s’adresse par personnage interposé. Dans une large mesure, les questions déchirantes que se posait Grossman au sujet de la société soviétique deviennent de lancinantes interrogations personnelles. Jusque-là, il s’étonnait que des hommes censément normaux dénoncent, emprisonnent et torturent leurs semblables ; désormais, c’est à sa propre conscience qu’il demande : « Comment ai-je pu ? » Là où Dostoïevski aurait donné la parole à son Grand Inquisiteur, Grossman confie à sa propre conscience le double rôle d’accusée et d’accusatrice.
Strum, le personnage de Vie et destin, qui donne accès à la pensée de l’auteur, n’est pourtant pas un lâche. Quand, malgré la parfaite pertinence de ses travaux scientifiques, le Parti fait le vide autour de lui, il ne s’agenouille pas pour confesser des crimes inexistants. Il s’enorgueillit presque de sa dégringolade, car elle provoque en lui un sentiment à nul autre comparable : il se sent libre. Il n’a pas démérité et il se refuse à qualifier ses recherches d’insignifiantes ou d’impérialistes. Si le carriérisme et la bêtise l’empêchent de modifier les perspectives de la science soviétique, il n’en porte pas la responsabilité. Il est libre !
Alors survient dans ce destin un virage qui complique tout. Staline lui-même téléphone à Strum et cautionne ses recherches. Du coup, la persécution cesse, le lépreux redevient la coqueluche du milieu, le confort et l’abondance chassent la faim et l’insécurité. C’est à ce moment que Strum/Grossman signe une pétition mensongère. Comme si la sécurité retrouvée avait stérilisé le sentiment de liberté qui avait émergé aux heures de menace et de déchéance sociale. Que l’âme est déroutante !
Ce livre aux questions fiévreuses, Vassili Grossman ne le terminera qu’en 1959. Staline est mort depuis six ans et l’auteur ose espérer l’édition de son œuvre. Les éditeurs qui reçoivent le manuscrit écoutent leur peur et demandent l’avis du KGB ; réponse négative. Comme Strum à ses heures d’aventureuse liberté, Grossman résiste et plaide fermement sa cause auprès de Krouchtchev lui-même, mais l’interdiction de publier est maintenue. Le livre, transmis par des voies souterraines, paraîtra à l’étranger en 1980 en russe, en français en 1983, mais en 1988 seulement en Russie.
Tout passe et autres textes
En attendant que le nouveau pouvoir soviétique statue sur Vie et destin, Vassili Grossman écrit pour lui-même. Il se penche sur son siècle. Il évoque de grands drames, comme le largage de la bombe atomique sur Hiroshima, mais aussi la mort des animaux d’un zoo affamé, l’adoption d’une enfant ou la visite d’un cimetière. « On dirait qu’ici, écrit-il, dans ce cimetière entouré d’un mur rouge, brûle la flamme d’un jeune bolchévisme pas encore étatisé, qui porte encore en lui le lyrisme de la jeunesse, l’esprit de l’Internationale, le rêve délicieux de la Commune, les chants enivrants de la révolution. » Certains textes, dont l’émouvant « Madone Sixtine », tiennent en dix pages, mais Tout passe adopte l’ample rythme du roman. Un rescapé des camps de détention reprend pied dans une société dont il a été exclu pendant une trentaine d’années. Face à ceux qui l’ont laissé tomber, Ivan Grigorievitch pourrait se répandre en reproches. Il parle pourtant sur un autre ton : « Autrefois, je pensais que la liberté, c’était la liberté de la parole, la liberté de la presse, la liberté de conscience. Mais la liberté s’étend à toute la vie de tous les hommes. La liberté, c’est le droit de semer ce que l’on veut, de faire des chaussures et des manteaux, c’est le droit pour celui qui a semé de faire du pain, de le vendre ou de ne pas le vendre, s’il le veut ».
Le malheur de la Russie, estime l’auteur, c’est que toute son histoire lui rend la liberté lointaine et même inaccessible. Lénine lui-même aura ancré son peuple dans une forme de soumission. « Lénine est, par bien des côtés, l’inverse des prophètes de la Russie. Il est fort éloigné de leurs idées, de la douceur et de la pureté du christianisme byzantin, de la loi évangélique. Mais, en même temps et aussi surprenant que cela puisse paraître, il est proche d’eux. En suivant une route tout à fait différente, il n’a pas essayé de préserver la Russie des marais sans fond de la servitude et, comme eux, il a reconnu le caractère inébranlable de l’esclavage russe. Comme eux, il est né de notre servitude. »
Vassili Grossman, qui a fini par valoriser la liberté, la bonté, l’universelle dignité de chaque humain, termine son parcours en redoutant que se vérifie le diagnostic du génial codétenu de son Ivan, Alexis Samoïlovitch : « À quoi bon défendre la liberté ? Autrefois, on voyait en elle la loi et la raison du progrès, mais maintenant, à ce qu’on dit, tout est clair : d’une manière générale, il n’y a pas de progrès historique, l’histoire n’est qu’un processus moléculaire, l’homme est toujours égal à lui-même, on n’en fera rien, il n’y a pas d’évolution. Mais il y a une loi simple : la loi de la conservation de la violence ».
Immense auteur et conscience sans repos, Vassili Grossman a rédigé à partir de Stalingrad la chronique d’une résistance vouée à l’écrasement et pourtant récompensée. Ses romans et nouvelles disent que jamais son âme ne se soumettra à cette loi de la conservation de la violence.
1. Vassili Grossman, Œuvres, traduction collective du russe, « Bouquins », Robert Laffont, 2006, 1052 p. ; 52,95 $.
Vassili Grossman a publié, entre autres :
La paix soit avec vous, Notes de voyage en Arménie, De Fallois, 1989 ; Le phosphore, Alinéa, 1990 ; Tout passe, Livre de poche, 1993, L’âge d’homme, 2007 ; Années de guerre, récit, Autrement, 1993 ; Vie et destin, L’âge d’homme, 1995, Pocket, 2001 (épuisé), Livre de poche, 2005 ; Le livre noir, avec Ilya Ehrenburg, Actes Sud, 1996 ; Pour une juste cause, L’âge d’homme, 2001 ; Le livre noir, Extermination des juifs en URSS et en Pologne, T. I, Livre de poche, 2001 ; Le livre noir, Extermination des juifs en URSS et en Pologne, T. II, Livre de poche, 2001 ; La madone Sixtine / Repos éternel, Interférences, 2002 ; La dernière lettre, L’âge d’homme, 2003 ; œuvres, Robert Laffont, 2006 (comprend : « Les combats de Vassili Grossman » par Tzvetan Todorov ; Tout passe, roman traduit par Jacqueline Lafond ; Vie et destin, roman traduit par Alexis Berelowitch et Anne Coldefy-Faucard ; les nouvelles : « Abel, Le six août », traduite par Luba Jurgenson, « Tiergarten », traduite par Luba Jurgenson, « La madone Sixtine », traduit par Sophie Benech, « Repos éternel », traduite par Sophie Benech, « Maman », traduite par Luba Jurgenson, « La route », traduite par Bassia Rabinovici et Corinne Fournier, « Le phosphore », traduite par Marianne Gourg, « À Kislovodsk », traduite par Luba Jurgenson ; documents présentés par Tzvetan Todorov et traduits par Luba Jurgenson : Lettre à Krouchtchev ; Entretien avec M.A. Souslov ; Lettres à la mère) ; Carnets de guerre de Moscou à Berlin de 1941-1945, Calmann-Lévy, 2007 ; La route (nouvelles), L’âge d’homme, 2007.
Vassili Semionovitch Grossman est né le 12 décembre 1905 à Berditchev, l’une des « capitales » juives de l’Ukraine (son nom de naissance est Iossif Solomonovitch, il adoptera la variante russe quand il commencera à écrire). Son père est ingénieur chimiste, sa mère professeur de français ; ils se séparent peu après sa naissance. L’enfant passe deux années avec sa mère à Genève, en 1910-1912 ; et toute sa vie Grossman pratiquera la langue française qu’enseigne sa mère. […] dès ses années d’études, une nouvelle vocation s’est affirmée en lui : il voudrait devenir écrivain. Ses premiers textes sont publiés en 1934. Ils sont d’abord critiqués, ensuite encouragés par le mentor de la littérature soviétique, Maxime Gorki. Ils suscitent en même temps la sympathie d’auteurs alors plus marginaux, comme Babel, Boulgakov, Platonov, ou des membres du groupe « Pereval ». […] en 1937, il est admis comme membre à l’Union des écrivains soviétiques. Il correspond alors parfaitement à l’image que l’on peut se faire du jeune écrivain soviétique. Il doit tout au nouveau pouvoir et souhaite le servir loyalement. Il se définit lui-même comme marxiste mais ses tendances humanistes font sourire ses amis qui le traitent de « menchevik », c’est-à-dire l’équivalent d’un social-démocrate ; il ne sera jamais membre du Parti.