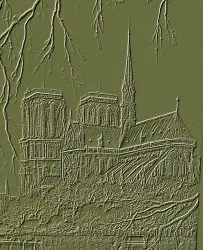Les manifestations émotives suscitées par l’incendie de Notre-Dame de Paris en avril dernier, de même que l’ampleur internationale du soutien à sa restauration, donnent à réfléchir sur la place de la cathédrale dans la culture occidentale et sur son statut de repère symbolique universel. Des écrivains et des éditeurs se sont faits à la fois les témoins et les chantres de l’attachement singulier à cette œuvre immensément chargée de sens.
L’auteur des Piliers de la Terre ébranlé
Dans une plaquette1 rédigée à la hâte et publiée dans sa traduction en français deux mois seulement après l’incendie, l’auteur britannique Ken Follett relate avoir été littéralement terrassé à la vue de Notre-Dame en flammes. Au bord des larmes devant l’écran montrant la cathédrale embrasée, l’écrivain prenait conscience de vivre sa part d’une douleur collective : « Cette image nous a stupéfiés et chavirés au plus profond de nous-mêmes ».
Fort des recherches effectuées pour son roman Les piliers de la Terre, Ken Follett comprenait pourquoi le feu attaquait la toiture de Notre-Dame, dont la charpente est en bois. Il était lui-même monté sous les toits de plusieurs cathédrales et avait admiré la force des assemblages de poutres cachés dans ces espaces, mais il y avait aussi constaté l’accumulation de légers débris propices à la naissance d’un incendie. Une fois les charpentes du toit et de la flèche enflammées, le brasier devenait difficile à contrôler. Le romancier craignait qu’en s’effondrant, le toit détruise la voûte, avec pour conséquence l’effondrement subséquent des piliers de pierre et de tout l’édifice. Heureusement, Follett sous-estimait la résistance du bâtiment, peut-être aussi l’importance des moyens déployés pour combattre le feu, et le pire fut évité.
L’auteur des Piliers de la Terre n’est pas à proprement parler un spécialiste de l’architecture gothique. Il est toutefois mieux connu que les véritables experts ; et puisque son roman le plus célèbre raconte la construction d’une grande cathédrale au XIIe siècle, il allait recevoir de nombreuses demandes d’entrevue dans la soirée du sinistre et au cours des jours suivants. Incidemment, la cathédrale du roman publié en français en 1990 est elle aussi dévastée par un incendie et Follett fait lui-même le lien entre sa propre stupeur et celle d’un de ses personnages : « Philip était atterré : le spectacle de destruction d’une aussi impressionnante construction avait quelque chose d’étrangement choquant. Il lui semblait voir une montagne s’effondrer ou une rivière s’assécher : jamais il n’aurait pensé que cela pourrait arriver ». L’écrivain gallois redoutait que l’inimaginable se produise également pour Notre-Dame et fut évidemment soulagé, au matin du 16 avril, en voyant la cathédrale toujours debout.
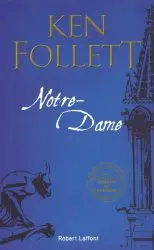 Follett rappelle que les cathédrales ont inspiré de nombreux écrivains, le plus grand d’entre eux étant selon lui Victor Hugo. Le Gallois relève la « vivacité » et la « puissance » du style de l’écrivain français, qu’il compare à Dickens. Il met en lumière l’énorme succès de Notre-Dame de Paris, de même que le rôle du roman, lié à son succès, dans le mouvement pour la réhabilitation de Notre-Dame au XIXe siècle. « Ce best-seller mondial attira touristes et pèlerins vers la cathédrale, et le bâtiment délabré qu’ils découvrirent fit honte à la ville de Paris. L’indignation de Hugo fut contagieuse. » Après quelques pages sur la restauration majeure qui s’ensuivit, de 1844 à 1864, Follet revient également sur certains événements historiques ayant contribué à ancrer Notre-Dame toujours plus profondément dans la mémoire collective, tant en France qu’à l’étranger. L’un des plus saisissants de ces faits nous ramène à la fin de la Seconde Guerre mondiale, le jour du défilé de la victoire où le général de Gaulle se rendit à Notre-Dame pour s’affirmer comme chef d’État. Ce jour-là, des tireurs embusqués dans les tours de la cathédrale auraient visé la foule. Follet, visiblement un admirateur du général, souligne que ce dernier avait continué impassible son parcours, au péril de sa vie.
Follett rappelle que les cathédrales ont inspiré de nombreux écrivains, le plus grand d’entre eux étant selon lui Victor Hugo. Le Gallois relève la « vivacité » et la « puissance » du style de l’écrivain français, qu’il compare à Dickens. Il met en lumière l’énorme succès de Notre-Dame de Paris, de même que le rôle du roman, lié à son succès, dans le mouvement pour la réhabilitation de Notre-Dame au XIXe siècle. « Ce best-seller mondial attira touristes et pèlerins vers la cathédrale, et le bâtiment délabré qu’ils découvrirent fit honte à la ville de Paris. L’indignation de Hugo fut contagieuse. » Après quelques pages sur la restauration majeure qui s’ensuivit, de 1844 à 1864, Follet revient également sur certains événements historiques ayant contribué à ancrer Notre-Dame toujours plus profondément dans la mémoire collective, tant en France qu’à l’étranger. L’un des plus saisissants de ces faits nous ramène à la fin de la Seconde Guerre mondiale, le jour du défilé de la victoire où le général de Gaulle se rendit à Notre-Dame pour s’affirmer comme chef d’État. Ce jour-là, des tireurs embusqués dans les tours de la cathédrale auraient visé la foule. Follet, visiblement un admirateur du général, souligne que ce dernier avait continué impassible son parcours, au péril de sa vie.
Le petit livre se termine par une réflexion sur les fortes impressions que suscite à coup sûr une cathédrale, qu’elle soit aperçue au loin ou vue de l’intérieur. Il y a plusieurs raisons à cela et l’une d’elles, sur laquelle Follett insiste avec raison, est que les cathédrales sont l’œuvre de larges collectivités, chacune de leurs composantes étant motivée par des intérêts particuliers, mais aussi par « l’aspiration humaine à quelque chose qui dépasse la vie matérielle ».
On peut lire sur la couverture du livre que les bénéfices de l’éditeur Robert Laffont et les droits d’auteur de Ken Follett (y compris les 100 000 euros d’à-valoir versés par son éditeur américain Penguin Books) seront remis à la Fondation du patrimoine, un des organismes habilités par le gouvernement français à recueillir les dons en vue de la restauration de l’édifice.
Le roman de Victor Hugo redécouvert
Deux jours après l’incendie, les médias rapportaient l’engagement des éditeurs de livres de poche à faire leur part d’effort pour la reconstruction de Notre-Dame. Plusieurs librairies et sites de vente en ligne étaient en rupture de stock du roman Notre-Dame de Paris, de Victor Hugo. La forte demande appelait la réimpression et aucun éditeur ne voulait porter l’odieux de profiter de la catastrophe. Aussi, Antoine Gallimard annonçait la réimpression de 30 000 exemplaires dans la collection « Folio classique », de même que la remise de tous les bénéfices de la vente à la souscription lancée par le président Macron. Du côté du Livre de poche, propriété de Hachette, on prévoyait réimprimer au cours de l’année 23 000 exemplaires et on prenait l’engagement de reverser aux fondations habilitées, jusqu’à la fin de l’année, un euro pour chaque exemplaire vendu. Chez Pocket, du groupe Editis, on s’engageait à verser tous les bénéfices de la vente du livre au cours de l’année à la Fondation du patrimoine.
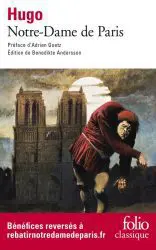 Le roman de Victor Hugo2 est en effet intimement lié à l’emblématique cathédrale et il n’est pas étonnant que le mauvais sort subi par l’édifice suscite un retour à l’œuvre littéraire. Lorsque Hugo s’attelle à l’écriture de cette histoire fantasque en septembre 1830, à 28 ans, on le connaît surtout comme poète et dramaturge. À la mi-janvier 1831, après seulement quatre mois et demi de travail, il tient son roman de plus de 600 pages. La réception critique sera plutôt mitigée, mais l’œuvre connaîtra un succès populaire qui ne s’est pas démenti jusqu’à aujourd’hui.
Le roman de Victor Hugo2 est en effet intimement lié à l’emblématique cathédrale et il n’est pas étonnant que le mauvais sort subi par l’édifice suscite un retour à l’œuvre littéraire. Lorsque Hugo s’attelle à l’écriture de cette histoire fantasque en septembre 1830, à 28 ans, on le connaît surtout comme poète et dramaturge. À la mi-janvier 1831, après seulement quatre mois et demi de travail, il tient son roman de plus de 600 pages. La réception critique sera plutôt mitigée, mais l’œuvre connaîtra un succès populaire qui ne s’est pas démenti jusqu’à aujourd’hui.
L’intrigue aux nombreux rebondissements de Notre-Dame de Paris s’articule aux efforts et manigances de quatre personnages masculins cherchant à gagner les faveurs de la bohémienne Esmeralda. Le tout se déroule dans le Paris du XVe siècle, en particulier aux alentours de la cathédrale Notre-Dame. L’action est menée par Hugo avec tambours et trompettes, moult expressions latines et une pléthore de détails secondaires. La narration est entrecoupée de longues considérations, parfois sans rapport direct avec l’action, de telle sorte que les éditeurs hésiteraient de nos jours à publier un tel récit en net déficit d’intégration. On passe ainsi à maintes reprises d’un récit campé à la fin du Moyen Âge à de longues tirades sur la valeur du patrimoine bâti tel que vu par Hugo à son époque. Reste que les digressions emportées et dénonciatrices du romancier visant la sauvegarde de Notre-Dame sont généralement réputées avoir touché leur cible.
Une cathédrale chère aux écrivains
Au fil des siècles, de nombreux écrivains ont célébré les charmes de Notre-Dame. En témoigne avec éloquence cette autre manifestation de soutien du milieu littéraire à la reconstruction de la cathédrale : la publication par les éditions Points, en partenariat avec le ministère français de la Culture, d’une anthologie de textes d’écrivains3 faisant référence au célèbre monument. Là aussi, les bénéfices de l’opération seront dévolus à l’entreprise de restauration.
De François Villon à Louis Aragon, en passant par Gérard de Nerval, Émile Zola et Jacques Prévert entre autres, le petit recueil aligne un cortège de citations qui ne manqueront pas d’inciter des lecteurs à plonger plus avant dans les œuvres dont elles sont tirées. On y trouve bien sûr des descriptions imagées visant à frapper l’imagination, par exemple Théophile Gautier comparant les arcs-boutants de Notre-Dame à des « côtes de poissons gigantesques », ou encore Patrick Grainville se rappelant ses visions d’adolescent : « Je voyais les gargouilles bondir, multiples et béantes comme des mufles de chiens dans les arceaux, les fougères, les trèfles, les acanthes sculptés. Tous ces abois couraient, fusaient, m’auréolaient ». On y trouve aussi des énoncés plus prosaïques, entre autres un long extrait de Joris-Karl Huysmans critiquant un certain « matérialisme des monuments » et plaidant pour l’exploration de la dimension symbolique des églises du Moyen Âge, « l’âme des cathédrales ». Enfin, Marcel Proust notant que « Notre-Dame faisait précisément partie de Paris », Sylvain Tesson affirmant que la chrétienne église est aussi un « temple solaire », la littérature nous souffle de toutes parts que Notre-Dame participe d’une culture commune, bien au-delà de sa fonction religieuse première.
Dévotion et inspiration
Le 15 avril dernier, j’étais occupé à garder mon calme face aux aléas du trafic routier montréalais, lorsque j’appris par la radio qu’un incendie faisait rage dans la charpente du toit de Notre-Dame. Comme Ken Follett, et comme des millions de personnes à travers le monde, je fus bouleversé. Moi qui ne suis pas croyant, ma peine était vive au point de m’étonner moi-même.
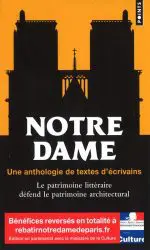 Ainsi que le notait Antoine Gallimard au moment de s’engager pour son groupe à joindre l’effort de reconstruction : « Le support d’émotion qu’est le livre, à la fois matériel et immatériel, nous rassemble, comme la cathédrale elle-même4 ». Ce rapprochement, entre l’architecture et le livre, en tant que deux modes de diffusion du langage, avait été fait aussi par Hugo, qui expliquait notamment dans son chapitre de Notre-Dame de Paris intitulé « Ceci tuera cela », comment le livre était en voie de remplacer à partir de la fin du XVesiècle les œuvres architecturales. Or, il est évident que maintes créations architecturales d’aujourd’hui possèdent un grand pouvoir d’évocation et que des monuments du passé ont vu leur charge émotionnelle et leur potentiel de signification décuplé avec le temps. Il est d’ailleurs remarquable que la valeur de Notre-Dame ait été mise en relief et même exaltée par un livre qui prenait pourtant acte, explicitement, de la fin du temps des cathédrales.
Ainsi que le notait Antoine Gallimard au moment de s’engager pour son groupe à joindre l’effort de reconstruction : « Le support d’émotion qu’est le livre, à la fois matériel et immatériel, nous rassemble, comme la cathédrale elle-même4 ». Ce rapprochement, entre l’architecture et le livre, en tant que deux modes de diffusion du langage, avait été fait aussi par Hugo, qui expliquait notamment dans son chapitre de Notre-Dame de Paris intitulé « Ceci tuera cela », comment le livre était en voie de remplacer à partir de la fin du XVesiècle les œuvres architecturales. Or, il est évident que maintes créations architecturales d’aujourd’hui possèdent un grand pouvoir d’évocation et que des monuments du passé ont vu leur charge émotionnelle et leur potentiel de signification décuplé avec le temps. Il est d’ailleurs remarquable que la valeur de Notre-Dame ait été mise en relief et même exaltée par un livre qui prenait pourtant acte, explicitement, de la fin du temps des cathédrales.
Les bâtisseurs de cathédrales étaient sans doute animés par la foi en Dieu, mais n’étaient-ils pas aussi motivés par un amour de l’humanité ou, du moins, par une foi en l’avenir ? Quelle que soit la couleur particulière qu’on lui attribue, le grandiose investissement spirituel accumulé au cours des siècles dans les pierres des cathédrales constitue aujourd’hui une source de réconfort et d’inspiration. Il est en un sens déconcertant de constater que l’incendie d’une église puisse provoquer davantage d’alarme que les catastrophes humanitaires par trop fréquentes un peu partout sur la planète. Mais cela confirme l’importance absolument vitale des symboles pour l’existence de nos sociétés.
* Illustration numérique : Dominic Duffaud
1. Ken Follet, Notre-Dame, Robert Laffont, Paris, 2019, 72 p. ; 9,95 $.
2. Victor Hugo, Notre-Dame de Paris. 1482, Folio, Paris, 2009 (réimpression 2019), 951 p. ; 10,75 $.
3. Collectif, Notre-Dame. Une anthologie de textes d’écrivains, Points, Paris, 2019, 96 p. ; 9,95 $.
4. Agence France-Presse, « Les éditeurs de Notre-Dame de Paris se mobilisent », LaPresse.ca, 17 avril 2019, [https://www.lapresse.ca/arts/litterature/201904/17/01-5222552-les-editeurs-de-notre-dame-de-paris-se-mobilisent.php].
EXTRAITS
Alors que la nuit tombait, les Parisiens descendirent dans les rues et les caméras de télévision filmèrent des milliers de visages affligés éclairés par les flammes ; certains chantaient des cantiques, d’autres pleuraient en regardant brûler leur cathédrale bien-aimée.
Ken Follett, Notre-Dame, p. 15.
J’ai [depuis] longtemps éprouvé une authentique paix spirituelle dans les grandes cathédrales, comme des millions de gens, croyants ou non. Et j’ai une autre raison de me sentir redevable aux cathédrales : l’amour que je leur voue m’a inspiré le roman qui est certainement mon livre le plus populaire, et sans doute le meilleur.
Ken Follett, Notre-Dame, p. 18-19.
Sans doute, c’est encore aujourd’hui un majestueux et sublime édifice que l’église de Notre-Dame de Paris. Mais, si belle qu’elle se soit conservée en vieillissant, il est difficile de ne pas soupirer, de ne pas s’indigner devant les dégradations, les mutilations sans nombre que simultanément le temps et les hommes ont fait subir au vénérable monument, sans respect pour Charlemagne qui en avait posé la première pierre, pour Philippe-Auguste qui en avait posé la dernière.
Victor Hugo, Notre-Dame de Paris. 1482, p. 193.
[I]l y a une certaine heure surtout où il faut admirer le portail de Notre-Dame. C’est le moment où le soleil, déjà incliné vers le couchant, regarde presque en face la cathédrale. Ses rayons, de plus en plus horizontaux, se retirent lentement du pavé de la place, et remontent le long de la façade à pic dont ils font saillir les mille rondes-bosses sur leur ombre, tandis que la grande rose centrale flamboie comme un œil de cyclope enflammé des réverbérations de la forge.
Victor Hugo, Notre-Dame de Paris. 1482, p. 355.
Qui n’a pas vu le jour se lever sur la Seine
Ignore ce que c’est que ce déchirement
Quand prise sur le fait la nuit qui se dément
Se défend se défait les yeux rouges obscène
Et Notre-Dame sort des eaux comme un aimant
Louis Aragon, Notre-Dame. Une anthologie de textes d’écrivains, p. 27.
Notre-Dame jalouse
Immobile et sévère
Du haut de toutes ses pierres
La regarde de travers
Mais la Seine s’en balance
Jacques Prévert, Notre-Dame. Une anthologie de textes d’écrivains, p. 43.
Ils furent si fâcheux en le harcelant qu’il fut contraint de se réfugier sur les tours de l’église Notre-Dame. Installé à cet endroit et voyant tant de gens autour de lui, il dit d’une voix claire : « Je crois que ces maroufles veulent que je leur paye ici même ma bienvenue et mon étrenne. C’est juste. Je vais leur payer à boire, mais ce ne sera que par ris. »
Alors, en souriant, il détacha sa belle braguette et, tirant en l’air sa mentule, les compissa si roidement qu’il en noya deux cent soixante mille quatre cent dix-huit, sans compter les femmes et les petits enfants.
François Rabelais, Notre-Dame. Une anthologie de textes d’écrivains, p. 47.
Je voulais du moins parler de Notre-Dame de Paris. Mais quelqu’un a marqué ce monument d’une telle griffe de lion, que personne désormais ne se hasardera d’y toucher. C’est sa chose désormais, c’est son fief ; c’est le majorat de Quasimodo. Il a bâti, à côté de la vieille cathédrale, une cathédrale de poésie, aussi ferme que les fondements de l’autre, aussi haute que ses tours.
Jules Michelet, Notre-Dame. Une anthologie de textes d’écrivains, p. 81.
Bien des hommes de tous les pays de la terre
Viendront pour contempler cette ruine austère,
Rêveurs, et relisant le livre de Victor…
Gérard de Nerval, Notre-Dame. Une anthologie de textes d’écrivains