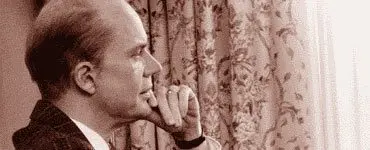Hans-Jürgen Greif nous avait habitués au texte court et à l’essai, avec la même intelligence légèrement teintée d’humour, la même érudition non exempte d’une belle et fine sensualité, des idées vivement brossées, des parcelles de sens saisies au vol et proposées au lecteur invité à les compléter avec un apport de son cru ; mais cette fois, c’est un roman au sens le plus traditionnel du terme qui nous est proposé, un roman qui nous laisse pantois : étonnés certes de ce revirement de genre, mais surtout captivés jusqu’à l’essoufflement.
Je parlais d’humour, d’érudition, de sensualité. Tout cela se retrouve également dans le roman1 de Hans-Jürgen Greif, avec en outre ce que seul le roman peut offrir, et que nous pourrions appeler prosaïquement la longueur. Mais encore faut-il entendre le terme dans son sens le plus positif, celui du plaisir prolongé, tant le roman prend ici des formes variées et inattendues qui nous tiennent constamment en haleine.
Le livre raconte l’histoire d’Orfeo, chanteur hors du commun, qu’une vieille dame (la Signora) adoptera après la mort tragique des parents, pour se consacrer entièrement à lui enseigner le chant, avec un mélange de rigueur et de tendresse. Orfeo est un primo uomo, ou un musico, c’est-à-dire un castrat, terme que l’auteur préfère ne pas utiliser à cause de ses connotations péjoratives. Mais c’est un primo uomo moderne dont il s’agit, qu’un accident de voiture à un très jeune âge castrera et mènera vers la vieille dame, qui en fera un chanteur dont la voix, unique, fera vite des malheurs. L’histoire de ce mythe moderne, troublante et à la fois palpitante, nous fera goûter à une remarquable gamme de sentiments humains.
D’abord, nous découvrons le monde de la musique, l’impitoyable discipline de l’apprentissage du chant, le milieu cruel et corrompu des concours, la fine séparation entre le succès et l’échec, voire l’univers délirant des raves, plus moderne certes que le milieu du chant classique, mais non moins codé et féroce.
Mais au-delà de la musique, c’est essentiellement de désir que nous parle ce roman. Désir de l’autre, de l’atteindre, de le pénétrer, de le sublimer ; d’autant plus si cet autre est un héros, une star, un être inaccessible par définition, et si la sexualité, aussi débridée et trouble soit-elle, quelle que soit par ailleurs son orientation, est insuffisante et incapable d’en assouvir le désir. N’est-ce pas d’ailleurs le propre du désir, avec ou sans héros, que de ne pouvoir être assouvi ? L’ultime message du roman étant sans doute le corollaire immédiat de ce constat : la solitude, amoureuse bien sûr, mais aussi professionnelle, artistique, sociale, est bien notre lot commun.
Une solitude que l’on sent d’entrée de jeu dans ce roman, mais que le texte tissera peu à peu, de façon brillante et implacable, et que l’on approchera avec différents outils, selon le niveau d’érudition que l’on souhaitera y mettre. Car l’auteur, sans en faire un étalage excessif, et sans d’ailleurs que le lecteur ait à partager toutes ses connaissances pour apprécier son roman, fait preuve d’une érudition peu commune, tant en matière de musique qu’eu égard à une mythologie discrète mais combien éclairante pour qui veut s’y plonger. Orfeo, pour commencer par lui, ne s’appelle pas ainsi (plutôt : il n’adopte pas ce nom) de façon innocente, on l’aura vite compris. Et Weber, le jeune homme faible, incertain de lui, de l’amour et de la vie en général, qui prendra Orfeo sous son aile à la mort de la Signora, et s’attachera ainsi à la seule personne autour de lui qui ne pourra jamais s’attacher à qui que ce soit (dimension forte du roman s’il en est) ne le désirera pas non plus gratuitement. Pas plus que sa femme Kirsten.
En fait, on découvre peu à peu à la lecture de ce roman décidément peu banal, que rien n’est choisi au hasard.
Par exemple, Vera, cette mystérieuse amie de Kirsten, aux amours complexes et à la sexualité ambiguë, est propriétaire d’une discothèque, dont on sent très vite qu’elle aura un rôle important dans le roman. Cette discothèque s’appelle La Licorne, laquelle incarnait au Moyen Âge, il n’est pas inutile de le rappeler, la chasteté. Et quant on sait comment le roman culmine, cela n’est pas sans intérêt.
Je pense aussi à cette scène d’amour dans une baignoire, où Orfeo n’enlace sans doute pas tant la Kirsten de notre histoire, qu’Eurydice même, la femme perdue, morsure de serpent incluse.
Le mythe d’Orphée se déroule ici tout en sourdine, et si le lecteur peut fort bien entrer dans ce drame fort et terriblement humain sans nécessairement emprunter à sa dimension mythologique, il va de soi que celle-ci ne peut qu’apporter au lecteur attentif un plaisir de lecture d’autant plus vif. Surtout dans cette finale apocalyptique à La Licorne, où la scène est d’une force telle que si l’on ne s’appuie pas sur la mythologie pour en atténuer ou en filtrer la violence, le choc risque de s’en trouver grandement accentué. C’est sans doute pourquoi d’ailleurs l’auteur a jugé nécessaire d’ajouter un épilogue à son roman. Non pas tant pour offrir des pistes d’analyse (cela est laissé entièrement au libre choix du lecteur), que simplement pour éviter trop brusque rupture, pour étirer un peu plus le plaisir de la longueur, de la durée, bref pour ne pas finir.
1. Orfeo, L’instant même, 2003.