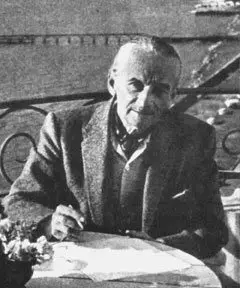En novembre 1994, la presse québécoise parla de « l’automne Grandbois » pour souligner le cinquantième anniversaire de la publication des Îles de la nuit par le poète Saint-Casimir-de-Portneuf.
Le 10 de ce mois s’était d’abord ouvert un colloque de deux jours coordonné par Marcel Fortin, qui l’avait bellement intitulé « L’Archipel Grandbois », et organisé sous l’égide du Département de langue et de littérature françaises de l’Université McGill et du Centre d’études québécoises de l’Université de Montréal. Le même jour, les élèves du Conservatoire d’art dramatique de Montréal, dirigés par Gilles Marsolais, offraient un récital à la Bibliothèque nationale du Québec à Montréal. C’est là aussi que Marcel Fortin, assisté de Louise Godin au montage, coordonnait toujours « L’invitation au voyage », exposition de manuscrits, carnets de voyage, photographies, cartes postales, lettres et livres d’artistes inspirés des poèmes de Grandbois. Une autre exposition, d’œuvres sur papier celle-là, fut tenue à la Galerie Eric-Devlin, offrant au public des dessins, gouaches, huiles et fusains du poète, qui s’est adonné un moment à la peinture.
Le monde de l’édition répandit quant à lui une manne imposante. Préparé par Nicole Deschamps et Jean Cléo Godin, le numéro 30-2 (automne 1994) de la revue Études françaises, « Alain Grandbois, lecteur du monde », lui fut consacré. À l’occasion du colloque précité, Jean Cléo Godin fit aussi paraître, avec Estelle Côté, l’édition critique du récit Né à Québec1, dans la prestigieuse collection « Bibliothèque du Nouveau Monde » des Presses de l’Université de Montréal. Puis, toujours en novembre 1994, l’Hexagone lançait à la Bibliothèque nationale du Québec pas moins de quatre ouvrages consacrés à Alain Grandbois et à son œuvre : une réédition anniversaire des Îles de la nuit*, dans la collection « Typo », avec une préface de Jacques Brault, et trois essais : L’Homme sans rivages, Portrait d’Alain Grandbois2, de Denise Pérusse, L’étoile mythique, Lecture de L’étoile pourpre d’Alain Grandbois3, d’Yves Bolduc, et Histoire d’une célébration, La réception critique immédiate des livres d’Alain Grandbois 1933-19634, de Marcel Fortin. Enfin, d’autres ouvrages sont annoncés : Nicole Deschamps et Jean Cléo Godin feront bientôt paraître Intertextes d’Alain Grandbois chez Fides, et les deux mêmes préparent actuellement une édition critique : Les voyages de Marco Polo dans le cas de Nicole Deschamps, les textes inédits ou publiés seulement en revues pour ce qui concerne Jean Cléo Godin.
« Portrait » ou instantané ?
Automne chargé, donc, mais en même temps très diversifié, voire inégal. On se réjouira par exemple de la volumineuse iconographie présentée par Denise Pérusse dans un livre réalisé à partir du fonds Grandbois de la Bibliothèque nationale du Québec surtout, de quelques collections privées (Jeanne Drouin et René Pageau principalement), de revues (Digeste français et Paris Match) et des Archives du Séminaire de Québec. Outre de nombreuses photos inédites fort intéressantes, on y découvre quelques dessins et manuscrits du poète. Comme le laisse entendre le sous-titre, il ne s’agit pas d’une biographie, mais d’un « Portrait d’Alain Grandbois », l’auteure ayant voulu cibler surtout l’amoureux, puis le voyageur et un peu le poète dans cette « esquisse biographique ». Le lecteur risque toutefois de demeurer un peu sur sa faim une fois l’agréable surprise de l’illustration passée. Les « probablement », les « semble-t-il » et les conditionnels « serait », « aurait » ou autres viennent d’abord saper régulièrement la certitude attendue des faits racontés par Nicole Pérusse. Le « portrait d’Alain Grandbois » contient ensuite des éléments d’un intérêt souvent discutable. Il y a même, à l’occasion, un certain voyeurisme que rend plus manifeste encore les lacunes de ce « portrait ». Celui-ci touche finalement plus à l’histoire des amours de Grandbois qu’à l’ensemble de l’homme qu’il fut et de l’œuvre qu’il a laissée. La pertinente et abondante iconographie du livre rachète heureusement ses manques biographiques et compensent certains choix anecdotiques.
Une « lecture » globale
Déjà beaucoup plus satisfaisant est l’essai d’Yves Bolduc sur L’étoile pourpre d’Alain Grandbois, qui propose une lecture du dernier recueil que le poète a publié de son vivant. Cette lecture singulière a été faite à partir de l’excellente édition critique Poésie 1, réalisée en 1990 par Marielle Saint-Amour et Jo-Ann Stanton et publiée dans la collection « Bibliothèque du Nouveau Monde ». Elle s’attache à ce qu’Yves Bolduc appelle les « poèmes synthèses », c’est-à-dire ceux « où viennent s’orchestrer les thèmes fondamentaux » dont « L’étoile pourpre est jalonnée ».
Cette thématique est par ailleurs plus sémantique que formelle, car l’essayiste s’emploie à débusquer la signification des vers de Grandbois. Par exemple, le deuxième chapitre cherche à révéler le sens du « Poème 25 », qui est « l’échec de l’impasse » ou « le consentement du locuteur à la vie, à l’au-delà, au Jour ». Yves Bolduc en arrive ainsi à dégager des constantes dans l’œuvre du poète, comme celles-ci : « la poésie de Grandbois est un incessant effort pour briser les limites de la condition humaine, celle du temps en particulier » ; « dans ce recueil où l’amour est au centre de toute l’expérience, cette grande analogie de la nuit et du jour se retrouve disséminée partout » ; « l’unité de l’humain et du cosmique [est une] donnée constante de la poésie de Grandbois »
Yves Bolduc pratique aussi la rhétorique, puisqu’il dégage régulièrement comparaisons et métaphores, métonymies et synecdoques, symboles et allitérations Pourtant, sur la quatrième de couverture, l’éditeur affirme que « l’essayiste évite ici le carcan d’une méthode et l’obscurité d’un langage trop savant pour conduire le lecteur au centre du poème. Il se présente comme le compagnon de lecture d’une poésie dont l’expression souvent saisissante et culturellement très riche risque parfois de dérouter le lecteur ». Mais alors, qu’en est-il des hyperbates, oxymores, polysyndètes, hypallages, parataxes et autres hypostases débusqués par Bolduc dans sa lecture ? Faudrait-il croire que ce n’est pas là un langage « savant » qui risque moins de « dérouter le lecteur » que la poésie « saisissante et culturellement très riche » de Grandbois ? L’éditeur a sans doute voulu affirmer en réalité que l’essayiste n’utilise pas les méthodes dites modernes d’analyse du texte ou d’analyse du discours ni le métalangage de la nouvelle critique, moins abordable et moins connu du public en général que la rhétorique ou la stylistique. Cet aveu éditorial demeure troublant.
Quoi qu’il en soit, en faisant de la thématique, Yves Bolduc n’évite pas ce que je pourrais appeler le piège de sa méthode, à savoir la paraphrase. Car, cherchant à comprendre le « sens précis » de poèmes et tentant d’« interpréter » les mots du poète, l’essayiste ne fait surtout au fond que redire en termes plus clairs ce que l’écriture concentrée, condensée et hermétique de l’écrivain ne permet pas toujours de déceler avec facilité. Constatons en revanche qu’Yves Bolduc a une forte connaissance et une remarquable habitude du texte grandboisien et que, dès lors, sa démarche est loin d’être anodine et encore moins inutile. Cette compétence se retrouve également dans l’article novateur qu’il a signé dans Études françaises : « La Bible dans la poésie de Grandbois ». On regrettera par ailleurs que l’éditeur n’ait pas procédé de façon satisfaisante au toilettage de L’étoile mythique.
Marcel Fortin nous convie à l’étude de la réception critique immédiate des livres d’Alain Grandbois, entendue au sens « assez large » de « commentaires rendus publics moins de trois années après la parution d’un livre ». La démarche de l’essayiste l’amène à examiner la question de la typologie du genre, dans le cas des livres de prose, celle de l’hermétisme, pour ce qui concerne la poésie, de même que les prix reçus, les accords ou désaccords de la critique et ainsi de suite.
C’est avec compétence et en détail que Marcel Fortin nous parle de tous ces sujets, et de bien d’autres encore, comme celui, systématiquement traité, du « mythe de Grandbois ». Le mot « mythe » semble toutefois inadéquat, voire exagéré, même si le contenu des propos réunis sous ce vocable n’est pas inintéressant. En somme, l’essayiste rend bien compte des 151 recensions signées par les 99 auteurs qui, pendant 30 ans, ont abondamment commenté la production d’Alain Grandbois. Seule ombre d’importance au tableau, mais dont il n’est pas responsable, la place des notes à la fin du livre oblige à une fastidieuse manipulation physique qui entraîne une perte de temps et risque de couper le fil de la lecture. C’est du reste le cas des trois livres de l’Hexagone, c’est-à-dire ceux de Denise Pérusse, d’Yves Bolduc et de Marcel Fortin.
Splendide Né à Québec
La disposition infrapaginale des notes est au contraire l’un des éléments qui avantagent la lecture de la magnifique édition critique de Né à Québec qu’Estelle Côté et Jean Cléo Godin ont publiée aussi en 1994 et qui demeurera sans doute l’événement le plus remarquable de « l’automne Grandbois ». Outre qu’on ne perd pas son temps, ni son énergie, ni le fil du récit à chercher le contenu desdites notes, qui sont nombreuses, le livre de Grandbois amène le lecteur dans un monde de ravissement, savamment guidé par les deux essayistes.
La brève mais fort pertinente « Introduction » qu’ils signent rappelle en effet la genèse de Né à Québec. Les origines familiales du titre de l’œuvre, la préparation et la rédaction de celle-ci, les sources bibliographiques, l’art du récit et la fortune du livre, voilà autant de sujets qui retiennent leur attention et qui sont traités avec une minutie et une prudence exemplaires.
Cette « Introduction » s’attarde notamment sur l’importante question de la notion de récit. C’est le genre sous lequel Né à Québec avait d’abord paru, et dans l’édition originale française, en 1933, et dans l’édition québécoise de Fides, en 1948. Or, curieusement, Estelle Côté et Jean Cléo Godin gomment cette indication, sans explication, tandis que l’éditeur parle de « biographie » sur le premier rabat intérieur de la jaquette. Né à Québec avait soulevé, comme Les voyages de Marco Polo etAvant le chaos, cette problématique question de la typologie du genre, comme le montre Marcel Fortin. Estelle Côté et Jean Cléo Godin placent le livre, eux, à l’enseigne du « récit historique » dont ils disent que c’est « un genre très pratiqué au Québec » et qu’il n’est pas du reste « sans lien avec l’hagiographie religieuse ». Étrangement, Marcel Fortin, dans son Histoire d’une célébration, précise quant à lui que le récit est un « genre non seulement équivoque ou hybride, mais encore peu pratiqué au Québec en 1933 ». Estelle Côté et Jean Cléo Godin définissent ensuite le récit comme « un ouvrage où le vrai doit paraître vraisemblable, où les personnages historiques ont statut de personnages fictifs, où, surtout, la rigueur et l’harmonie de la phrase portent partout la marque de la personnalité de l’écrivain ». Cette définition ne concorde pas avec celles que l’on trouve dans les ouvrages littéraires spécialisés. Elle décrit fort bien en revanche la nature de la création grandboisienne dans Né à Québec.
Fresque historique de la Nouvelle-France en général et récit de la vie de Louis Jolliet en particulier, le livre présente en effet des données apparaissant comme réellement plausibles, pour ainsi dire. De même, les d’Abancourt, Talon, Frontenac, Boucher, Brébeuf, Hébert, Prouville de Tracy, Rémy de Courcelle, Radisson, La Salle et tutti quanti (c’est-à-dire « plus de trois cents noms de personnes » – sans compter les quelque « deux cents noms de lieux ») ont la cohérence et la crédibilité de personnages fictionnels. Et, surtout, la nature de l’écriture grandboisienne a une personnalité bien particulière. Que le récit soit peu ou prou pratiqué au Québec n’a, en somme, qu’une importance relative : celui de Grandbois a justement de remarquable une rigueur et une harmonie phrastiques dues principalement à une concision des plus expressives et davantage, peut-être, à une présenceactive qui rend le récit vivant, actuel, visuel et, pour tout dire, passionnant. Nous avons au total une reconstitution du passé particulièrement réussie, vraie et crédible, historique et fictive, en vertu de cette faculté exceptionnelle qu’a Grandbois de délaisser le style officiel et d’ordinaire grave et froid de l’historien pour adopter le parti de l’écrivain, du créateur.
D’une part on pourra constater avec Estelle Côté et Jean Cléo Godin que « Grandbois s’est imposé une rigueur scientifique probablement inhabituelle chez les auteurs de récits historiques ». Mais, comme les éditeurs critiques l’indiquent en faisant les rétablissements nécessaires, l’écrivain a de nombreuses fois erré : ici, en effet, il fait une lecture inattentive d’un texte de Champlain, là il commet une erreur de date ou ne respecte pas la chronologie de sa source ; ailleurs il parle d’un assassinat au lieu d’une torture, se trompe de lieu, confond deux épisodes semblables, ou deux frères, etc. L’historien qui lit de tels propos mettra certes spontanément et sérieusement en doute lerécit de Grandbois. Mais l’amateur de belles lettres appréciera, lui, le vraisemblable du texte, basé sur l’histoire, et, surtout, la reconstitution vivante de même que l’écriture condensée dont il était question plus haut. Qu’on en juge par cet extrait qui se situe à l’époque de l’arrivée du régiment de Carignan-Salières : « La ville [Québec] s’était remplie d’une extraordinaire animation. Affables et souriants, la bouche en cul-de-poule, leurs joues roses légèrement poudrées, les marchands se dandinaient sur le seuil de leur boutique, invitant les passants à admirer les étalages où luisaient, parmi le chapelet de mocassins et des bonnets fourrés, les verroteries multicolores, les broches d’écaille et les croix d’argent poli. Dans les tavernes de la basse-ville, les soldats buvaient, chantaient, riaient […] Ils portaient des moustaches, rasaient leurs joues. Ils se moquaient entre eux des barbes canadiennes, des tricots de gros point, des capotes de draps rugueux, de ces soldats de fortune aux mouvements lourds de bûcherons, qui marchaient en roulant les épaules comme des matelots. Ils souhaitaient de se mettre en campagne. Ils ne croyaient pas qu’un Sauvage nu pût être un ennemi redoutable. Et du revers de leurs manches bleues, en fredonnant des refrains, ils frottaient leurs boutons d’argent.»
Nul historien de profession ne songera à signer une telle histoire où fourmillent tant de détails. Mais nul ne pourra nier en revanche que la « bouche en cul-de-poule » et le dandinement des marchands, de même que les « tricots de gros point », les « capotes de draps rugueux » et les « boutons d’argent » des uniformes des soldats français aux joues rasées viennent reconstituer de façon fort évocatrice, aussi vraie que vraisemblable, un passé aboli qui fut haut en couleur. L’Histoire elle-même, du reste, l’Histoire pure et sérieuse, n’est-elle pas elle aussi fiction, en partie, dans la mesure où, par les choix qu’elle doit s’imposer, elle reconstitue une réalité vraie et vraisemblable en laissant de côté de nombreux éléments factuels ?
On lira de même, surtout dans la fresque nouvelle-francienne particulièrement bien réussie de la première partie, la scène du coin du feu chez les d’Abancourt, la tempête de cinq jours sur l’Atlantique ou la description de l’intérieur de la maison de Jean Jolliet. Voyons cette fois le récit de la mort du père de Louis Jolliet : « Un canot venant de Tadoussac ramena le charron à Québec. L’homme grelottait de fièvre. Il avait le masque creux, les gencives violettes, le corps marqué de taches vineuses. Sa chair devint flasque et répandit des odeurs fétides. Le scorbut le rongeait, le tua. Marie le pleura, puis sécha ses larmes. Quatre enfants. Il fallait vivre. Adrien, l’aîné, fut placé en apprentissage. Elle gardait les deux plus jeunes avec elle. Les Jésuites se chargèrent du cadet, Louis.
L’année suivante, Marie épousa Godfroy Guillot, cultivateur à Beauport. Et la vie continua. »
Outre les détails évocateurs et précis, on notera ici la concision et la rapidité du récit. Voilà, me semble-t-il, les principales marques scripturales de Grandbois dans ses textes de prose. Pour s’en convaincre, on lira encore l’épisode de la capitulation de Champlain devant les Kirke, celui de l’aide accordée par le roi à Pierre Boucher ou le récit de la mort du chef huron Annaotaha, au Long-Sault. Ces pièces d’anthologie donnent une bonne idée de la manière personnelle de Grandbois, faite de tableautins alertes et rapides, concis et évocateurs, et constituant un récit historique d’une intense force de conviction malgré quelques erreurs historiques. On retrouvera également ces marques particulières d’écriture dans le texte Sun Yat-Sen, que la revue Études françaises a eu l’heureuse idée de publier dans ce numéro 30-2 de l’automne 94, et qui est, de ce point de vue, éblouissant, tout inachevé soit-il.
Au plan rhétorique, Grandbois fait bien sûr usage de métaphores, notamment, mais jamais les clichés n’affleurent. L’auteur parle en effet « des remous qu’une lune pâle frangeait d’argent » ou de « l’Iroquois [qui] tendit ses bras vers l’Immense blessure du couchant ». On note aussi cette allitération efficace : « Quand vint le Sanctus, on entendit alors grelotter doucement le sanglot des femmes ». On appréciera encore ce trait d’humour satirique lors de la prise de possession du Canada au nom du roi de France : « Alors une décharge de mousqueterie déchira l’air, célébrant par l’imitation du tonnerre l’événement qui faisait de ces hommes libres [les Amérindiens] les sujets dépossédés du Roi-Soleil… » Plus loin, on sourira à l’évocation des différences entre les religions amérindienne et catholique : « Les Sauvages nus écoutaient, attentifs […] les paroles de Marquette. Ils pressèrent celui-ci de questions. Ils s’étonnaient qu’ils dussent sacrifier à un dieu bon, afin de lui plaire, ce qu’ils avaient accoutumé de sacrifier aux mauvais esprits afin d’apaiser leurs fureurs. Certains mystères les ravirent. La conception du pardon aux ennemis fit hocher la tête aux Anciens. »
Né à Québec est un livre qui n’a laissé et ne laisse personne indifférent depuis sa parution en 1933. C’est l’œuvre d’un « peintre du passé plutôt qu’historien », selon la juste expression de Fernand de Montigny cité par Marcel Fortin. Quant au style, Marcel Fortin résume bien l’opinion des recenseurs de la première édition, française, du livre : « La critique insiste […] sur la distinction de la langue grandboisienne qui, originale ou personnelle, sort de l’ordinaire. Celle-ci se caractérise en outre par sa correction et sa beauté, ainsi que par sa nervosité, sa vivacité, qu’on rattache volontiers à l’idée de ‘modernité’. Une majorité de commentateurs, même s’ils s’en étonnent parfois, accueillent favorablement ces innovations rhétoriques. D’autres critiques (encore sensibles à l’ancienne manière d’écrire, essentiellement ‘classique’) expriment des réserves plus ou moins marquées sur les ‘audaces’ sytlistiques de Né à Québec. »
« L’automne Grandbois », grâce aux actes du colloque qui seront bientôt publiés, grâce aussi aux essais parus et à paraître, et aux rééditions des œuvres du poète et du prosateur, se prolongera donc au delà de l’anniversaire qu’il a voulu célébrer. Tous ces nouveaux travaux et les manifestations autour de Grandbois ne sont pas le moindre indice de la richesse de l’œuvre de celui qui se dispute, avec le poète de Regards et jeux dans l’espace (Saint-Denys Garneau), le titre de « père de la poésie moderne au Québec », de « poète de la modernité québécoise », ou d’« initiateur de la poésie moderne contemporaine ».
1. Né à Québec, édition critique par Estelle Côté et Jean Cléo Godin, Presses de l’Université de Montréal, 1994, 288 p. ; 38 $.
2. L’homme sans rivages, Portrait d’Alain Grandbois, par Denise Pérusse, « Itinéraires », L’Hexagone, 1994, 214 p. ; 26,95 $.
3. L’étoile mythique, Lecture de L’étoile pourpre d’Alain Grandbois, par Yves Bolduc, « Essais littéraires », L’Hexagone, 1994, 208 p. ; 19,95 $.
4. Histoire d’une célébration, La réception critique immédiate des livres d’Alain Grandbois 1933-1963, par Marcel Fortin, « Essais littéraires », L’Hexagone, 1994, 419 p. ; 29,95 $.
* On se rappellera que ce premier recueil, publié à Hankéou en 1934, fut édité à 150 exemplaires, dont la plupart furent perdus lors du naufrage de la jonque chinoise qui les transportait. Le recueil, qui fut repris dans Les îles de la nuit, est à l’époque « passé inaperçu au Québec ». Marcel Fortin apporte cependant des précisions sur le sujet dans son article « Le livre englouti ou la fortune critique des Poèmes d’Hankéou », dans Études françaises, no 30-2 (automne 1994).