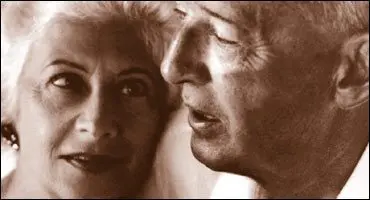Autant le dire tout de suite : je me suis toujours autant méfié de Vladimir Nabokov que de Louis-Ferdinand Céline, de Walt Disney, de la peste bubonique, des promesses des informaticiens ou du baratin des présidents des grandes entreprises, aussi fallacieux, et très souvent plus dépravé, que celui des politiciens.
Un crâneur, ai-je souvent pensé, protégeant d’abord et avant tout ses fesses en louant son pays d’adoption dans les années 1940 et 1950. Difficile de lire la fin de la déclaration suivante sans rire… ou sans pleurer : « En passant, je déplore l’attitude des gens stupides ou malhonnêtes qui confondent Staline et McCarthy, Auschwitz et la bombe atomique, ou qui mettent sur un pied d’égalité l’impérialisme brutal de l’URSS et l’aide sincère et désintéressée que les États-Unis apportent aux nations en détresse. » S’il s’agissait d’une blague d’époque (on trouve cette phrase dans une interview accordée en 1964 au magazine Life), elle demeurerait encore aujourd’hui du plus mauvais goût, le farceur semblant refuser de reconnaître ce qu’a causé et continue de causer la barbarie démocratique étatsunienne et prétextant (belle anticipation de Francis Fukuyama…) que ses gigantesques bavures ne sont que de petits accrocs sans importance à l’échelle de l’histoire humaine.
J’avais par ailleurs lu l’essai plutôt quelconque que Nabokov avait consacré à Gogol ainsi que plusieurs de ses lectures données à l’Université Cornell avec le mépris qu’il affichait ouvertement pour les étudiants qui payaient malgré tout grassement ses prestations. Pourtant, outre Le Don, superbe démonstration d’intertextualité nourrie de maturité, et le tout poétique Machenka, j’avais adoré Lolita, non pas à cause du côté prétendument pervers satisfaisant l’exécrable pudibonderie yankee, mais en raison de l’intime relation, tellement proustienne, ou joycienne, entre la langue et le corps qui s’y exprime. Qu’on se rappelle… « Lolita, light of my fire, fire of my loins. My sin, my soul. Lo-lee-ta : the tip of the tongue taking a trip of three steps down the palate to tap, at three, on the teeth. Lo. Lee. Ta. She was Lo, plain Lo, in the morning, standing four feet ten in one sock. She was Lola in slacks. She was Dolly at school. She was Dolores on the dotted line. But in my arms she was always Lolita. » J’ai cité en anglais, pour la beauté de cette langue qu’on affaiblit aujourd’hui jusqu’à la massacrer comme la planète, pour l’extrême tendresse de cette seconde langue de Nabokov, qu’il prétendait manier moins habilement que son russe maternel. J’ai cité en anglais, moins pour offrir l’original et avoir l’air bilingue (on sait ce que contient de honte ce dernier mot au Canada) que pour fournir ce que j’appellerais le signifiant de la convergence. En effet, le créateur de Lo-Lee-Ta – ou est-ce son amant, Humbert Humbert ?… ) ne pensait pas en langues mais en images, les mots d’un idiome spécifique apparaissant parfois sur ce qu’il appelait « l’écume de l’onde cérébrale ». Cette faculté de former des images spumescentes, Nabokov y tenait ferme parce qu’elle maintenait désormais vivantes dans le présent les traces et les vestiges d’un passé qu’il ne rencontrerait que dans la fiction, lieu où les mémoires des sensations et des perceptions continuaient à exister en tendant les bras vers l’avenir.Mais… la solitude…
S’il jouait constamment entre la réalité et l’illusion, multipliait les doubles et les doublures, Nabokov tenait à s’afficher, comme il le précisait dans l’un des entretiens réunis dans Parti pris1, en tant que « moniste indivisible ». Autrement dit, à la fois naturaliste et empiriste, il épousait, loin de rester caché dans la caverne des ombres, une conception du monde dans laquelle celui-ci, absolument homogène, constituait la seule et unique réalité (rien n’existant en dehors de lui). Ce qui explique en partie la tiède sympathie qu’il nourrissait à l’égard de l’élève de Cratyle (« Couché, Platon, couché, bon chien ! »), d’autant plus que l’écrivain n’aurait pu survivre sous le régime du philosophe antique qu’il qualifiait ) sur ce point, il se serait fort bien entendu avec Karl Popper, ennemi de toute forme de déterminisme et remplaçant, dans son utopique société ouverte, une élite par une autre, celle-ci ayant davantage que l’autre accès aux outils capitalistes autorisant et légitimant l’expérimentation – de « germanique, militariste et musical ». Chose certaine, l’imagination comme forme de mémoire aura toujours constitué l’ombilic du fictionnel, « l’esprit de prévoyance de Mnémosyne » conservant les éléments nécessaires pour les fondre avec des souvenirs récents dans le tissu de l’expérience humaine, ce pourquoi Nabokov considérait que la mémoire et l’imagination défiaient en chaque être humain, et chacune à leur façon, le Temps, allant même jusqu’à le nier, ce que démontrent la science et la poésie, sœurs siamoises depuis la nuit de leur engendrement.
Cette conception suffit-elle à expliquer la solitude de Nabokov, son retranchement ? Sans doute. En tout cas, elle permet d’affirmer qu’un artiste n’est pas (ou pas nécessairement…), en dehors de son travail, une personnalité exceptionnelle. Un écrivain qui n’aime pas la cuisine, qui ne pêche pas, ne danse pas, ne se saoule pas, bref, un homme ordinaire qui essaie de faire son métier le plus honnêtement du monde, voilà bien le scandale ! Nabokov ne fut pas misanthrope ; il refusa tout simplement ) signe à mon sens indiscutable d’intelligence ) d’appartenir à la société du spectacle. Mais peut-on pour autant prétendre sur cette base que l’œuvre d’art n’a aucune importance pour la société qui la voit naître et que c’est cette caractéristique qui fait en sorte qu’elle ne se démode pas et passe à l’histoire ? Une réponse à cette question oblige à prendre en considération un élément capital : l’isolement n’est pas toujours affaire de tempérament, il est souvent l’effet du hasard. Un « agneau » qui perd ses racines et vogue d’un continent à l’autre n’a-t-il pas raison de se montrer prudent à l’égard de ses semblables et pointilleux lorsqu’il prend contact avec une œuvre passant la frontière d’une langue à une autre ? Pour le grand traducteur d’Eugène Onéguine, l’objectif de la traduction est « de transmettre l’information la plus fidèle possible, et cela n’est possible que grâce à une traduction littéraire accompagnée de notes ». Mon dessein n’est pas ici de défendre ou d’invalider cette idée, moins limitative qu’il n’y paraît de prime abord ; il est simplement de souligner que la sévérité caustique de Nabokov pour le travail de ses collègues2 ne le place pas dans la famille des obsessifs-compulsionnels, mais lui permet de soutenir la nécessité de « l’exactitude textuelle », nécessité souvent méprisée par « les partisans du camouflage enjoliveur ».
L’art, quand il touche au ciel, a donc beau être « fantastiquement trompeur et complexe », cela n’exonère jamais le créateur du souci d’objectivité. Quand Nabokov se penche par exemple sur les écrits de Khodassevitch, un poète de l’émigration russe, c’est son authenticité et son unicité qu’il retient, aspects dénotant une responsabilité souveraine à l’égard de la poésie. On touche alors à une éthique de l’écriture, laquelle se définit à travers la capacité de Nabokov à parler franc et clair : « […] mon propos n’est pas de briller par mes facéties ni de paraître grotesque et obscur, mais d’exprimer ce que je sens, ce que je pense avec la plus grande véracité, avec la plus grande précision possible. » J’avouerai que c’est quant à moi cette honnêteté qui m’a réconcilié avec ce prestidigitateur qui, écrivait doucement l’un des ses grands spécialistes en commentant Autres rivages, avait « trop de retenue, trop de pudeur, pour parler de sa peur de la mort3 », peur terrifiante en ce qu’elle hurlait la perte définitive au mitan de la vie. Cet homme que je croyais suffisant, mesquin, vaniteux, ce vieux monsieur qui m’avait semblé nourrir un inutile esprit de dérision et une parole sardonique, voilà qu’il m’apparaissait maintenant comme un lointain cousin de Jonathan Swift et de Michael Coetzee, aussi ironique, aussi tragique, mais aussi caressant et perspicace, nostalgique, que Gulliver, Robinson et Foe. Parti pris, que j’avais cru le livre d’un grincheux, révélait tout à coup la force de la distance et de la timidité.« Tout, dans le monde, est beau, mais l’homme ne reconnaît le beau que lorsqu’il le voit rarement, ou bien de loin… »
C’est d’ailleurs en me plongeant littéralement dans les nouvelles de Nabokov que je compris à quel point ses déclarations souvent irritantes au sujet de Freud (le « charlatan viennois ») et de Boris Pasternak (Jivago serait « pro-bolchévique ») ou ses niaiseries à propos de Finnegans Wake (« masse informe et opaque de folklore factice », « pudding froid »), de Crime et châtiment (une « sinistre et absurde litanie ») ou encore du Nouveau Roman (« un petit tas de poussière et de plumes dans une cage de pigeonnier »), que ses déclarations donc cachaient une infinie tristesse sensible à travers les brouillages des dispositifs narratifs de ses œuvres. Peu importe finalement son palmarès (Alexandre Pouchkine, Gustave Flaubert, Jane Austen, Alexandre Griboïedov, John Keats, Alexandre Blok, André Biely, Robert Browning, Samuel Beckett et quelques autres) ; chacun savoure les mets qu’il préfère.
Ce qui compte, c’est que Nabokov aimait le football, le tennis, le vin, la bière, le soleil dans son jardin, les échecs, sa femme, son fils. Et cela rassure, cela donne la mesure d’un humain en chair qui prit bien garde de parler pour ne point trop dire. Dans une de ses admirables et bouleversantes nouvelles4 , rédigée à Berlin en 1923, on découvre, au détour du récit d’un amour de jeunesse, cette vérité totale et sublime de l’immigrant et de l’amour : « Tout silence contient l’hypothèse d’un secret. » Quel mystère Nabokov protégea-t-il ? Nul ne le saura jamais et bien hardi qui prétendrait le connaître ou oserait le divulguer.
L’humble majesté des nouvelles de Nabokov, parfois plus intense, plus précise que celle de ses romans, vient de ce qu’elles préservent un abîme, l’essence du temps, sa texture de nuit. Il me faudrait des pages et des pages pour, lentement, délicatement, chuchoter les merveilles de ces textes, tant ceux qui s’appuient sur la précision maniaque de l’entomologiste que ceux qui adoptent la vigueur de l’impressionnisme. Sentir l’air des saisons, les effluves des tulipes, croiser les regards des arbres, les rivières et les planètes, ouvrir ses oreilles au mouvement de la matière, à la course des spectres : « Écoute !, ordonne légèrement le narrateur des – Dieux –. Toute ma vie je veux courir et crier de toutes mes forces. Que toute ma vie soit un hurlement de liberté. Comme le cri de la foule quand elle accueille le gladiateur. » Passion, pure passion d’un homme qui aimait voir ses initiales confondues avec celles de la Visible Nature.
L’écriture et le motif lépidoptère se rejoignent alors dans la morale inflexible d’un ennemi inflexible de la cruauté sous toutes ses formes. Des quatre éléments essentiels de la chasse aux papillons (l’espoir de la capture ou la capture réelle, la capture d’un papillon très rare, l’intérêt du naturaliste à « démêler la biographie d’insectes peu connus » et enfin, le sport, la chance et le plaisir de l’exercice), celui qui fut plusieurs années attaché de recherche au musée de zoologie de Harvard retient une impression absolue, « lorsque le triangle soyeux […] repose enfin plié au creux de votre main ». C’est le moment où le monde entier devient fable, où la métaphore agit pour ce qu’elle est : le langage lui-même, ce que comprend fort bien l’ami de Georges dans Le treizième jour, lui qui sait prononcer très distinctement les couleurs des papillons. Ce moment magique, joie sans limite, celui qui pratique les sciences naturelles peut le répéter à satiété.
Le papillon figure-t-il alors, comme le suggérait un critique, « l’interrelation entre la connaissance de soi et la création artistique, la parodie dirigée contre soi-même et l’identité » ? Ce n’est certes pas Benoît Mandelbrot ou James Lovelock qui s’opposeraient à cette proposition. Il faut toutefois aller plus loin, ou rester plus près, si l’on veut toucher à la résignation heureuse de Nabokov. Qu’on le rêve comme insecte des métamorphoses ou femme de jour, le papillon illumine la promesse de l’inaltérable éternité en agitant la loi de l’harmonie et de l’équilibre cosmique. Avec précaution, un homme peut éclairer le lien entre les choses et confier à celle qu’il aime : « Je compris que tout dans le monde est un jeu de particules semblables constituant de multiples consonances : les arbres, l’eau, toi… De façon unique, égale, divine. Tu te levas. La pluie fauchait encore le soleil. »
1. Ce recueil, réédité par Robert Laffont (1999) dans la collection « Pavillons » (traduit de l’anglais par Vladimir Sikorsky), était paru en 1985 chez Julliard sous le titre Intransigeances. L’original en langue anglaise avait été publié en 1973 chez McGraw-Hill sous le titre Strong Opinions. Dans un autre entretien donné au Time, Nabokov revient sur l’importance à ses yeux d’un monisme indivisible : « ) Le monisme, qui implique une unité de la réalité fondamentale, est considéré divisible quand, par exemple, – l’esprit – se détache sournoisement de – la matière – dans le raisonnement d’un moniste brouillon ou à demi convaincu. »
2. Voir entre autres, dans Parti pris, les critiques des traductions en anglais de La nausée de Sartre (« Une première tentative de Sartre »), d’Eugène Onéguine, publiée par Walter Arndt en 1963 (« En martelant le clavicorde »), et d’un poème d’Ossip Mandelstam par Robert Lowell (« De l’adaptation »). On lira également avec profit la violente polémique avec Edmund Wilson au sujet de la célèbre traduction, par Nabokov lui-même, d’Eugène Onéguine (« Réponse à mes critiques »).
3. Nabokov ou la tyrannie de l’auteur, par Maurice Couturier, Seuil, Paris, 1993, p. 378.
4. Les Nouvelles de Vladimir Nabokov ont finalement et heureusement été réunies en français dans l’édition complète et chronologique publiée chez Robert Laffont, Paris, 1999, 778 p. (Traduites de l’anglais par Maurice et Yvonne Couturier, Gérard-Henri Durand ; traduites du russe par Bernard Kreise, Laure Troubetzkoy.)
EXTRAITS
« Dans sa chambre, avant de se coucher, il ouvrit le rideau, il regarda la nuit en ne pensant à rien. Il y avait le reflet des fenêtres sur la neige sombre devant l’hôtel. Au loin, les cimes métalliques des montagnes voguaient dans une lueur sépulcrale.
« Il eut l’impression d’avoir regardé la mort. Il tira soigneusement les rideaux afin que pas le moindre rayon de lune ne puisse pénétrer dans la chambre. Mais après avoir éteint la lumière, il remarqua depuis son lit que le rebord de l’étagère en verre brillait. Il se leva alors et s’affaira longuement près de la fenêtre en maudissant ces éclaboussures de lune. Le sol était froid comme du marbre.
« Quand Kern ferma les yeux après avoir défait la ceinture de son pyjama, des pentes glissantes s’écoulèrent en dessous de lui ; et son cœur se mit à battre bruyamment comme s’il s’était tu toute la journée et qu’il profitait maintenant du silence. Il eut peur d’écouter ces battements. Il se souvint comme une fois, avec sa femme, il passait à côté d’une boucherie par un jour très venteux, et sur un crochet se balançait une carcasse de bSuf qui cognait contre le mur avec un bruit sourd. Exactement comme son cœur maintenant. »
« Un coup d’aile », dans Nouvelles, p. 43. Nouvelle publiée pour la première fois en janvier 1924 dans Russkoye Ekho (L’Écho russe), revue des émigrés russes de Berlin.
« J’ai toujours affirmé, même en tant qu’écolier en Russie, que la nationalité d’un auteur de valeur était d’une importance secondaire. Plus l’aspect d’un insecte est particulier, moins le taxonomiste est tenté de commencer par étudier l’étiquette placée sous le spécimen épinglé devant ses yeux et qui décrit le lieu qui abrite normalement l’insecte, avant de décider à laquelle des races vaguement décrites il doit être attribué. L’art de l’écrivain est son véritable passeport. Son identité doit être immédiatement reconnaissable à cause d’un dessin particulier ou d’une coloration unique. Son habitat peut venir confirmer la justesse de l’identification, mais il ne doit pas y conduire. D’ailleurs, il est arrivé que des marchands d’insectes peu scrupuleux aient falsifié les étiquettes qui indiquaient la provenance du spécimen. Mis à part ces considérations, je me vois aujourd’hui comme un auteur américain qui a été autrefois un auteur russe. »
Parti pris, p. 62. Entrevue d’abord publiée dans le Wisconsin Studies in Contemporary Literature, vol. VIII, no 2, printemps 1967.