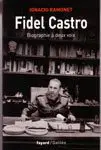Soyons réalistes : le livre Fidel Castro, Biographie à deux voix1 est un monstre. 700 pages d’entrevues serrées menées par l’un des meilleurs journalistes de notre époque, Ignacio Ramonet, directeur du Monde diplomatique.
Ledit monstre a d’abord été publié en espagnol en 2006 (en deux éditions) sous le titre Cien Horas con Fidel, avant d’être traduit en français et édité chez Fayard et Galilée au printemps 2007. Une bombe, un accident de l’histoire, un coup de pouce inattendu pour tous les révolutionnaires soucieux de réussir chez eux le processus de la guerre populaire prolongée. Un délice à déguster entre amis.
Leçons d’une guérilla
Les 26 chapitres de Cien Horas con Fidel sont le testament politique de celui qui a dirigé en 1953 l’insurrection « manquée » de la Moncada et surtout celle, réussie, depuis la Sierra Maestra en 1956 jusqu’ à la prise du pouvoir, 1000 kilomètres plus loin, deux ans et un mois plus tard, en 1959, avec l’entrée triomphale des 2000 guérilleros dans la capitale, La Havane.
Les chapitres 5 à 9 parlent librement des « bêtises » du premier assaut révolutionnaire par 1200 jeunes en 1953 et des leçons qu’en ont tirées les survivants alors qu’ils croupissaient en prison.
« Connaissiez-vous les thèses de Giap, de Hô Chi Minh, de Mao sur la guerre révolutionnaire ? » demande Ramonet. « Nous savions alors que les Vietnamiens étaient d’extraordinaires soldats », lui répond Castro. « Lorsque Mao a entrepris la Grande Marche en Chine, en 1935, c’était un exploit militaire que nous connaissions très peu à Cuba. J’ai ensuite beaucoup lu sur le sujet. Mais dans le contexte cubain, une grande marche n’aurait eu aucun sens. Il n’en reste pas moins que ses tactiques et ses principes politico-militaires étaient d’une grande valeur, utiles à toute forme de guerre. Mao est parvenu à montrer que, pour des révolutionnaires, tout est possible, parce que lui et ses hommes ont parcouru 12000 kilomètres sans cesser de combattre. »
Lorsque Castro dit que « tout est possible », c’est qu’après avoir subi une attaque dévastatrice le 5 décembre 1956, de lui et son groupe, parmi les 82 débarqués du bateau Granma le 2 décembre, il ne restait que quelques survivants. Deux semaines ont été nécessaires pour rassembler douze révolutionnaires survivants et sept fusils. Le premier combat victorieux a lieu le 17 janvier 1957, 46 jours après le débarquement du Granma.
Avec le soutien actif du peuple, en menant une guerre éthique et « irrégulière » très près des principes maoïstes de la guerre populaire prolongée, le mouvement du 26 juillet (date de l’attaque du Moncada) a formé un front populaire uni contre la dictature de Batista, laquais des États-Unis. Batista, bien que soutenu par une armée de 80 000 combattants disposant d’avions et de tanks, n’a pu arrêter une armée de 2000 « barbudos » soutenus par une population en situation insurrectionnelle.
À cet égard, les chapitres 8, « Dans la Sierra Maestra », et 9, « Leçons d’une guérilla », demeurent les meilleurs moments de cette Biographie à deux voix : nous y trouvons un exposé détaillé des acquis de la guerre populaire, à partir de la révolution cubaine victorieuse.
Combat entre la voie capitaliste et la voie socialiste
Du chapitre 10, « Révolution : premiers pas, premiers problèmes », au chapitre 14, « La mort de Che Guevara », qui couvrent les années 1959 à 1967, nous assistons au procès de la révolution, au combat entre la voie socialiste et la voie capitaliste. Il faut lire en particulier le passage sur « la crise des missiles cubains » (1962).
Ce fut, à mon avis, le point de départ de la perte de la souveraineté cubaine dans son rapport au social-impérialisme russe.
Et c’est à peine si Castro arrive à expliquer la décomposition par l’intérieur de l’ex-bloc socialiste. « […] l’Union soviétique, en perpétuant une tradition d’absolutisme, une mentalité hiérarchique et une culture féodale, a eu tendance à abuser de son pouvoir. Elle a particulièrement développé l’habitude d’imposer son autorité et celle de son Parti communiste, hégémonique, aux autres pays et partis2. »
Les 14 derniers chapitres, bien que passionnants, sont plus faibles sur le plan de l’analyse politique et sont à lire au deuxième degré. Ainsi, pour Castro, Cuba est toujours socialiste, mais jamais il n’analyse le mode de production de type capitaliste d’État qui domine son pays. Suffit-il simplement de dire que son pays est « rouge », « socialiste », pour qu’il le soit ? Est-ce une question de foi ?
Une lecture approfondie de la seconde moitié du livre, permet un début d’analyse des classes sociales cubaines, de comprendre quelles luttes elles mènent entre elles. Il y est question des quelques dizaines de milliers de « nouveaux riches » cubains issus de la politique économique de crise dite « spéciale » (1991 à 2001) : « La ‘période spéciale’, je pense, a été à l’origine de profondes inégalités » ; « Ces malandrins qui fournissent en essence les nouveaux riches, qui détournent des marchandises dans les ports, par camions entiers, et par tonnes » ; « À La Havane, ils volaient comme des fous. Vous seriez surpris si je vous racontais l’histoire des stations-service de la capitale. Il y en avait deux fois trop ; c’était un véritable chaos. Chaque ministère s’est mis en tête d’installer la sienne, et de distribuer de l’essence à droite et à gauche. Dans les communes, c’est le désastre, un véritable capharnaüm ». S’organise en réaction une campagne contre le vol de l’essence qui mobilise 28 000 jeunes travailleurs sociaux : « […] les jeunes travailleurs sociaux luttent contre la corruption avec un enthousiasme que vous ne pouvez pas imaginer ».
Et après Fidel Castro ?
Un arbre tombe, un autre se lève.
Prophétique, Castro termine son entretien par une note fort lucide : « Cette révolution pourrait s’autodétruire. Oui, elle peut s’autodétruire. Nous-mêmes pourrions la détruire, et ce serait notre faute. C’est ce qui arrivera si nous ne parvenons pas à corriger nos erreurs, si nous ne mettons pas un terme à des vices en trop grand nombre ».
Et l’enjeu est ici de taille : la révolution socialiste de 1959 a été le premier soulèvement prolétarien réussi en Amérique, bravo !
La prochaine révolution, si elle survient, devra d’abord en toute urgence protéger les acquis actuels : esprit internationaliste des masses, systèmes de santé et d’éducation uniques, protection de la biodiversité et de l’environnement, place importante des arts dans la société, interdiction du jeu et autres plaies du même genre.
Le plus curieux, c’est que ce testament politique de Fidel Castro risque de mettre le feu aux poudres. Publié récemment à fort tirage et à bas prix, dans une troisième édition, en tant que supplément au journal Juventud Rebelde, Cien Horas con Fidel, il peut servir aux masses prolétariennes cubaines fortement scolarisées de combustible pour allumer un nouvel incendie de la Sierra Maestra à La Havane.
1. Ignacio Ramonet, Fidel Castro, Biographie à deux voix, trad. de l’espagnol par un collectif de traducteurs, Fayard/Galilée, Paris, 2007, 700 p. ; 49,95 $.
2. Ce qui rejoint en partie la critique faite par la direction maoïste du Parti communiste chinois à l’Union soviétique durant les années soixante, à savoir qu’elle serait une puissance « rouge » en apparence mais « impérialiste » dans les faits, donc un « social-impérialisme ».
EXTRAITS
[Le Che] avait déjà une culture politique considérable, et avait évidemment lu quantité de livres sur les théories de Marx, d’Engels et de Lénine. Il défendait Marx, Lénine, et critiquait Staline. À l’époque, il condamnait le culte de la personnalité et les erreurs de Staline ; mais je ne l’ai jamais entendu évoquer réellement Trotsky. Il était léniniste, c’est indiscutable. Et, dans une certaine mesure, il reconnaissait même des mérites à Staline, comme pour ce qui concernait l’industrialisation de l’Union soviétique.
Ignacio Ramonet, Fidel Castro, Biographie à deux voix, p. 159.
Quelle leçon nous a laissée le Che ?
Que reste-t-il de lui ? Je crois que le plus remarquable, ce sont les valeurs morales, la conscience. Le Che était le symbole des valeurs humaines les plus élevées, et en même temps quelqu’un qui prêchait par l’exemple. Il a offert le sacrifice de sa vie pour tenter d’améliorer le sort des pauvres. Il est à l’origine d’une mystique. […] Ce qui est important, c’est de savoir que des hommes comme le Che, il y en a des millions et des millions sur la Terre. Les hommes et les femmes qui se détachent du lot ne pourraient rien entreprendre si des millions, en tout point identiques, n’avaient en eux l’embryon de ces qualités ou la capacité de les acquérir. C’est pour cela que notre révolution s’est acharnée à lutter contre l’analphabétisme et à développer l’éducation et la culture, pour que tout le monde soit comme le Che.
Ignacio Ramonet, Fidel Castro, Biographie à deux voix, p. 280.
Écoutez, personne ne peut affirmer aujourd’hui que des changements révolutionnaires vont se produire en Amérique latine. Mais nul ne peut non plus affirmer le contraire. Si l’on analyse objectivement la situation économique et sociale de certains pays, il n’y a pas le moindre doute qu’ils connaissent une situation explosive. Regardez, par exemple, l’indice de mortalité infantile est en moyenne de 65 % dans la majorité de ces pays, alors qu’à Cuba il n’est que de 6,5 %. Dans l’ensemble de l’Amérique latine, il y a donc dix fois plus d’enfants qui meurent qu’à Cuba. La dénutrition affecte parfois jusqu’à 40 % de la population. L’analphabétisme total et l’analphabétisme fonctionnel restent trop élevés. Le chômage touche des dizaines de millions de personnes. Sans parler du problème des enfants abandonnés par millions. Un jour, le président de l’Unicef m’a avoué que si l’Amérique latine avait le même niveau de soins médicaux et de santé publique que Cuba, 700000 enfants seraient sauvés chaque année.
Si l’on ne trouve pas très vite des solutions à ces problèmes – et l’ALCA n’est pas une solution, ni la mondialisation néolibérale –, des révolutions risquent d’éclater dans n’importe quel pays d’Amérique latine. Au moment où les États-Unis s’y attendront le moins. Et ils ne pourront accuser personne d’encourager ces révolutions.
Ignacio Ramonet, Fidel Castro, Biographie à deux voix, p. 507.