Une laide couverture. Un de ces titres1 qui cède à la mode d’associer un objet – ou une partie du corps – à un personnage réel ou fictif. Vu en librairie : Le nombril d’Aphrodite. Pourquoi pas La perruque de Robespierre ou Les pantoufles de Marie-Antoinette ? Effet saugrenu sans doute délibéré mais l’abord du livre est peu attrayant. Heureusement il est bien imprimé, malgré des notes en bas de page microscopiques, et les reproductions de tableaux sont réussies.
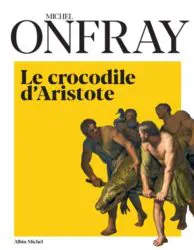 L’idée de départ est fort ingénieuse et sa mise en œuvre convaincante, parfois brillante. Elle consiste à partir d’un portrait de philosophe ou d’écrivain pour en reconstituer la pensée. Il s’agit d’abord de choisir le portrait – certains étant purement fantaisistes quand ils sont censés représenter Platon ou Sénèque. L’auteur a procédé à de minutieuses recherches sur l’origine de ces portraits, souvent nombreux et douteux. Ensuite il lui a fallu repérer un objet qui y figure, le décrire avec une rigoureuse précision (par exemple la bague d’Érasme), le placer en contexte, en déchiffrer le symbolisme et finalement reconstituer le système philosophique dans lequel il s’inscrit. L’hypothèse de Michel Onfray est que « le diable est dans les détails », ou la vérité ! Ainsi, du « poisson de Pythagore » au chat et aux pipes de Derrida sont présentés 33 portraits décryptés couvrant toute la philosophie occidentale.
L’idée de départ est fort ingénieuse et sa mise en œuvre convaincante, parfois brillante. Elle consiste à partir d’un portrait de philosophe ou d’écrivain pour en reconstituer la pensée. Il s’agit d’abord de choisir le portrait – certains étant purement fantaisistes quand ils sont censés représenter Platon ou Sénèque. L’auteur a procédé à de minutieuses recherches sur l’origine de ces portraits, souvent nombreux et douteux. Ensuite il lui a fallu repérer un objet qui y figure, le décrire avec une rigoureuse précision (par exemple la bague d’Érasme), le placer en contexte, en déchiffrer le symbolisme et finalement reconstituer le système philosophique dans lequel il s’inscrit. L’hypothèse de Michel Onfray est que « le diable est dans les détails », ou la vérité ! Ainsi, du « poisson de Pythagore » au chat et aux pipes de Derrida sont présentés 33 portraits décryptés couvrant toute la philosophie occidentale.
Le regard d’Onfray est aussi aiguisé qu’est étendue sa connaissance des auteurs qu’il choisit comme repères dans la philosophie, fruit d’une longue et double fréquentation, comme en témoigne un de ses ouvrages précédents consacré aux grandes figures de l’Antiquité romaine (Sagesse2), qui lui permet une révision parfois radicale, voire une contre-histoire de notre savoir philosophique. Plaisir du regard, de la lecture et de l’écriture : on sait que chez Onfray un livre n’attend pas l’autre. Mais on le suit fort bien dans ses analyses, décryptages, démonstrations. Avec – et malgré – une propension bien connue à abuser de l’exposé pédagogique, pour ne pas dire démagogique. Onfray ne laisse jamais oublier qu’il est professeur, matérialiste, hédoniste, antichrétien et athée. Il dirait que ce sont des « choix réfléchis » mais, n’en déplaise à l’auteur, on ne peut s’empêcher parfois de reconnaître des « préjugés jamais complètement évacués » ! Notamment il n’en finit plus de régler ses comptes avec le christianisme.
Il reconnaît que certains portraits n’offrent aucune prise à l’analyse, tels ceux d’Augustin ou de Thomas d’Aquin, l’intention apologétique des commanditaires de l’époque l’emportant sur le souci de vérité dans la représentation. Toutefois, les portraits abondent pour certains écrivains : ainsi pour Montaigne, comment décider quel est le plus fidèle ? L’amour d’Onfray pour la peinture ne fait pas de doute et s’étend aux plus contemporains des artistes (Gérard Fromanger, Robert Combas, Valerio Adami). Pour les besoins de ses démonstrations, il se montre en général plus attentif à la mise en scène, à l’ordonnance et aux formes qu’à la couleur et à l’éclairage, même s’il ne néglige pas ces composantes. Sa virtuosité et sa subtilité à décoder dans un embrouillamini de lignes les personnalités et les théories de Foucault, de Guattari ou de Deleuze sont proprement vertigineuses. Il n’est pas sûr cependant que leur pensée soit devenue plus intelligible au profane… Mais très éclairants sont les commentaires sur la robe de chambre de Diderot (de Louis-Michel van Loo) ou le portrait signé par Munch représentant Nietzsche appuyé à un parapet en surplomb rappelle qu’il fut avec Diderot l’un des deux philosophes favoris d’Onfray, comme assez paradoxalement les considérations sur un portrait de Pascal traité avec respect. Parallèle établi entre Voltaire et Rousseau, « deux métaux du même alliage » de l’esprit français.

Chez ces penseurs-phares, Onfray n’hésite pas à circonscrire les zones d’ombre, les petitesses, voire les noirceurs. À l’occasion il dénonce les idées fausses entretenues par exemple sur Descartes (portrait d’après Frans Hals), ou les contresens sur l’interprétation de certaines toiles (ainsi le célèbre Philosophe en méditation de Rembrandt sous la cage d’escalier). Le lecteur qui anticipait inévitablement un long exposé sur Freud et sa démolition ne sera pas déçu ! La liste des « mensonges » freudiens est établie une nouvelle fois, répétant Le crépuscule d’une idole qu’Onfray lui a consacré. Le procès est rouvert mais l’accusé bénéficie de circonstances atténuantes ! On peut ainsi se délecter de la verve de l’auteur, qu’elle dénonce Freud ou qu’elle fasse l’apologie de Nietzsche, mais c’est du déjà-vu. Onfray ressasse, même s’il le fait avec art grâce au savoir, au sens de la formule, à l’ironie. Parfois aussi, trop visiblement, le décodage pictural devient prétexte à une « leçon », à propos des Anciens ou de Kant. Bien plus tonique est par exemple le commentaire sur Montaigne ou sur Sartre. Une nature morte de Philippe de Champaigne donne lieu, à propos de Port-Royal (l’abbaye des jansénistes détruite sur l’ordre de Louis XIV), à un véritable morceau de bravoure comme Onfray sait en écrire, car il s’y livre par le jeu des associations à une description « dynamique » du tableau et non pas « statique », comme en suscite habituellement ce genre littéraire.
Onfray aurait pu s’en tenir là mais il étire maintes fois l’observation pertinente et inattendue en un résumé – attendu celui-là – de la philosophie épicurienne quand ce n’est pas du marxisme. Ou sait d’abondance qu’il n’adhère pas au socialisme de Marx mais à celui de Proudhon… Et que dire de ses infatigables « déclarations de guerre au christianisme » ? Une fois encore Onfray ne peut résister à la tentation du didactisme. Dans cet ouvrage il se montre sous les différentes facettes d’un homme qui veut vivre selon la philosophie et qui l’affiche parfois trop ostensiblement. Il possède une intelligence aiguë et perspicace, une véritable passion de connaître, l’ingéniosité dans l’analyse, la connaissance approfondie des sujets, l’abondance et la maîtrise virtuose du langage. Il peut être indéniablement fort stimulant et, diraient les journalistes, « décapant ». Une fois encore dans cet ouvrage, il annonce ses couleurs sans ambiguïté mais on peut regretter qu’elles soient si souvent déployées.
1. Michel Onfray, Le crocodile d’Aristote, Albin Michel, Paris, 2019, 239 p. ; 39,95 $.
2. Voir Nuit blanche, numéro 157, hiver 2020.










