Né en 1945, Georges Leroux arrive à l’âge professionnel au moment où le Québec met la hache dans le cours classique qui l’a formé et s’étourdit momentanément dans les mouvances révolutionnaires. Cette charnière entre l’« humanisme » et la « modernité », cette jonction entre tradition religieuse et sécularisation imprégneront tout son parcours de penseur et de citoyen.
On ne se refait pas : Georges Leroux est un intellectuel. Ce qui le branche, ce sont les livres, l’étude, la philosophie. Rien ne le fascine autant qu’une bibliothèque, rien ne le motive autant qu’une commande de traduction du grec ancien. Très tôt dans sa vie, Georges Leroux sait qu’il est attiré par la vita contemplativa dont se méfie Hannah Arendt. Mais s’adonner à ce penchant n’est pas si simple, d’abord quand on a un père qui s’inquiète de subsistance matérielle et voudrait plutôt vous voir entreprendre des études en droit ou en médecine, et ensuite quand même les jésuites, à qui l’on se destine, vous privent de Platon pour vous imposer Saint-Ignace pendant votre noviciat.
« Contrairement à d’autres qui ont témoigné de leur amertume, je n’ai pas souffert de l’éducation religieuse qui a marqué mon enfance et je n’ai rien eu à subir qui aurait été oppressant », dit Georges Leroux dans la suite d’Entretiens1 accordés à son ex-élève et ami Christian Nadeau. N’empêche, si la vie monastique l’attire, il constatera bien vite que ce n’est pas ce à quoi il est destiné. S’ensuit une douloureuse remise en question, y compris quelques mois à la Faculté de médecine, jusqu’à ce qu’un bon ami l’amène à reconnaître sa vraie nature et à s’inscrire à l’Institut d’études médiévales, où il vivra quatre années « qui furent pour [lui] une forme de paradis ».
Mais ce n’est que partie remise : l’appel à la vita activa le frappe de nouveau de plein fouet lorsque, encore doctorant, il est recruté dans le corps professoral de la toute nouvelle Université du Québec à Montréal. On est à la fin des années 1960, après les bouillonnements et remises en question des revues Maintenant (dès 1962) et Parti pris (1963-1968) ; c’est l’âge de la mobilisation sociale, des revendications, des grèves et des manifestations. Bien que sympathique aux causes ainsi défendues, Georges Leroux n’a pas une âme de militant. « J’enviais ceux qui étaient engagés dans des groupes politiques […], mais je ne parvenais pas à m’y investir, j’étais tiraillé. […] j’y étais sans y être, un pied dedans, un pied dehors. » Pour autant, il a conscience d’avoir les deux pieds dans l’histoire, à la proue d’un navire cinglant dangereusement vers la table rase, et une de ses grandes préoccupations sera de veiller à ce que l’héritage humaniste et néothomiste de l’avant-Révolution tranquille ne soit pas entièrement balayé dans le programme de philosophie de l’UQAM. À son grand dam, l’étude du latin et du grec ancien disparaîtra, ce qui le prive du plaisir ineffable – voire l’empêche de satisfaire à l’impératif – de faire découvrir aux étudiants les classiques de l’Antiquité dans la langue originale. Mais au moins, le contenu résiste, et il en sera bien aise.
Il reste qu’après deux ans de turbulence (« Dans la même journée, je pouvais participer à un séminaire sur le néoplatonisme, me retrouver dans une assemblée syndicale houleuse, donner un cours sur Platon, aller dans des manifestations […] »), un exil à Paris pour poursuivre ses études auprès de Pierre Hadot représentera pour lui un havre de paix où il pourra s’abandonner lascivement à son penchant pour l’étude et la discussion philosophique. « Ce que j’aimais chez les maîtres et les amis que je fréquentais, ce n’était ni le Paris de Mai 68, qu’aucun d’eux n’évoquait jamais, ni ce qu’on a convenu d’appeler par la suite ‘la pensée 68’ […]. Non, j’aimais à Paris un monde réservé, quasi secret, qui entretenait certes quelques passerelles avec le structuralisme ambiant […], mais qui pour l’essentiel constituait le monde à part du néoplatonisme français. » À Paris, l’intellectuel est heureux. « Je me sentais bien loin des pédagogies nouvelles de l’UQAM et, pour tout dire, cette révolution me semblait, à distance, bien juvénile. »
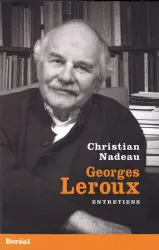 Il ne faudrait pas lire dans ce commentaire un désaveu de l’UQAM, où Georges Leroux retournera bien vite pour y mener toute sa carrière de professeur, alimenté par son admiration pour ses collègues et pour l’institution, « un milieu d’une incroyable richesse humaine »… stimulé entre autres par la rivalité avec l’Université de Montréal. « Alors qu’ils nous présentaient comme des concurrents imbus d’un marxisme toxique, nous n’étions au contraire que des camarades de recherche, et cette perspective de solidarité a mis du temps à s’imposer. […] C’est une légende urbaine : nous avons toujours été le département le moins marxiste de l’UQAM […]. »
Il ne faudrait pas lire dans ce commentaire un désaveu de l’UQAM, où Georges Leroux retournera bien vite pour y mener toute sa carrière de professeur, alimenté par son admiration pour ses collègues et pour l’institution, « un milieu d’une incroyable richesse humaine »… stimulé entre autres par la rivalité avec l’Université de Montréal. « Alors qu’ils nous présentaient comme des concurrents imbus d’un marxisme toxique, nous n’étions au contraire que des camarades de recherche, et cette perspective de solidarité a mis du temps à s’imposer. […] C’est une légende urbaine : nous avons toujours été le département le moins marxiste de l’UQAM […]. »
De la vita contemplativa à la vita activa…
Cela dit, quid de l’engagement dans la cité ? Les philosophes ne sont-ils, comme l’affirme Calliclès, que « des enfants qui se livrent à des activités sans importance » ? Derrière cette interrogation datant de l’ère socratique se profilent, encore et toujours, les réserves du père sur les choix de vie du fils. C’est surtout dans les années 1990 que celui-ci entrera plus activement dans la vie sociopolitique, ayant été invité par l’État à participer à la réflexion sur l’enseignement de l’éthique et de la culture religieuse. La question le préoccupe en effet : « La déconfessionnalisation a très tôt constitué pour moi un enjeu public vital : la lecture de Marcel Gauchet [entre autres, m’a] persuadé qu’il fallait tout faire pour combler dans nos écoles le vide créé par la sécularisation. Ce vide ne pouvait être rempli que par la culture et c’est en ce sens que je me suis engagé ».
La culture. Dans un monde réfractaire à une religion qui ne rebute pourtant pas le philosophe, il semble bien que ce soit le principal moyen pour lui de transmettre cette éducation humaniste qu’il chérit tant. Outre son travail pour la conception et la défense du cours d’éthique et de culture religieuse, c’est notamment par la radio qu’il passera pour diffuser cette culture. Sa participation régulière à l’émission Plus on est de fous, plus on lit ! est bien connue, mais on ne saurait passer sous silence ici les conditions dans lesquelles l’émission Passages, qu’il a amoureusement et passionnément conçue et animée avec Jean Larose, est abruptement mise au rancart après plusieurs années de diffusion (227 émissions), dans la foulée du sabordage de la Chaîne culturelle de Radio-Canada en 2004. C’est Sylvain Lafrance, vice-président de Radio-Canada, qui le fait venir dans son bureau et lui dit : « Vous savez, j’ai réécouté certaines émissions de Passages, et je voudrais vous dire, la langue est souvent trop sophistiquée, nous perdons notre public ». Lorsque Leroux lui demande un exemple, la réponse arrive : « L’autre jour, vous avez utilisé le mot cartésien, vous ne croyez pas que ce mot est trop savant ? » Pour le spécialiste de Plotin, la réponse est évidente.
Heureusement, si les pouvoirs publics mêmes sont réfractaires à la diffusion de cette culture, Georges Leroux aura toujours le plaisir de remplir sa mission auprès de ses étudiants. Des étudiants qui évoluent dans un cadre tout à fait différent de celui qui l’a vu se former, lui. Mais il ne faut pas oublier que dans les années 1970, on philosophait beaucoup. La pensée et la réflexion étaient à la mode, et même portées par la jeunesse. En chanson, c’était l’époque des Georges Brassens, Jacques Brel, Jean Ferrat et Léo Ferré. « Le divertissement n’avait pas encore pénétré la culture du Québec, les humoristes n’étaient pas encore une catégorie du monde ‘culturel’, il y avait encore une radio culturelle, on pouvait dire psychanalyse et ne pas faire rire de soi. »
Aujourd’hui, si la philosophie résiste toujours tant bien que mal aux assauts du public dans les cégeps, le monde universitaire a bien changé. « L’université n’est plus, et depuis longtemps, un lieu de communauté mais une organisation de recherche. […] Nous connaissons bien ce monde universitaire, mais ni Platon ni Marsile Ficin ne s’y reconnaîtraient. »
… dans la vita solitaria
Il y aura donc la radio, le contact avec les étudiants, la participation à la conception du cours d’éthique et de culture religieuse, mais dans ce panorama bien étoffé de la vie et de la pensée de Georges Leroux prenant la forme d’entretiens, l’âme de l’intellectuel plane et revient sans cesse. L’intellectuel peut-être un peu décalé, non pas mésadapté, loin de là, mais qui n’en aura jamais assez d’enrichir son esprit, et qui par là même reste toujours plus ou moins incompris de son entourage, sauf d’un cercle d’amis triés sur le volet. Que ce soit par le regard du père, par celui des compagnons d’école qui l’ostracisent – en compagnie de Daniel Pinard s’il vous plaît –, par des collègues militants qui aimeraient le voir plus convaincu sur une ligne de piquetage, et même par une Chaîne culturelle qui le trouve trop cultivé, un cercle vicieux s’installe où les livres, n’en déplaise à tous, demeurent un refuge. Pas d’amertume dans ce constat, mais une perplexité. « Y a-t-il dans nos vies un moment où la connaissance devient un handicap ? […] je n’ai jamais été certain de vouloir être un ‘érudit’, car j’y ai souvent perçu une forme de jugement négatif, mais je suppose que sur certains sujets, je le suis devenu par la force des choses. Le terme veut dire ‘dégrossi’, sorti des ‘rudesses’ brutes de l’ignorance, de l’inculture. » Il y a des mondes où les érudits doivent s’excuser d’être érudits, comme Chostakovitch devait s’excuser d’écrire une musique contemporaine sous le régime soviétique. Il y a bien de quoi faire du De vita solitaria de Pétrarque son livre de chevet.
1. Georges Leroux et Christian Nadeau, Entretiens, Boréal, Montréal, 2017, 359 p. ; 29,95 $.
EXTRAITS
Je ne souhaite pas confondre l’entreprise philosophique et l’engagement intellectuel, et malgré l’injonction de Hannah Arendt adressée aux philosophes, je pense qu’il est pleinement légitime, voire souvent nécessaire, qu’un philosophe demeure dans sa chambre toute sa vie. […] Certaines œuvres, comme certains tempéraments, exigent une grande solitude, une méditation continue.
p. 287
J’ai grandi et j’ai été formé dans la langue française, et je m’émerveille, chaque fois que je lis Descartes ou Merleau-Ponty, du fait qu’il s’agit de la langue qui m’a été donnée par ma naissance et à laquelle, comme nous tous, j’ai un accès direct, non filtré par la traduction.
p. 231
Je ne demande pas qu’on réamorce la croyance, je crois seulement nécessaire qu’on protège les significations essentielles à la poursuite de l’expérience humaine que les religions ont introduites dans la culture, qu’on en revitalise les références. La sécularisation ne peut pas avoir pour corollaire l’ignorance : elle doit conduire au contraire à la connaissance.
p. 337
Il me semble, personnellement, avoir été très tôt immunisé contre les clans dogmatiques, qu’il s’agisse du néothomisme ou du marxisme. Je ne supportais pas la tyrannie de la pensée unique, encore moins le pouvoir des orthodoxies.
p. 348
Je suis né, comme on dit, avec une cuiller d’argent dans la bouche, j’ai tout reçu sans avoir à me battre beaucoup pour l’obtenir, et quand je vois les conditions de tant d’étudiants, aux prises avec une situation qui les contraint souvent à ne pas poursuivre des projets d’études pour des raisons principalement économiques, je suis révolté.
p. 127










