L’épithète ne doit pas tromper : Sapiens. Une brève histoire de l’humanité1de Yuval Noah Harari ne verse ni dans la précipitation ni dans le résumé caricatural. Si l’ampleur du dessein fait paraître cette histoire brève, elle demeure nuancée dans ses jugements, libre de ses questionnements, inattendue par ses angles d’analyse, parfois provocante. Contrairement aux survols truffés de dates et de généraux, elle osera même s’interroger sur ce que l’évolution a pu apporter au bonheur humain.
Adam et ses collègues
Dès ses premières pages, Harari prive Adam de l’exclusivité. La Bible a beau enchaîner les générations, la Terre n’a pas toujours été peuplée de la descendance d’un seul couple. « Il y a 100 000 ans, au moins six espèces d’hommes arpentaient la Terre ». D’un trait de plus, l’auteur prend du recul : « Nous le verrons sous peu, nous, les Sapiens, avons de bonnes raisons de refouler le souvenir de nos frères et sœurs ».
Non seulement Adam eut des émules, mais ce ne serait pas à cause d’un cerveau particulièrement volumineux qu’il parvint à dominer la Terre. À preuve, la possession d’un tel organe n’empêcha pas l’homme de demeurer pendant des millions d’années « au beau milieu de la chaîne alimentaire », pourchassant les petits animaux et fuyant devant les puissants prédateurs. La surprise, c’est que l’homme ait réussi, en quelques courtes (!) centaines de milliers d’années, à se hisser « au sommet de la chaîne alimentaire ».
Dans ce « bond spectaculaire » de l’espèce humaine, le feu sert d’allié déterminant. Sa possession vaut à l’homme lumière et chaleur, mais aussi une cuisine diversifiée et enfin libérée des germes et parasites meurtriers ; sa domestication lui permet d’opposer aux grands prédateurs un rideau redoutable. On n’a pas expliqué pour autant la domination exercée par l’Homo sapiens sur des homologues humains comme l’homme de Néandertal. Harari, sans conclusion péremptoire, incline à croire que le Sapiens a été servi par sa soif de socialisation : en mal d’échanges avec ses semblables, il aurait tiré de ses tâtonnements verbaux de quoi fonder une supériorité. « On pourrait croire à une plaisanterie, mais de nombreuses études corroborent cette théorie du commérage. » Fort de cette hypothèse, l’auteur entrevoit l’importance de la fiction : « Or, c’est la fiction qui nous a permis d’imaginer des choses, mais aussi de le faire collectivement ». Révolution marquante, car Sapiens n’aurait pu sans elle réunir des milliers, puis des millions d’individus : « Toute coopération humaine à grande échelle […] s’enracine dans des mythes communs qui n’existent que dans l’imagination collective ».
Sapiens en serial killer ?
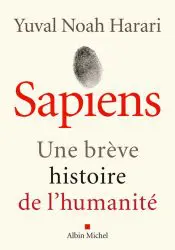 Cette aptitude à ordonner la vie de milliers d’individus aurait ouvert à Sapiens la voie du pouvoir. À la chasse hasardeuse des groupuscules, il substitua d’amples coordinations. Sapiens put survivre aux froids nordiques, atteindre l’Australie, éliminer concurrents et prédateurs. « Aucun autre animal n’avait jamais investi aussi rapidement une telle diversité d’habitats radicalement différents – et ce, en utilisant partout quasiment les mêmes gènes. » Bilan ? « […] la première vague de colonisation de Sapiens a été l’une des catastrophes écologiques les plus amples et les plus rapides qui se soient abattues sur le règne animal. »
Cette aptitude à ordonner la vie de milliers d’individus aurait ouvert à Sapiens la voie du pouvoir. À la chasse hasardeuse des groupuscules, il substitua d’amples coordinations. Sapiens put survivre aux froids nordiques, atteindre l’Australie, éliminer concurrents et prédateurs. « Aucun autre animal n’avait jamais investi aussi rapidement une telle diversité d’habitats radicalement différents – et ce, en utilisant partout quasiment les mêmes gènes. » Bilan ? « […] la première vague de colonisation de Sapiens a été l’une des catastrophes écologiques les plus amples et les plus rapides qui se soient abattues sur le règne animal. »
Car la révolution agricole qui suivit fut, affirme Harari, « la plus grande escroquerie de l’histoire ». Les coupables ? « […] une poignée d’espèces végétales, dont le blé, le riz et les pommes de terre. Ce sont ces plantes qui domestiquèrent l’Homo sapiens, plutôt que l’inverse. » Par rapport aux animaux d’élevage, le Sapiens fut tyrannique : « Dans le cas du bétail, du mouton et du Sapiens, c’est-à-dire d’animaux qui ont tous un monde complexe de sensations et d’émotions, il nous faut examiner comment le succès de l’évolution se traduit en expérience individuelle ».
Drame plus que succès, aggravé peut-être par l’invention de l’écriture.
Un monde imaginaire
L’écriture, selon Harari, « a progressivement changé la façon dont les hommes pensent et voient le monde ». Pour le mieux, dira-t-on spontanément ! L’auteur n’en est pas si assuré. « À sa naissance, l’écriture était la servante de la conscience humaine ; de plus en plus, elle en est la maîtresse. » Ses réserves imitent celles de Lévi-Strauss2 : « Une des phases les plus créatrices de l’histoire de l’humanité se place pendant l’avènement du néolithique : responsable de l’agriculture, de la domestication des animaux et d’autres arts. […] Au néolithique, l’humanité a accompli des pas de géant sans le secours de l’écriture ; avec elle, les civilisations historiques de l’Occident ont longuement stagné ». De quoi susciter l’étonnement…
Lévi-Strauss et Harari aboutissent ainsi au même questionnement. Lévi-Strauss se montre sévère : « Si mon hypothèse est exacte, il faut admettre que la fonction primaire de la communication écrite est de faciliter l’asservissement3». Dans ce rôle, écrit Harari de son côté, l’écriture peut compter sur l’apport décisif d’un monde imaginaire peuplé de mythes acceptés par les collectivités. C’est grâce à ces mythes (ou à cause d’eux) que l’humanité s’unifie, que l’argent impose sa loi, que se musclent empires politiques et orthodoxies cléricales. Selon lui, les peuples gobent les mythes, même les plus mal étayés.
Ainsi en est-il du fanatisme religieux qui fausse la lecture des faits : « Plus de chrétiens moururent de la main d’autres chrétiens au cours de ces vingt-quatre heures [de la Saint-Barthélemy] que sous l’Empire romain polythéiste tout au long de son existence ». Même le monothéisme dont se targuent plusieurs des religions les plus répandues confine au syncrétisme : « En fait, tel qu’il s’est manifesté dans l’histoire, le monothéisme est un kaléidoscope d’héritages monothéiste, polythéiste et animiste qui ne cessent de se mélanger sous une même ombrelle ». L’intolérance à visée ethnique sévit aussi : « L’évolution a fait de l’Homo sapiens, comme des autres mammifères sociaux, une créature xénophobe. Sapiens divise d’instinct l’humanité en deux : ‘Nous’ et ‘Eux’. Nous, c’est vous et moi, qui partageons langue, religion et usages ».
Mais l’Europe ?
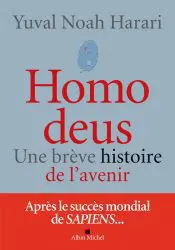 Une question surnage : « Comment la population de cette pointe glacée de l’Eurasie réussit-elle à s’extraire de son angle lointain de la planète et à conquérir le monde entier ? » Harari se borne à suggérer des pistes. La domination européenne « reposa dans une large mesure sur le complexe militaro-scientifico-industriel et la sorcellerie technique ». Voilà qui laisse le lecteur sur sa fringale : pourquoi, insistera-t-il, est-ce en Europe que ces caractéristiques sont apparues ? Sur ce front, Harari louvoie. D’une part, dit-il, les immenses empires asiatiques ne s’intéressaient pas au reste de l’univers ; ils laissèrent l’Europe l’emporter par défaut. D’autre part, l’Europe osa toutes les explorations « dans l’espoir d’obtenir de nouvelles connaissances en même temps que de nouveaux territoires ». Science et empire marchèrent main dans la main sans que l’auteur dise pourquoi.
Une question surnage : « Comment la population de cette pointe glacée de l’Eurasie réussit-elle à s’extraire de son angle lointain de la planète et à conquérir le monde entier ? » Harari se borne à suggérer des pistes. La domination européenne « reposa dans une large mesure sur le complexe militaro-scientifico-industriel et la sorcellerie technique ». Voilà qui laisse le lecteur sur sa fringale : pourquoi, insistera-t-il, est-ce en Europe que ces caractéristiques sont apparues ? Sur ce front, Harari louvoie. D’une part, dit-il, les immenses empires asiatiques ne s’intéressaient pas au reste de l’univers ; ils laissèrent l’Europe l’emporter par défaut. D’autre part, l’Europe osa toutes les explorations « dans l’espoir d’obtenir de nouvelles connaissances en même temps que de nouveaux territoires ». Science et empire marchèrent main dans la main sans que l’auteur dise pourquoi.
Une affirmation chère à Harari semble pourtant se confirmer, malgré ce raisonnement en boucle : les mythes influent sur l’évolution de l’humanité plus que tout autre facteur. Mythe moteur, l’éthique capitaliste répandue par Adam Smith expliquerait la soudaine émergence de l’Europe : « Dans le nouveau credo capitaliste, c’est le premier commandement, le plus sacré : ‘Tu réinvestiras les profits de la production pour augmenter la production’ ». Investir et non pas amasser. Ainsi s’expliquerait que l’Empire hollandais ait pu évincer Madrid : « Le roi d’Espagne a dilapidé le capital de confiance des investisseurs au moment même où les marchands hollandais gagnaient leur confiance ». La science, nouveau mythe, a ensuite emporté l’humanité.
Et le bonheur ?
L’histoire de l’humanité, dans le récit des spécialistes, en dit peu sur le bonheur. Harari a le mérite d’y consacrer ses derniers chapitres. Une fois encore, il offre des observations respectables, mais s’abstient de conclure. « […] on ne saurait exclure la possibilité que l’immense amélioration des conditions matérielles au cours des deux derniers siècles ait été annulée par l’effondrement de la famille et de la communauté. »
En marge de ce propos lénifiant, l’auteur étonne son lecteur en affirmant que l’humanité a fait un pas de géant en parvenant enfin à la paix. Rien de moins ! La guerre tuerait moins de nos jours. « L’humanité a aujourd’hui brisé cette loi de la jungle. Règne enfin une paix véritable, qui n’est pas simple absence de guerre. Dans la plupart des régimes, il n’est pas de scénario envisageable menant à un conflit de grande ampleur dans l’année. » On aimerait partager cet optimisme, mais comment oublier les fabricants d’armes et le complexe militaro-industriel que redoutait Eisenhower ? Comment oublier que les mythes chers à Harari militent en faveur de la guerre ? En effet, en diabolisant Moscou ou al-Assad, n’entretient-on pas dans le psychisme collectif un mythe guerrier toujours revigoré ?
Reste que Harari maîtrise l’art utile de déboulonner les certitudes.
1. Yuval Noah Harari, Sapiens. Une brève histoire de l’humanité, trad. de l’anglais par Pierre-Emmanuel Dauzat, Albin Michel, Paris, 2015, 509 p. ; 36,95 $.
2. Claude Lévi-Strauss, Tristes tropiques, Plon, « 10/18 », 1955, p. 265.
3. Ibid., p. 266.
EXTRAITS
Le voyage des premiers humains vers l’Australie est l’un des événements les plus importants de l’histoire, au moins aussi important que le voyage de Christophe Colomb vers l’Amérique ou l’expédition d’Apollo 11 vers la Lune. [L]e moment où l’Homo sapiens se hissa à l’échelon supérieur de la chaîne alimentaire et sur un bloc continental particulier, puis devint l’espèce la plus redoutable dans les annales de la planète Terre.
p. 85
Du point de vue du troupeau, plutôt que de celui du berger, il est pourtant difficile de se défaire de cette impression : pour l’immense majorité des animaux domestiqués, la Révolution agricole a été une terrible catastrophe. Leur « réussite » en termes d’évolution n’a aucun sens.
p. 122
Il apparut que les mythes étaient plus forts qu’on aurait pu l’imaginer. Quand la Révolution agricole ouvrit la possibilité de créer des villes très peuplées et de puissants empires, les gens inventèrent des histoires de grands dieux, des mères patries et des sociétés par actions pour assurer les liens sociaux nécessaires.
p. 131
En 1775, l’Asie représentait 80 % de l’économie mondiale. Les économies combinées de l’Inde et de la Chine représentaient à elles seules les deux tiers de la production mondiale. En comparaison, l’Europe était un nain économique.
p. 328
La littérature romantique décrit souvent un individu pris dans le conflit qui oppose l’État et le marché. Rien ne saurait être plus éloigné de la vérité. L’État et le marché sont la mère et le père de l’individu, et l’individu ne peut survivre que grâce à eux.
p. 421











