Le troisième roman de l’écrivaine des bois réconcilie le vieil humaniste en moi avec Anouk Baumstark, la femme renarde, personnage central de récits profondément engagés envers l’environnement. Retour sur la trilogie du Kamouraska.
Les romans Encabanée1, Sauvagines2 et Bivouac3 sont nés dans la foulée d’un geste radical, marquant à la fois une rupture et une réconciliation. L’impulsion première de cette palpitante trilogie romanesque n’était pas pour Gabrielle Filteau-Chiba le désir d’écrire, mais bien le désir de rompre avec un mode de vie axé sur la compétitivité et la performance pour se rapprocher de la nature. Ce faisant, la « fille de la ville » (Encabanée) allait conforter la part d’elle-même en communion avec le monde sauvage et donner un sens nouveau à sa vie en se portant à la défense de l’environnement.
Les trois romans sont dotés de leurs propres conclusions et peuvent être lus comme des récits autonomes. Les considérer dans leur suite logique apporte toutefois un supplément de sens à chacun, en tant que moment d’une quête d’authenticité et de pertinence des gestes posés en faveur d’un monde plus en symbiose avec la nature.
Seule (ou presque) au fond des bois
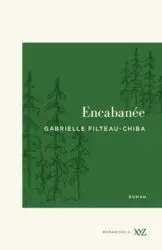 Le premier volet de la trilogie, Encabanée, est fortement inspiré de l’expérience vécue par l’autrice, lors d’un premier hiver passé en solitaire, dans une cabane mal isolée en pleine forêt du Kamouraska. On y partage avec Anouk Baumstark, personnage central des trois romans, une plongée en elle-même et dans la beauté rude des hivers de l’est du Québec. Entre ses ruminations et l’éternel recommencement des tâches quotidiennes pour assurer sa survie, la jeune femme se met naturellement à écrire un journal.
Le premier volet de la trilogie, Encabanée, est fortement inspiré de l’expérience vécue par l’autrice, lors d’un premier hiver passé en solitaire, dans une cabane mal isolée en pleine forêt du Kamouraska. On y partage avec Anouk Baumstark, personnage central des trois romans, une plongée en elle-même et dans la beauté rude des hivers de l’est du Québec. Entre ses ruminations et l’éternel recommencement des tâches quotidiennes pour assurer sa survie, la jeune femme se met naturellement à écrire un journal.
« Cher journal, [j]e me sens seule en chien, mais j’ai trouvé mon Nord. » Anouk couche sur le papier ses réflexions, lit Anne Hébert, Gilles Vigneault et Pierre Falardeau. Au passage, tout en recourant à la « Marie-Jeanne » pour oublier la morsure du froid, elle esquisse sa conception du « féminisme rural », selon laquelle l’épanouissement ne se trouve pas dans la course à la réussite personnelle, conformément aux critères d’une société productiviste, mais plutôt dans la recherche d’un lien plus organique avec la terre nourricière. « Incarner la femme au foyer au sein d’une forêt glaciale demeure, pour moi, l’acte le plus féministe que je puisse commettre, car c’est suivre mon instinct de femelle et me dessiner dans la neige et l’encre les étapes de mon affranchissement. »
Finalement, après qu’elle eut souhaité le miracle qui viendrait réchauffer son corps, « Merci à ma bonne étoile de m’envoyer au plus sacrant soit le printemps, soit un amant », une visite inattendue viendra perturber la tranquillité de l’ermite. Ce premier épisode, marqué par la solitude contemplative, aura une suite plus mouvementée.
Amour et vengeance
Avec Sauvagines, deuxième roman de la série, un important adjuvant de l’action est incarné par le personnage de Raphaëlle Robichaud. Consciencieuse agente de protection de la faune, celle-ci finira par avoir la rage au ventre devant l’arrogance des braconniers, ces « armoires à glace qui ne chassent que pour le plaisir de dominer, de détruire ».
La garde-chasse à la longue tresse noire vit seule avec sa jeune chienne dans une roulotte, quelque part sur les terres publiques du Haut-Kamouraska. Il n’y a pas que les ours qui tournent autour de la roulotte. Il semble qu’un prédateur humain surveille les allées et venues, et les activités intimes, de la belle Raphaëlle. Il s’agit peut-être du trappeur dont elle a bousillé les pièges en pagaille, dans l’un desquels sa chienne s’était infligé d’importantes blessures.
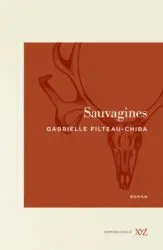 Au village, on remet à Raphaëlle, croyant qu’il lui appartient, un carnet rempli de notes manuscrites et de dessins. C’est en fait le journal d’Anouk Baumstark, point de départ de la relation amoureuse entre les deux marginales. Autre allié de la garde-chasse, celui-là de longue date, Lionel, ex-collègue aujourd’hui retraité, mentor et père substitut. Tous trois mènent l’enquête et bientôt plusieurs indices les amènent à suspecter un homme de la région d’être à la fois le braconnier hyperactif, le voyeur aux trousses de Raphaëlle et le responsable de la disparition d’une jeune femme il y a plusieurs années, un crime non résolu. De suspect à coupable, le pas est facilement franchi. À ce moment du récit, je ne marche plus, je ne comprends plus.
Au village, on remet à Raphaëlle, croyant qu’il lui appartient, un carnet rempli de notes manuscrites et de dessins. C’est en fait le journal d’Anouk Baumstark, point de départ de la relation amoureuse entre les deux marginales. Autre allié de la garde-chasse, celui-là de longue date, Lionel, ex-collègue aujourd’hui retraité, mentor et père substitut. Tous trois mènent l’enquête et bientôt plusieurs indices les amènent à suspecter un homme de la région d’être à la fois le braconnier hyperactif, le voyeur aux trousses de Raphaëlle et le responsable de la disparition d’une jeune femme il y a plusieurs années, un crime non résolu. De suspect à coupable, le pas est facilement franchi. À ce moment du récit, je ne marche plus, je ne comprends plus.
Entendons-nous bien. Nous ne sommes pas ici dans la fantaisie, ou la caricature; l’univers campé dans Sauvagines est plausible. L’autrice est réputée mettre de l’avant ses convictions dans ses romans, alors je la prends au mot. La mise à mort d’un homme, aussi antipathique soit-il, par des personnages présentés comme équilibrés, aux valeurs admirables, revient à faire la promotion du meurtre. D’autant plus que les trois complices n’ont pas la preuve définitive de la culpabilité de leur victime. Leur tribunal improvisé condamne sur la foi de présomptions et leur justice est illégitime. Les trois larrons n’ont d’ailleurs aucun regret. Le vieux Lionel annonçant aux filles la mort du trappeur qualifiera leur acte de « devoir accompli ». Raphaëlle, une fois la sentence exécutée, se dira rassurée pour les animaux désormais libérés d’une menace. Quant à Anouk, elle offre à son amante une inconditionnelle complicité. Tout cela est bien sûr permis dans une œuvre de fiction et, d’ailleurs, on doit reconnaître en Sauvagines le roman le plus accompli de Filteau-Chiba sur le plan narratif. Néanmoins, mon sens de l’éthique en est froissé.
Vent et tempête
La trilogie du Kamouraska se conclut avec Bivouac, dont le dénouement ambivalent est malgré tout porteur d’espoir. Nous retrouvons ici Riopelle, un militant environnementaliste apparu dans Encabanée alors qu’il avait la police aux trousses. Le sabotage auquel il avait participé était bien intentionné, toutes les précautions avaient été prises pour éviter de mettre quiconque en danger, mais un conducteur de train avait malencontreusement perdu la vie. Le lecteur apprend dès les premières pages du roman que l’activiste en éprouve du remords. Tout un contraste avec le sentiment de soulagement exprimé par les auteurs de l’acte de vengeance perpétré dans Sauvagines. Dès ce moment, je suis rassuré sur le respect de Gabrielle Filteau-Chiba pour la vie humaine. Et je ne serai pas déçu par la suite du roman.
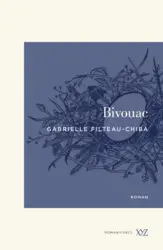 Tout en me disant qu’il s’agit d’une interprétation parmi d’autres, je vois dans le cheminement d’Anouk Baumstark une transposition des réflexions de l’autrice sur son propre engagement à l’endroit de l’environnement. D’abord recluse et solitaire, Anouk goûte la vie à deux auprès de Raphaëlle, puis se joint avec sa compagne à une commune agricole où la vie en quasi-autarcie montre rapidement ses limites. Le rapprochement avec Riopelle, l’écolo radical, entraînera la renarde dans l’action collective et lui fera apprécier les vertus de la solidarité. Elle se joindra avec enthousiasme à l’occupation pacifique d’une forêt menacée de coupe à blanc, entourée de ses deux amours, entre lesquels elle ne veut pas choisir. Un événement dramatique inattendu choisira pour elle. Ainsi, l’engagement d’Anouk Baumstark évolue au rythme des rencontres et des expériences vécues. Dans ses propos comme dans ceux de Riopelle, émerge une conscience de plus en plus aiguë de la nécessité de protéger la planète, non pour elle-même, mais en tant que milieu de vie de l’espèce humaine.
Tout en me disant qu’il s’agit d’une interprétation parmi d’autres, je vois dans le cheminement d’Anouk Baumstark une transposition des réflexions de l’autrice sur son propre engagement à l’endroit de l’environnement. D’abord recluse et solitaire, Anouk goûte la vie à deux auprès de Raphaëlle, puis se joint avec sa compagne à une commune agricole où la vie en quasi-autarcie montre rapidement ses limites. Le rapprochement avec Riopelle, l’écolo radical, entraînera la renarde dans l’action collective et lui fera apprécier les vertus de la solidarité. Elle se joindra avec enthousiasme à l’occupation pacifique d’une forêt menacée de coupe à blanc, entourée de ses deux amours, entre lesquels elle ne veut pas choisir. Un événement dramatique inattendu choisira pour elle. Ainsi, l’engagement d’Anouk Baumstark évolue au rythme des rencontres et des expériences vécues. Dans ses propos comme dans ceux de Riopelle, émerge une conscience de plus en plus aiguë de la nécessité de protéger la planète, non pour elle-même, mais en tant que milieu de vie de l’espèce humaine.
Un art du roman utopiste sans complexe
Dans plusieurs de ses déclarations publiques suivant la publication de ses romans, Gabrielle Filteau-Chiba se dit écrivaine et militante. En affirmant accorder davantage d’importance à l’avancement de la conscience environnementale qu’à la littérature en soi, elle adopte une posture généralement mal vue dans le monde des lettres. Un grand nombre de critiques littéraires se réclament en effet de la formule de Milan Kundera selon laquelle le roman est un « art inspiré par le rire de Dieu4 », c’est-à-dire un art où il serait inconvenant de promouvoir une cause. Kundera a beau être un romancier génial, cela ne l’empêche pas de proférer quelques inepties dans ses essais. Entre autres, dans Le rideau, il prétend que le véritable romancier ne peut offrir au lecteur que sa désolation, jamais de réconfort : « La seule chose qui nous reste face à cette inéluctable défaite qu’on appelle la vie est d’essayer de la comprendre. C’est là la raison d’être de l’art du roman5 ».
Cette tendance à refuser au romancier la liberté de l’engagement est repérable sous des formes plus ou moins subtiles. Par exemple, on a pu lire dans la presse écrite québécoise, sur Encabanée : « [S]on trop court premier roman pouvait par moments sembler surchargé par ses revendications pamphlétaires6 ». Et à propos de Sauvagines : « Le jupon de l’autrice dépasse dans cette charge à fond de train, cette révolte qui se redit, encore et encore, et qui alourdit par moments le récit7». Là où certains voient de la lourdeur et de la surcharge, je ne suis sûrement pas le seul à ressentir une émotion jubilatoire.
Dans son essai Professeurs de désespoir8, Nancy Huston a caractérisé de manière éclairante deux tendances majeures de la pensée chez les littérateurs des deux derniers siècles : l’utopisme et le nihilisme. L’écrivaine renvoie dos à dos les deux attitudes, en tant que pôles extrêmes, au motif que la première considère le meilleur des mondes à portée de main et que la seconde prédit l’échec de toute tentative de déjouer le destin tragique du genre humain. Milan Kundera, bien ancré dans le nihilisme et le cynisme (en raison en bonne partie d’un engagement politique de jeunesse qui a mal tourné, selon Huston), érige son attitude en dogme en décrétant que le roman au service d’une cause n’est pas un roman véritable. Or, les choses ne sont pas aussi simples. Huston, en conclusion de son essai, affirme que l’on n’a pas à se laisser enfermer dans l’opposition entre idéalisme et désespoir et que, en fin de compte, la vie est simplement ce que les gens en font. Il en va de même en littérature. Le roman est ce que les romanciers en font. Et il faut célébrer la détermination de Gabrielle Filteau-Chiba à se servir du pouvoir évocateur du roman pour éveiller les consciences.
1. Gabrielle Filteau-Chiba, Encabanée, XYZ, Montréal, 2018, 92 p. ; 18,95 $.
2. Gabrielle Filteau-Chiba, Sauvagines, XYZ, Montréal, 2019, 320 p. ; 24,95 $.
3. Gabrielle Filteau-Chiba, Bivouac, XYZ, Montréal, 2020, 286 p. ; 26,95 $.
4. Milan Kundera, L’art du roman, Gallimard, Paris, 1986.
5. Milan Kundera, Le rideau, Gallimard, Paris, 2005.
6. Anne-Frédérique Hébert-Dolbec, « ‘Sauvagines’ : longue vie aux hurlements des coyotes », Le Devoir, 19 octobre 2019, <https://www.ledevoir.com/non-classe/564997/fiction-quebecoise-sauvagines-longue-vie-aux-hurlements-des-coyotes>.
7. Iris Gagnon-Paradis, « Sauvagines : à la défense du territoire », La Presse, 17 octobre 2019, <https://www.lapresse.ca/arts/litterature/2019-10-17/sauvagines-a-la-defense-du-territoire>.
8. Nancy Huston, Professeurs de désespoir, Actes Sud/ Leméac, Arles et Montréal, 2004.
EXTRAITS
Chaque kilomètre qui m’éloigne de Montréal est un pas de plus dans le pèlerinage vers la seule cathédrale qui m’inspire la foi, une profonde forêt qui abrite toutes mes confessions.
Encabanée, p. 13.
Me confronter à moi-même en toute nudité, sans les mirages d’une vie axée sur la productivité et les apparences.
Encabanée, p. 32.
Mission du jour, tenter de nouveau de percer la glace qui recouvre la rivière, car il me faut six chaudières de neige fondue pour en emplir une seule d’eau. Coup sur coup, je trancherai cette rivière jusqu’à son lit. La hache est lourde, et les éclisses de glace bleutée voltigent à chaque impact.
Encabanée, p. 40-41.
Je me botte hors des couvertes, me lève pour aérer la roulotte. Marche en m’étirant les bras sous une bruine fraîche. Fais pipi sur un lit de lichens, m’essuie le minou de sphaigne aux caribous. Me sens dans mon élément.
Sauvagines, p. 30.
Tu sais, Anouk, ce que j’ai fait, ce n’était pas un coup de tête, ni une décision prise à la légère. Cet homme-là était un danger public. On ne peut pas être hantées par les remords si on est en paix avec l’idée que la Nature est mieux sans lui, non ?
Sauvagines, p. 299-300.
Des oies tombent des cieux. On nous blâmera pour le feu. Ma chienne court plus vite que le vent, ouvre la voie des siens jusqu’au lac Kijemquispam. Les chevreuils courent, transportent des écureuils sur leurs bois, les orignaux s’élancent, tout empanachés de petits orphelins, les lynx portent leurs petits dans leur bouche, les coyotes se jettent à l’eau, nagent pour sauver leur peau.
Bivouac, p. 313-314.
Comme les humains, les arbres isolés n’ont pas grand chance de survie. La résilience du bois vient avec la force du nombre, la prise de ses racines entortillées à une société de semblables.
Bivouac, p. 363.
La planète continuera de tourner, et nous, de nous mobiliser. Parce que si nous prenons soin de la Nature, elle prendra soin de nous.
Bivouac, p. 369.











