Aujourd’hui, ce sont Olivier Duhamel, Richard Berry, Peter Nygård. Hier, Gabriel Matzneff, Jeffrey Epstein, Bertrand Charest, R. Kelly. D’autres. Ce que ces hommes souvent connus, toujours influents, ont en commun est une accusation ou une condamnation pour pédocriminalité. Trois femmes témoignent de leur histoire respective.
L’Hexagone vit désormais à l’heure avancée de l’Amérique, et son rattrapage est fulgurant. Trois ans après la fin de la récréation pour les agresseurs sexuels aux États-Unis et au Canada, après un trop bref et controversé #BalanceTonPorc, les langues se délient en France, les dénonciations surgissent de partout, des livres ébranlent les colonnes du temple du pouvoir masculin. Au cœur de la tourmente, les mondes littéraire et politique sont mis à mal. L’époque complaisante des Frédéric Mitterrand, Jack Lang et autres apôtres qui ont promu la « pédophilie » sans vergogne aucune prend du plomb dans l’aile. Si ce phénomène de marketing du sexe avec les enfants n’a pas existé au Québec, la pédocriminalité, certes plus cachée, y est tout aussi répandue. C’est pourquoi les ouvrages de Vanessa Springora1, Camille Kouchner2 et Eve Ensler3 ont un large écho dans notre société.
Pour bien saisir la nature de ce changement majeur, faisons appel à l’étymologie. Pédophilie, dérivé des mots grecs paîs (enfant) et philía (ami), devrait désigner l’amitié ou l’amour envers les enfants. Or, comme l’observait la philosophe Annie Leclerc, le mot pédophilie efface toute allusion à l’amour des enfants, et n’exprime plus que le sexe. D’où la nécessité de remplacer ce faux-ami par pédocriminalité. Le terme fait son chemin.
L’emprise, la déprise, l’empreinte
 Les consciences françaises ont d’abord émergé de leur léthargie en lisant Vanessa Springora, dont l’histoire délétère avec un célèbre écrivain cinquantenaire s’amorce au début de son adolescence. Le consentement, récit finement ciselé, relate le trajet qui débute dans l’euphorie et se termine en un cauchemar sisyphéen. Entre l’emprise et la déprise, il y aura un moment de flottement. Springora confie que, malgré son désarroi, elle n’a pas perdu tout sens commun. En outrepassant l’interdiction formelle de lire les carnets noirs de celui qu’elle identifie par l’initiale G., elle reçoit une giclée de réalité. À Manille, y relate-t-il, « [l]es petits garçons de onze ou douze ans que je mets ici dans mon lit sont un piment rare ». L’ogre est démasqué. L’adolescente découvre la quête effrénée et insatiable de « culs frais » de Gabriel Matzneff. Prise de nausée, V., comme elle se nomme, comprend que, sous la plume de son aîné de 36 ans, elle deviendra le « support masturbatoire » de pédolecteurs.
Les consciences françaises ont d’abord émergé de leur léthargie en lisant Vanessa Springora, dont l’histoire délétère avec un célèbre écrivain cinquantenaire s’amorce au début de son adolescence. Le consentement, récit finement ciselé, relate le trajet qui débute dans l’euphorie et se termine en un cauchemar sisyphéen. Entre l’emprise et la déprise, il y aura un moment de flottement. Springora confie que, malgré son désarroi, elle n’a pas perdu tout sens commun. En outrepassant l’interdiction formelle de lire les carnets noirs de celui qu’elle identifie par l’initiale G., elle reçoit une giclée de réalité. À Manille, y relate-t-il, « [l]es petits garçons de onze ou douze ans que je mets ici dans mon lit sont un piment rare ». L’ogre est démasqué. L’adolescente découvre la quête effrénée et insatiable de « culs frais » de Gabriel Matzneff. Prise de nausée, V., comme elle se nomme, comprend que, sous la plume de son aîné de 36 ans, elle deviendra le « support masturbatoire » de pédolecteurs.
La voile du bateau piloté par G. faseye. Springora raconte avec sobriété et dans une écriture fluide la vie après la déprise. Réduite à une boule de rage, elle sombre dès lors dans des états dépressifs, se convainc qu’elle est seule responsable de cette dérive, finit par croire qu’elle mérite la mort. Elle va de loin en loin au lycée, car se « refaire une virginité à 16 ans » ne tombe pas sous le sens, puis connaît des épisodes psychotiques. Quand le désir-piège marque le point de départ d’une vie sentimentale, l’avenir part en vrille. Plus tard, Springora choisit de feindre d’aimer faire l’amour, pour changer ensuite de stratégie en avouant la vérité au nouvel amant. « Chaque fois, la révélation se soldera par une rupture. » Elle laisse tomber : « Personne n’aime les jouets cassés ».
Des hommes blessent des hommes
La forme la plus sévère de pédocriminalité est à n’en pas douter l’inceste. Un an après la vague déferlante du Consentement, une autre s’élève avec autant de vigueur. Cette fois, c’est l’inceste vécu par un garçon de quatorze ans, raconté par sa sœur jumelle. Ces jumeaux sont les enfants de Bernard Kouchner, cofondateur de Médecins sans frontières et ancien ministre des gouvernements de Mitterrand, Chirac et Sarkozy. Le beau-père mis en cause, l’influent constitutionnaliste Olivier Duhamel, a occupé les plus hautes fonctions jusqu’à sa démission récente de l’ensemble de celles-ci.
Quarante ans plus tôt, sous l’étendard d’une gauche libertaire, La familia grande, érigée sur le noyau d’un couple reconstitué (Olivier Duhamel et Évelyne Pizier) et d’enfants biologiques et adoptifs, s’agrandit d’une joyeuse compagnie d’intellos dans son refuge de villégiature à Sanary-sur-Mer. De bric et de broc, la communauté bigarrée vit au rythme de la libération sexuelle. « Le rituel a très vite été institué. Tous les étés : des parents hilares et des enfants fous de liberté. » Camille Kouchner recrée avec maestria le drame délictuel qui se trame, étouffé dans une atmosphère pleine d’intelligence et d’humour. Le volcan couve pendant des décennies.
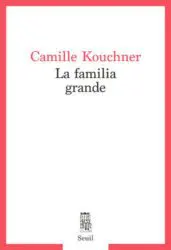 La parole de Camille Kouchner, qui expose l’intime trahi, appelle celle des hommes qui, à leur tour, dévoilent leurs blessures. En résonance avec le scandale Duhamel, pour ne donner qu’un exemple, Bruno Questel, député à l’Assemblée nationale française, violé à onze ans par un voisin, déclare quarante ans après les faits : « J’ai été broyé ». L’hémorragie n’en finit plus. Après #MeTooInceste se crée #MeTooAmnesie. En moins de vingt-quatre heures, le mot-dièse #SciencesPorcs est utilisé plus de douze mille fois sur Twitter. Le climat social est chamboulé. Guillaume T., l’instigateur de #MeTooGay, est retrouvé pendu moins d’un mois après avoir dénoncé le conseiller à la mairie de Paris Maxime Cochard.
La parole de Camille Kouchner, qui expose l’intime trahi, appelle celle des hommes qui, à leur tour, dévoilent leurs blessures. En résonance avec le scandale Duhamel, pour ne donner qu’un exemple, Bruno Questel, député à l’Assemblée nationale française, violé à onze ans par un voisin, déclare quarante ans après les faits : « J’ai été broyé ». L’hémorragie n’en finit plus. Après #MeTooInceste se crée #MeTooAmnesie. En moins de vingt-quatre heures, le mot-dièse #SciencesPorcs est utilisé plus de douze mille fois sur Twitter. Le climat social est chamboulé. Guillaume T., l’instigateur de #MeTooGay, est retrouvé pendu moins d’un mois après avoir dénoncé le conseiller à la mairie de Paris Maxime Cochard.
Le père, l’ultime attentat
Quand un père vole le destin de sa fille de cinq ans, il plonge sa vie dans le chaos absolu. Par sa brutalité, l’ange de tendresse qui savourait la vie se métamorphose en adolescente suicidaire. Le mal déchire le tissu psychique. « J’ai trahi ta confiance. J’ai corrompu ta sexualité et les mécanismes de ton désir. La perversion et l’excitation seront toujours liées pour toi. J’ai déposé ma souillure. J’ai laissé ma marque fétide. Je t’ai infectée. En envahissant et en submergeant ton corps, j’ai tué ton envie. »
Dans cette autopsie de la conscience du père, l’architecture des mots d’Eve Ensler ne construit pas une chronique ou une autobiographie, ni un témoignage. Œuvre de création trempée dans le sang d’une vérité sauvage, Pardon est une plongée en apnée, qui nous saisit et nous laisse sans voix. Pas une phrase, pas un mot qui ne soit essentiel. On s’incline devant le talent de celle qui a jadis signé Les monologues du vagin. On s’incline de même devant l’authenticité de ce retour du refoulé qui surgit dans son livre qu’elle dit avoir porté pendant 30 ans. Surtout, on réfléchit.
Les recherches de l’anthropologue Dorothée Dussy révèlent que la grande majorité des pères incestueux n’éprouvent pas de désir sexuel particulier pour les jeunes. « Jusqu’au viol d’un enfant, ils ont une vie sexuelle d’homme adulte normal […]. L’inceste se révèle avant tout être un rapport paroxystique de domination qui s’exprime dans l’érotisation et la sexualité. L’appropriation sexuelle des vulnérables dans la famille est une façon d’exprimer qui est le patron. »
Littérature de la résistance
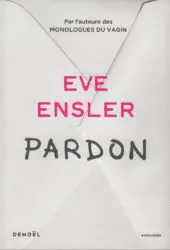 Notons les traits communs à ces trois histoires : la mise à nu d’un système qui s’appuie sur le pouvoir et le charisme d’un homme, la mécanique bien lubrifiée du pacte secret arraché à l’enfant, le silence des proches. Pour compléter, il y a l’impunité, résultat d’un système judiciaire dépassé qui n’arrête plus de faire état de son impéritie face aux violences sexuelles. Là-bas comme ici. Les récents procès des Salvail, Rozon et Arsenault (Michel) nous en ont offert un aperçu éloquent.
Notons les traits communs à ces trois histoires : la mise à nu d’un système qui s’appuie sur le pouvoir et le charisme d’un homme, la mécanique bien lubrifiée du pacte secret arraché à l’enfant, le silence des proches. Pour compléter, il y a l’impunité, résultat d’un système judiciaire dépassé qui n’arrête plus de faire état de son impéritie face aux violences sexuelles. Là-bas comme ici. Les récents procès des Salvail, Rozon et Arsenault (Michel) nous en ont offert un aperçu éloquent.
Et les mères dans cette tragédie ? Les trois savaient. Qui sont-elles ? Celle de Springora, une féministe soixante-huitarde, divorcée, décide après une valse-hésitation que sa fille est assez mature à 15 ans pour s’accoupler à un homme de 50 ans. Celle de Kouchner, la brillante intellectuelle féministe, divorcée qui a connu Fidel Castro, la maman maïeutique qui, selon sa Camillou, a protégé de nombreuses femmes, défend son compagnon Olivier Duhamel et fait du fils adolescent son rival et non la victime, tout comme la mère de Eve Ensler, une bombe blonde qui « avait l’assurance des personnes dotées de beauté, et la passivité de celle qui est contemplée ». Chaque ouvrage pose la question en creux qu’on ne devrait plus négliger : pourquoi se sont-elles tues ?
Littérature de la résistance, elle met en exergue la nécessité que l’artiste ou le politicien ou l’avocat soit aussi justiciable que le quidam. Enfermés dans leur égoïsme narcissique, ces criminels à braguette n’expriment pas même un iota de remords, ni regrets. Aucun n’a demandé pardon. Des décennies ont passé. Gabriel Matzneff, isolé, vieux et souffreteux, tire une dernière salve. « J’ai survécu au Coronavirus. Je ne survivrai pas au Vanessavirus. » Cette phrase est l’incipit du texte de 86 pages que G. vient de publier à compte d’auteur, faute d’avoir trouvé un éditeur. Il ne lâche rien. La victime c’est lui, elle, l’ingrate et la renégate. « Vanessa m’a assassiné, point barre », écrit-il sans un frémissement de l’âme. L’opuscule est coiffé du titre Vanessavirus. La violence du texte est à l’avenant.
En dépit de ses alibis et de ses fuites, Gabriel Matzneff devait faire face à ses juges en septembre 2021 pour « apologie de viol aggravé ». En raison d’un prétendu vice de procédure, le tribunal a invalidé la démarche. Mais l’association qui le poursuit a indiqué son intention d’aller en appel. Quant à Olivier Duhamel, le beau-père solaire et adoré, il s’est éclipsé et se terre dans son studio parisien, laissant craindre ou croire à son inévitable suicide, alors que, quarante ans plus tard, son beau-fils porte plainte pour « viols et agressions sexuelles par personne ayant autorité sur mineur de quinze ans ». Durant l’interrogatoire, il admettra « difficilement » les faits, mais il évitera le procès et une éventuelle condamnation, car ces faits sont prescrits. Enfin, Arthur Ensler a emporté ses secrets dans un silence éternel.
Au-delà de tout jugement, moral ou judiciaire, tous trois sont à présent enfermés dans des livres-prisons. Le consentement, La familia grande et Pardon pèsent de tout leur poids sur notre intelligence émotive, notre conscience, notre humanité.
* https://marcleacock1.wordpress.com/2016/07/27/child-abuse-gegen-missbrauch/
1. Vanessa Springora, Le consentement, Grasset, Paris, 2020, 205 p. ; 29,95 $.
2. Camille Kouchner, La familia grande, Seuil, Paris, 2020, 203 p. ; 36,95 $.
3. Eve Ensler, Pardon (trad. de l’américain par Héloïse Esquié), Denoël, Paris, 2020, 138 p. ; 31,95 $.
EXTRAITS
À quatorze ans, on n’est pas censée être attendue par un homme de cinquante ans à la sortie de son collège, on n’est pas supposée vivre à l’hôtel avec lui, ni se retrouver dans son lit, sa verge dans la bouche à l’heure du goûter.
Le consentement, p. 113.
Mon beau-père entrait dans la chambre de mon frère. J’entendais ses pas dans le couloir et je savais qu’il le rejoignait. Dans ce silence, j’imaginais. Qu’il demandait à mon frère de le caresser, peut-être, de le sucer.
La familia grande, p. 135-136.
« Comment avez-vous pu ainsi me tromper ? Toi la première, Camille, ma fille, qui aurait dû m’avertir. J’ai vu combien vous l’aimiez, mon mec. J’ai tout de suite su que vous essayeriez de me le voler. C’est moi la victime. »
La familia grande, p. 213.
Mon frère me fait lire ce dont il lui a fallu témoigner. Dans les détails, Tout. Sous mes yeux, les mots-lumière crue. Ces mots d’images qui, petite, m’ont traumatisée.
La familia grande, p. 233.
Je sens ta répulsion et ton dégoût. Je vois que cette surstimulation inondait ton corps de petite fille de cinq ans d’agitation, de terreur et de chagrin.
Pardon, p. 55.
Et j’avais une mission parallèle urgente – maintenir ta soumission et ton silence de façon que tu ne révèles jamais notre secret. Je suis devenu un tortionnaire en bonne et due forme.
Pardon, p. 75.











