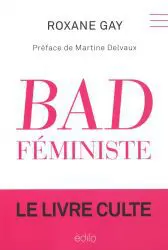Voici trois ouvrages féministes que beaucoup de choses séparent. L’un est écrit par une États-Unienne, l’autre par une Canadienne, le troisième par des Québécoises. L’un est un essai produit pour répondre à la demande d’un éditeur, l’autre est un recueil de textes dont plusieurs ont paru sur un blogue, le troisième est une réédition d’un travail collectif d’abord paru en 1988. Soulignons aussi que ces trois ouvrages sont publiés chez trois éditeurs québécois différents, constatation réjouissante qui nous démontre que la pensée féministe voit se multiplier les lieux qui lui permettent de se déployer.
C’est donc le féminisme qui unit ces trois ouvrages. Chacune des autrices contribue à mieux nommer cette posture, à la décortiquer, quitte à assumer les contradictions, les doutes, les remises en question. Toutes les femmes convoquées ici réfléchissent à leur façon à cette « mauvaise féministe » que revendique Roxane Gay, ne serait-ce que parce qu’elles posent le féminisme comme une pensée en mouvement, une pensée qui travaille et qui, se faisant, ne peut pas avoir une réponse définitive à chaque question que soulève la société complexe dans laquelle nous vivons.
Le livre culte de Roxane Gay
Dès la page couverture, l’édition québécoise de Bad Feminist (Bad féministe1) assume sa réputation et se présente sans ambages comme un « livre culte ». La réputation de Roxane Gay n’était plus à faire, au moins parmi les cercles féministes, au moment de la traduction de l’ouvrage, dont la version québécoise est préfacée par Martine Delvaux.
Quelques mots d’abord sur la traduction. On ne peut que saluer la volonté d’établir une traduction inclusive d’un tel ouvrage, mais celle-ci est parfois maladroite. Le recours systématique aux doublons d’une façon pas toujours cohérente donnera raison aux détracteurs qui estiment qu’une écriture inclusive alourdit le texte. Il existe pourtant d’excellentes traductions inclusives, comme nous le verrons plus loin. Soulignons qu’on ne trouve nulle part dans le livre mention du traducteur (j’apprends sur le site de l’éditeur qu’il s’agit de Santiago Artozqui).
Ajoutons que le recueil aurait pu être allégé de quelques textes. Les 38 courts essais sont parfois répétitifs et forment, une fois traduits en français, une somme imposante.
N’empêche, Roxane Gay a une verve certaine et est une très bonne vulgarisatrice. On s’attache rapidement à son humour, à sa propension à se remettre en question et à sa façon d’assumer spontanément ses contradictions. C’est ça, une mauvaise féministe : une féministe qui a peur de ne jamais être à la hauteur ou de trahir la cause dans ses choix de vie. « Je ne suis pas une experte en histoire du féminisme. Je n’ai pas l’érudition que j’aimerais avoir en matière de textes féministes clés. J’ai certains… centres d’intérêt, des traits de personnalité et des opinions qui ne coïncident pas nécessairement avec les courants majoritaires du mouvement, mais je suis quand même féministe. » La parole de Roxane Gay est décomplexante.
Par contre, la lectrice avertie (le féminin est inclusif ici, que le lecteur n’y prenne aucun ombrage) n’aura peut-être pas l’impression d’apprendre beaucoup de choses nouvelles. Personnellement, c’est la section « Race et divertissement » qui m’a le plus intéressée, sans doute parce que je suis plus néophyte sur ces questions. Roxane Gay fait preuve d’une absence complète de complaisance quant à la façon dont l’industrie cinématographique traite les réalités afro-américaines et explique de façon limpide l’influence négative de figures stéréotypées comme celle du nègre magique, « lequel ou laquelle va dispenser au protagoniste », toujours un personnage blanc, « la sagesse dont ce dernier ou cette dernière aura besoin pour progresser d’une façon ou d’une autre ». La lecture de ces textes qui déboulonnent des films comme La couleur des sentiments ou Django déchaîné aura profondément changé ma conception de la représentation des groupes ethnoculturels à l’écran.
Il faut aussi souligner les textes sur la culture du viol, y compris ceux dans lesquels l’autrice évoque le viol collectif qu’elle a elle-même subi ; elle y fait montre d’une sensibilité et une d’lucidité qui ne peuvent qu’être un exemple pour les survivantes qui souhaitent prendre la parole.
Il y a de très belles trouvailles dans ce recueil. Autant par son ton accessible que par ses thèmes diversifiés, ce livre pourra être une parfaite introduction aux enjeux féministes et interraciaux. L’approche de Gay est informée, ce qui n’empêche pas l’essayiste d’être vive, drôle, divertissante. Une édition un peu plus resserrée aurait donné un ouvrage plus compact qui aurait sans doute gagné en force de frappe.
Le petit remontant d’une rabat-joie
J’ai été plus convaincue par l’essai d’Erin Wunker, Carnets d’une féministe rabat-joie. Essais sur la vie quotidienne2, qui a agi sur moi comme un petit remontant. L’approche de Wunker n’est pas étrangère à celle de Gay : toutes deux universitaires, elles développent une pensée féministe qui assume ses doutes et qui pige autant dans la littérature du champ universitaire que dans l’actualité ou leur autobiographie. Dans ce cas-ci, la traduction de Madeleine Stratford est une grande réussite. Tout en poursuivant un objectif d’inclusivité, le texte est extrêmement fluide, vivant et… québécois !
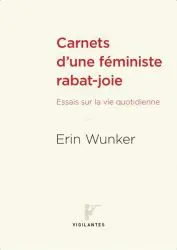 Après la mauvaise féministe, comment décrire la féministe rabat-joie (killjoys en anglais) ? Le terme est un emprunt à Sara Ahmed, universitaire féministe qui tient un blogue nommé Feminist Killjoys. Ce concept s’attaque directement à l’idée du bonheur comprise ici comme une forme de statu quo dont un des piliers est le patriarcat. « La féministe rabat-joie comprend que pour refaire le monde et s’y tailler une place, elle doit dénoncer la complaisance qu’entraîne l’impératif du bonheur. En réponse aux critiques qui lui reprochent de troubler la fête et d’ébranler le statu quo, elle s’écrie : mets-en ! »
Après la mauvaise féministe, comment décrire la féministe rabat-joie (killjoys en anglais) ? Le terme est un emprunt à Sara Ahmed, universitaire féministe qui tient un blogue nommé Feminist Killjoys. Ce concept s’attaque directement à l’idée du bonheur comprise ici comme une forme de statu quo dont un des piliers est le patriarcat. « La féministe rabat-joie comprend que pour refaire le monde et s’y tailler une place, elle doit dénoncer la complaisance qu’entraîne l’impératif du bonheur. En réponse aux critiques qui lui reprochent de troubler la fête et d’ébranler le statu quo, elle s’écrie : mets-en ! »
Les trois chapitres dont est composé l’essai de Wunker (« La culture du viol », « Les amitiés », « La maternité féministe ») s’emboîtent les uns dans les autres. Même si le titre parle d’essais au pluriel, nous n’avons pas ici le sentiment d’un collage comme dans un recueil de chroniques, et les trois sections forment un tout très cohérent.
L’essayiste prend souvent comme point de départ une anecdote personnelle, réfléchissant au caractère limité d’une telle expérience, mais s’en servant comme bougie d’allumage pour une réflexion plus large. Laissant une large place à la question des privilèges, Wunker partage son propre cheminement pour tenter de trouver une posture qui lui permette de se sentir à l’aise sans discriminer l’expérience d’autres femmes : « Comme femme cis de race blanche, une de mes responsabilités consiste donc à apprendre comment tourner le dos aux ‘joies’ patriarcales dont je tire avantage, parfois même inconsciemment ».
En fonction de nos propres positions, nous trouverons donc des questions qui nous toucheront dans cet essai, des pistes de réflexion que nous voudrons suivre. On en sort vivifié, et si on en retient que la rabat-joie brise certains partys, elle peut allumer des feux pour d’autres.
Nécessaire réédition
 On ne peut que saluer le travail de Remue-ménage, qui nous offre avec la réédition de La théorie, un dimanche3 l’accès à un texte fondamental du féminisme québécois. L’ouvrage, publié d’abord en 1988, réunit Louky Bersianik, Nicole Brossard, Louise Cotnoir, Louise Dupré, Gail Scott et France Théoret. Il émane de rencontres, tenues les dimanches, visant à échanger sur différents thèmes de la théorie littéraire à la lumière du féminisme. Chacune des écrivaines propose à la fois une réflexion théorique sur la question de son choix et un fragment d’une œuvre inédite à l’époque.
On ne peut que saluer le travail de Remue-ménage, qui nous offre avec la réédition de La théorie, un dimanche3 l’accès à un texte fondamental du féminisme québécois. L’ouvrage, publié d’abord en 1988, réunit Louky Bersianik, Nicole Brossard, Louise Cotnoir, Louise Dupré, Gail Scott et France Théoret. Il émane de rencontres, tenues les dimanches, visant à échanger sur différents thèmes de la théorie littéraire à la lumière du féminisme. Chacune des écrivaines propose à la fois une réflexion théorique sur la question de son choix et un fragment d’une œuvre inédite à l’époque.
Ce texte collectif est surtout le témoin incontournable de la pensée féministe des années 1980. Sa lecture aujourd’hui nous permet de constater d’abord que certaines préoccupations sont très actuelles. Le texte de Louky Bersianik « La lanterne d’Aristote : Essai sur la critique » soulève des questions qui sont encore vivement discutées trente ans plus tard. « Ainsi, de temps en temps, et particulièrement quand il s’agit de livres de femmes, réapparaît ce personnage anachronique du critique littéraire traditionnel en devoir : ou il encense ou il censure ; ou il comprend tout, tout de suite, ou il clôture, verrouille, cadenasse. »
A contrario, une telle lecture nous oblige aussi à mesurer le chemin parcouru et les mouvements qui traversent la pensée féministe. On constate par exemple que la question du féminin se poserait autrement aujourd’hui avec les apports des théories queers et la réflexion sur la non-binarité. Lorsque Louise Dupré affirme que « la survie du féminisme ne peut passer que par la reconnaissance du féminin comme différence », on suppose qu’une telle affirmation provoquerait aujourd’hui un imposant débat. On imagine aussi qu’un tel exercice, en 2019, serait plus préoccupé d’intersectionnalité et qu’on y retrouverait des voix d’origines diverses.
À l’exception de Louky Bersianik, qui nous a malheureusement quittés en 2011, les participantes à ce recueil sont des écrivaines toujours très actives qui enrichissent fréquemment le paysage de notre littérature de nouvelles publications. Relire leurs préoccupations, avec trente ans d’écart, c’est se donner l’immense privilège de mesurer le rythme d’une pensée en mouvement. Il est aussi intéressant de voir que, comme Gay et Wunker dont l’écriture nous est contemporaine, les autrices de La théorie, un dimanche bâtissent leur argumentaire en naviguant entre une grande érudition, des sources de savoir populaire et leur propre expérience. Il y a là quelque chose comme un programme en marche : une pensée féministe décloisonnée.
1. Roxane Gay, Bad féministe, trad. de l’américain par Santiago Artozqui, Édito, Montréal, 2018, 400 p. ; 29,95 $.
2. Erin Wunker, Carnets d’une féministe rabat-joie. Essais sur la vie quotidienne, trad. de l’anglais par Madeleine Stratford, Presses de l’Université de Montréal, Montréal, 2018, 216 p. ; 26,95 $.
3. Louky Bersianik, Nicole Brossard, Louise Cotnoir, Louise Dupré, Gail Scott et France Théoret, La théorie, un dimanche, Remue-ménage, Montréal, 2018, 230 p. ; 21,95 $.
EXTRAITS
Je loue un appartement, le plus bel endroit où j’ai vécu depuis que je suis adulte. J’ai une deuxième salle de bains pour mes invités. Je ne sauve pas des vies, mais j’essaie de ne pas en détruire.
Roxane Gay, Bad féministe, p. 47
Et ma petite, est-ce que je lui montre à mesurer ses gestes ? Ou est-ce que le monde s’en charge déjà ?
Erin Wunker, Carnets d’une féministe rabat-joie. Essais sur la vie quotidienne, p. 52
On aime coller sur le féminisme l’étiquette de la haine, plutôt que de le voir pour ce qu’il est : une vraie histoire d’amour. Une histoire d’amour entre femmes, entre toutes ces femmes qui, peut-être, sont d’abord et avant tout féministes.
Martine Delvaux, préface de La théorie, un dimanche, p. 12