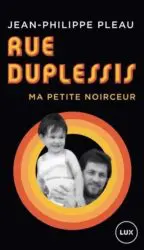Véritable phénomène littéraire, Rue Duplessis. Ma petite noirceur de Jean-Philippe Pleau est un roman – « mettons », pour reprendre la précision de l’auteur – qui relate son cheminement personnel.
Originaire d’un milieu pauvre, autant du point de vue matériel que du point de vue culturel, Pleau sait à travers son récit capter notre attention à coup de franchise, de dépouillement, d’anecdotes et de considérations théoriques qui n’alourdissent pas son propos. Il est un digne représentant de ce phénomène qu’on appelle transfuge de classe.
Son père est analphabète. Il voue une passion particulière aux automobiles. Son fils devra en posséder une le plus tôt possible. Le père fabrique des enseignes pour la compagnie Pro6. Après douze ans de travail, des douleurs au dos l’éloignent de l’emploi qu’il aime. La Commission de la santé et de la sécurité au travail, qui le surveille de près, décide qu’il est apte à travailler. Il ne reçoit donc pas de prestations d’invalidité. La famille exploitera une garderie à la maison, au grand dam du père pour qui ce n’est pas un vrai métier d’homme. Dans la famille de la mère de Jean-Philippe, les garçons ont étudié. Ils ont même fait leur cours classique. Les filles, elles, terminaient leur secondaire et allaient ensuite travailler. Bonjour l’égalité des sexes. Sa mère a peur de tout : de la nourriture, des maladies, des accidents, des étrangers. Elle a transmis son anxiété à son fils qui, à force de thérapies, mit un certain temps à s’en débarrasser.
La notion de transfuge de classe est apparue il y a déjà quelques décennies. Dès les années 1960, le sociologue français Pierre Bourdieu (lui-même transfuge, cité à quelques reprises par Pleau) a analysé le phénomène en s’intéressant à la reproduction sociale et à la notion d’habitus, une manière d’être propre à une classe sociale. L’écrivaine nobélisée Annie Ernaux, qui a grandi dans le café-épicerie de ses parents, témoigne dans tous ses écrits de son cheminement particulier. Elle a contribué à répandre l’expression transfuge de classe. Celle-ci ne désigne pas seulement la mobilité (transclasse), mais englobe le choc et l’expérience éprouvante ressentis par ceux qui choisissent délibérément de changer de milieu socioéconomique et culturel. Cette migration se complète souvent par un retour vers son milieu, ce « qui ne veut pas dire réembrasser les mœurs et les coutumes de la culture qu’ils ont choisi de quitter, mais reconnecter avec l’amour familial ou amical de leur enfance comme valeur refuge ».
Pleau est loin d’être le seul au Québec à avoir vécu ce changement de classe. Des milliers de gens d’ici ont connu une expérience similaire. Parmi ceux qui écrivent, Pleau donne en exemple Fernand Dumont, Caroline Dawson, Mélanie Michaud, Erika Soucy. Il aurait pu mentionner également Benoit Jodoin (dont nous avons parlé dans ces pages) et Michel Lacroix. Il donne aussi des exemples outre-Atlantique, comme l’écrivain Edouard Louis, le sociologue Didier Eribon, Nesrine Slaoui et, bien sûr, Annie Ernaux. Si on fait remarquer à Pleau que la situation est pire en France, que les classes sont encore moins mobiles là-bas qu’au Québec, il répond que « cette morale du moins pire » ne saurait constituer une raison suffisante pour s’empêcher d’écrire là-dessus.
« Rue Duplessis est écrit à la première personne du singulier, mais ce ‘je’ est social. Il ne m’appartient pas exclusivement. Il est celui des gens qui me disent Ton histoire me fait penser à la mienne. »
Ce qui distingue peut-être Pleau des autres, c’est son propre étonnement devant ce qui lui est arrivé. Jusque vers l’âge de seize ans environ, il se contentait plutôt bien de sa vie. Il avait un char et aller travailler à l’usine comme son père représentait pour lui un avenir tout à fait envisageable. Il ne veut pas laisser entendre qu’il y aurait des vies moins réussies que d’autres. Il veut seulement rendre compte, après l’avoir constaté, que certaines voies demeurent fermées pour ceux qui auraient les capacités et le goût de les emprunter.
Au cégep, une amie l’a invité à venir faire un tour dans un cours de sociologie. Comme Saint-Paul sur le chemin de Damas, il a été « foudroyé ». En deux heures, il a compris sa vie. La sociologie lui a ouvert les yeux sur les classes sociales et les chemins tracés d’avance dont on ne parvient guère à s’extirper.
Je m’attendais à ce qu’il parle davantage de son école secondaire, le Collège Saint-Bernard, une école privée, puisque ces écoles initient leurs élèves à une culture classique, laquelle aurait pu contribuer à l’épiphanie vécue par l’auteur. Pleau ne précise pas si les Frères de la Charité aidaient ses parents en payant les 500 dollars de frais de scolarité, même s’il leur arrivait, écrit-il en note de bas de page, de le faire pour des familles démunies.
L’écriture de Pleau ressemble souvent au langage utilisé par sa famille : dru, direct, dépouillé d’artifice. Cette manière de parler ne s’enfarge pas dans les fleurs du tapis. Autour de lui on parlera de tapettes pour désigner les homosexuels. L’oncle de Pleau, le frère de son père, fut chassé de la maison parce qu’à une occasion il a démontré ouvertement de l’affection pour son chum. « Tu feras pas ça devant Jean-Philippe toi, estie. Des plans pour qu’il devienne comme vous autres, sacrament. » Néanmoins, tout le monde semblait bien l’aimer, cet oncle, mais il ne fallait pas qu’il soit démonstratif. Pleau se faisait intimider et battre à l’école. Les autres disaient de lui qu’il était une tapette. Il priera le petit Jésus pour ne pas en être une.
L’auteur le répétera, il n’envie pas les autres. Il s’interroge sur le système qui permet autant de disparités et qui fait si peu pour les amoindrir. Tous ne naissent pas avec les mêmes chances. À ce propos, il rappelle l’émotion déchirante qu’il a ressentie en entendant Robert Lepage raconter, dans sa pièce 887, qu’il avait été refusé au privé, et au Petit Séminaire de Québec et au Collège des Jésuites, malgré d’excellents résultats aux tests d’admission. Raison donnée : son père était chauffeur de taxi. Son ami Charles, qui a obtenu de moins bons résultats, a été admis aux deux endroits. Son père était juge.
« J’écris pour rendre compte, non pour en régler », écrit-il. On a un peu de peine à le croire, car il mentionne cela juste après avoir décrit comment, lors de retrouvailles des anciens de cinquième secondaire, ses anciens intimidateurs, qu’il nomme par leurs prénoms, continuent à le traiter de « grosse Plotte », et à lui jeter du pain et du spaghetti en plein visage.
En France, le phénomène des transfuges de classe connaît déjà ses premières critiques. D’aucuns questionnent une certaine mode, la séduction qu’exercent les récits à ce sujet, leur dolorisme, leur pseudo-scientificité quand il y a mélange d’autobiographie et de considérations théoriques. Même Annie Ernaux déclarait que ce type de récit a ses limites et qu’il faudrait plutôt interroger la société qui tolère que tout le monde n’ait pas accès aux mêmes biens culturels. N’empêche, on ne peut pas dire qu’au Québec, ni en France d’ailleurs, on croule sous ce genre de témoignages. Nul doute que celui de Pleau demeurera un modèle du genre.
Les parents de Jean-Philippe Pleau ne sont pas allés au lancement de son premier livre, Au temps de la pensée pressée (Lux, 2023). Ils se seraient déplacés par contre pour fêter avec lui l’achat d’une voiture neuve s’il s’en était acheté une. Je souhaite que cette fois-ci ils y soient allés. Ils n’ont rien à redouter de leur fils. Le chapitre du livre intitulé « Soyons clair » n’est composé que de quatre mots : « J’aime mes parents. »
Jean-Philippe Pleau, Rue Duplessis. Ma petite noirceur, Lux, Montréal, 2024, 328 p.
EXTRAITS
La honte cède sa place à… la honte d’avoir eu honte.
p. 84.
La bourgeoisie s’achetait des billets à l’opéra ; nous, des billets avec Extra.
p. 104.
Les classes sociales existent toujours. Seule la lutte a cessé.
p. 210.
Pendant des années, je serai en confrontation directe avec mes parents sur tous ces sujets délicats. Ma lente acculturation transformait mon foyer familial en une tribu étrangère.
p. 158.