« Ressurgissant, l’enfance réunit ma fin et mon commencement », écrit d’entrée de jeu Robert Lalonde dans ses plus récents carnets et à laquelle le titre1, emprunté à Saint-Exupéry, nous renvoie. La reconstruction du paradis terminée, Lalonde nous entraîne à sa suite dans la découverte de ses nouveaux territoires, le chien toujours à ses trousses lorsqu’il ne le devance pas, les deux faisant la paire comme de joyeux complices qui mordent d’autant plus goulûment à la vie qu’ils la savent de plus en plus fragile.
« La nature voit plus clair en moi que moi-même », écrit aussi Lalonde, qui n’en appelle pas moins à la barre ses autres complices de toujours pour y voir encore plus clair : Henry David Thoreau, Annie Dillard, Virginia Woolf, Colette, Gabrielle Roy, Salman Rushdie, Jack Kerouac, et plusieurs autres qui rejoignent les rangs de cette communauté avec laquelle il partage une même soif de connaissances et de liberté. L’écriture a toujours été le lieu du seul instant, poursuit Lalonde, et celui des rencontres qui s’inscrivent dans la durée. Il demeure fidèle, et reconnaissant, aux auteurs qui lui ont ouvert la voie et qui, comme lui, empruntent les chemins de traverse et autres sentiers d’où peuvent à tout moment surgir l’inattendu, l’inespéré. Qui sait ce qui peut surgir des hautes herbes, comme au détour d’une phrase. Les sens constamment en alerte, comme l’aigle s’apprêtant à plonger sur sa proie, l’écrivain repère ses sujets et se lance à son tour toutes plumes acérées : « C’est pour ça que j’écris : pour voir enfin ce que je n’ai fait qu’apercevoir du coin de l’œil ». Et cet œil, hérité d’un père peintre à ses heures, lui dévoile les déclinaisons « des puissants faisceaux de soleil perçant les nuages », dont l’or de sept heures du soir, alors qu’« enjôlé par la luminosité du couchant traversant le sang de [s]es paupières, [il] imaginai[t] [s]a mort, heureux d’en finir ».
Comme dans ses carnets précédents, Robert Lalonde laisse entrevoir les bonheurs, mais aussi les exigences qui découlent de la pratique de l’écriture (si intimement liée à la vie qui bat en lui et autour de lui), de ce besoin sans cesse inassouvi qui le ramène à sa table de travail. « Le geste d’écrire m’allège l’âme, la décharge du limon qu’y dépose le train-train quotidien », écrit-il. Et, conscient de ces exigences, jamais il ne perd de vue l’aphorisme dicté par son grand-père : « Ça coûtera ce que ça coûtera / Ça prendra le temps que ça prendra / Ça donnera ce que ça donnera ». S’ajouteront, ici et là, les leçons tirées d’Annie Dillard, de Salman Rushdie, de Jean Giono et de quelques autres écrivains qu’il revisite sans cesse, autant par amitié que pour chasser le doute à certains moments et revenir à l’essentiel : écrire ne se fait qu’en écrivant.
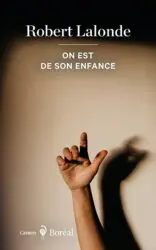 La figure grand-paternelle évoquée ci-dessus est davantage présente ici que dans les carnets précédents. L’un des passages les plus émouvants évoque d’ailleurs la mort de l’un d’eux. Lalonde vient d’avoir douze ans et son père s’apprête à l’inscrire au séminaire pour lui faire entreprendre son cours classique. Sur le point de rendre son dernier souffle, son grand-père demande à le voir – et il sera la dernière personne à le voir vivant – pour lui remettre, d’une main tremblante, un carnet à couverture bleue, en lui confiant : « Quand tu seras au fond d’un désespoir que je connais trop bien, ouvre-le, imagine que je te murmure à l’oreille… et… Tu pleureras, ça te fera du bien, mais tu verras comment tu pourras t’en sortir… Tu sais que je sais… »
La figure grand-paternelle évoquée ci-dessus est davantage présente ici que dans les carnets précédents. L’un des passages les plus émouvants évoque d’ailleurs la mort de l’un d’eux. Lalonde vient d’avoir douze ans et son père s’apprête à l’inscrire au séminaire pour lui faire entreprendre son cours classique. Sur le point de rendre son dernier souffle, son grand-père demande à le voir – et il sera la dernière personne à le voir vivant – pour lui remettre, d’une main tremblante, un carnet à couverture bleue, en lui confiant : « Quand tu seras au fond d’un désespoir que je connais trop bien, ouvre-le, imagine que je te murmure à l’oreille… et… Tu pleureras, ça te fera du bien, mais tu verras comment tu pourras t’en sortir… Tu sais que je sais… »
Tu sais que je sais… Ce carnet renferme aussi son lot de silences, de souvenirs évoqués sur lesquels Lalonde ne s’attarde pas. Certains moins heureux que d’autres ; certaines blessures demeurent toujours vivantes. Avec l’âge vient la sagesse d’accepter ce qui ne peut être changé. « Soudain je me rends compte, écrit-il, que depuis quelques jours je cherchais la paix avec des moyens orgueilleux, oubliant que l’accalmie se profile par la brèche de la simple acceptation. »
Tout livre, pour trouver grâce à ses yeux, doit savoir préserver son lot de non-dits, de secrets, et faire confiance au lecteur. Tout dévoiler, c’est priver celui-ci de sa propre découverte. « Un bon livre garde sournoisement ses secrets, ne les lâche qu’à regret, escomptant l’opiniâtreté des patients décrypteurs d’énigmes. » Le choc de certaines lectures ne peut pas toujours être expliqué, décortiqué, ni partagé. On s’aventure dans un livre comme dans la vie, le plus souvent seul, avec pour seuls points de repère ce que nous révèlent nos sens, nos propres expériences. Tenter de les imposer équivaut le plus souvent à les priver de toute vie. « Je veux voir, entendre, m’aventurer, clame Lalonde, non à tout prix comprendre, surtout pas comprendre trop vite. Je refuse qu’on me gâche le mystère, qu’on me guide comme l’aveugle que je ne suis pas. »
La lumière, le plus souvent de fin de journée, chaude et dorée, inonde ces pages d’un sentiment d’accomplissement, de plénitude et de bien-être. Les années s’accumulant, et rendant parfois plus difficile de devancer ou de semer le chien, Robert Lalonde poursuit l’exploration de son nouveau paradis en compagnie de tous ces écrivains, ceux d’hier et d’aujourd’hui, avec lesquels il ne cesse de converser. À tout moment, l’enfance s’invite en ces pages. Si les larmes perlent parfois au coin des yeux, « c’est que l’enfance qui convoque la merveille charroie aussi le mal-être ». Ou, pour faire écho à ce que dit J. M. G. Le Clézio dans Identité nomade, « parce qu’un enfant est une sorte d’éponge, il capture absolument tout ce qui se passe ».
Au moment où Lalonde clôt ce nouveau chapitre de ses carnets, le monde est en déroute en ce début d’automne, écrit-il ; la forêt s’illumine de couleurs, les outardes décampent vers le sud. Mais elles reviendront, tout comme lui, ne peut-on que souhaiter.
1. Robert Lalonde, On est de son enfance, Boréal, Montréal, 2024, 232 p.
EXTRAITS
La nature voit plus clair en moi que moi-même. Elle m’a toujours prémuni contre la tentation de me montrer plus intelligent, plus fort qu’elle. Elle m’a préservé du définitif comme de l’immobile, couteaux qui assassinent.
p. 11
On me demande à répétition : « Écrivez-vous toujours ? » « Et vous, respirez-vous toujours ? » répondrais-je, s’il n’était pas malpoli de répondre à une question par une autre question.
p. 80
Nous rentrons à regret tous les deux, lui rêvant de sa couche douillette, moi encore une fois retourné dans cet autrefois inoubliable qui de plus en plus souvent me tire en arrière.
p. 153
Que nous le voulions ou non, nous sommes à nos propres yeux une énigme.
p. 204











