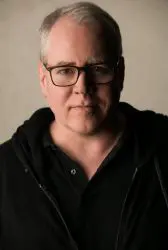La sortie synchrone de White et de l’édition « collector » d’American Psycho permet d’opposer deux Amérique : celle des années 1980, de la génération X, et celle des années 2000, des milléniaux – la « génération dégonflée » (Generation Wuss), comme l’appelle tendrement Ellis ; les États-Unis à l’ère de l’analogique et de l’administration Reagan, et les États-Unis à l’ère du numérique et de l’administration Trump. Quand l’observateur s’appelle Bret Easton Ellis, le regard se fait pointu comme un couteau.
Un livre blanc
Huitième ouvrage du romancier américain, White1 est son tout premier recueil d’essais. Publié neuf ans après Suite(s) impériale(s), ce livre devait initialement prendre la forme d’une fiction. Or, entre-temps, Ellis s’est distancé du genre romanesque. Il anime depuis 2013 des baladodiffusions sur le réseau californien PodCastOne, où il parle de tout et de rien en compagnie de ses invités – des musiciens, des écrivains, des réalisateurs, des acteurs, etc. La diversité des sujets abordés dans White reflète cet éclectisme.
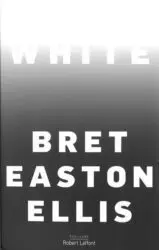 Le titre du recueil est une boutade autoréférentielle. Ellis fait ironiquement allusion à lui-même en tant qu’homme blanc privilégié. Le titre adresse aussi un clin d’œil à The White Album (1979) de Joan Didion, une romancière et journaliste aujourd’hui âgée de 86 ans qui exerça une énorme influence sur Ellis et les autres représentants du « Brat Pack », tels Jay McInerney et Donna Tartt.
Le titre du recueil est une boutade autoréférentielle. Ellis fait ironiquement allusion à lui-même en tant qu’homme blanc privilégié. Le titre adresse aussi un clin d’œil à The White Album (1979) de Joan Didion, une romancière et journaliste aujourd’hui âgée de 86 ans qui exerça une énorme influence sur Ellis et les autres représentants du « Brat Pack », tels Jay McInerney et Donna Tartt.
Dans « Empire », le premier des huit essais que compte le volume, Ellis se remémore la place qu’occupaient les films d’horreur dans les années 1970 pour montrer à quel point les adolescents d’aujourd’hui sont hypersensibles et surprotégés. Dans « Être acteur », il retrace l’impact qu’eurent le film American Gigolo(1980) et la beauté de Richard Gere sur son éveil à la sexualité. Il évoque également ses débuts d’écrivain, le succès rencontré à vingt et un ans et l’adaptation (selon lui, ratée) de Moins que zéro par Marek Kanievska. Procédant à bâtons rompus, il relate au passage les circonstances d’une entrevue que lui avait commandée Vanity Fair avec l’acteur Judd Nelson. Au lieu du garçon imbuvable qu’on lui avait dépeint, Ellis fut surpris de découvrir un type charmant. Frondeur, Ellis convint alors avec Nelson de se venger du magazine en faisant passer des lieux ringards de Los Angeles pour des endroits branchés. Autre texte à saveur rétrospective, « Second moi » éclaire la genèse et la réception du roman American Psycho. Un extrait de cet essai est d’ailleurs repris en guise de préface dans la réédition du roman. Plus loin, dans « Post-Empire », au moment où son roman était adapté en comédie musicale, Ellis se plaît à imaginer ce que serait devenu Patrick Bateman aujourd’hui.
Sous la plume d’Ellis, l’expression « post-Empire » désigne l’Amérique de l’après-11 Septembre et du premier mandat présidentiel d’Obama. Pour dépeindre cette ère de « la culture du like » et de « la victimisation de soi », du « fascisme libéral de gauche » et de « l’absence d’empathie », l’auteur n’y va pas de main morte. Pourtant, les flèches qu’il décoche à la jeune génération ne lui viennent pas d’un sentiment d’hostilité, mais de curiosité. Ellis, qui depuis quelques années a pour partenaire amoureux un millénial, souhaite mieux comprendre. De même, ses propos tranchants sur le monde d’aujourd’hui traduisent moins un tempérament réactionnaire qu’une nature rebelle et caustique. Ellis prend soin de rappeler qu’il observe les milléniaux en tant que représentant de la génération X, « une génération plus pessimiste et ironique que nulle autre à errer sur la terre ». Cette disposition d’esprit donne lieu à de savoureuses anecdotes (notamment quand Ellis raconte les ennuis que lui ont attirés quelques tweets malencontreux) et à de mordants traits de plume : « Si l’Empire était The Eagles, veuve-Clicquot, Reagan, Le Parrain et Robert Redford, alors le post-Empire était American Idol, l’eau de coco, le Tea Party, The Human Centipede et Shia LaBeouf. »
Dans la tête d’un psychopathe
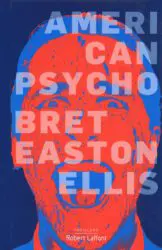 La réédition d’American Psycho2, troisième roman d’Ellis (et son plus connu), fournit, elle aussi, une belle occasion pour comparer « l’Empire » et « le post-Empire ». Précisons toutefois qu’il n’est pas conseillé d’aborder cette œuvre au premier degré. Autrement, elle paraîtra infusée d’une violence et d’une haine (notamment à l’encontre des femmes) insoutenables de nos jours. En voulant dépeindre le désespoir yuppie et présenter la pire version de lui-même, son « moi de cauchemar », Ellis a fini par écrire une farce sombre avec un narrateur peu fiable. Car le protagoniste-narrateur Patrick Bateman, narcissique et arrogant golden boy de Wall Street, n’est peut-être pas le tueur en série qu’il prétend être ; il s’est peut-être seulement imaginé tel. Ellis admet qu’il a trouvé fascinant d’écrire son roman sans résoudre ce mystère. De toute façon, l’essentiel de son propos se trouve ailleurs : dans « le fantasme d’un fou », comme il dit, et dans l’évocation d’une décennie particulière (les années 1980), filtrée par sa sensibilité d’écrivain. Ce n’est que soudainement et à propos de rien que le romancier a fait de son personnage un éventuel psychopathe. Avant tout, Bateman est l’incarnation du jeune loup matérialiste, riche et élégant, exagérément soigné, dépourvu de moralité, totalement isolé et rempli de rage. À la façon d’un nouveau Raskolnikov, il espère que quelqu’un, n’importe qui, viendra le sauver de lui-même.
La réédition d’American Psycho2, troisième roman d’Ellis (et son plus connu), fournit, elle aussi, une belle occasion pour comparer « l’Empire » et « le post-Empire ». Précisons toutefois qu’il n’est pas conseillé d’aborder cette œuvre au premier degré. Autrement, elle paraîtra infusée d’une violence et d’une haine (notamment à l’encontre des femmes) insoutenables de nos jours. En voulant dépeindre le désespoir yuppie et présenter la pire version de lui-même, son « moi de cauchemar », Ellis a fini par écrire une farce sombre avec un narrateur peu fiable. Car le protagoniste-narrateur Patrick Bateman, narcissique et arrogant golden boy de Wall Street, n’est peut-être pas le tueur en série qu’il prétend être ; il s’est peut-être seulement imaginé tel. Ellis admet qu’il a trouvé fascinant d’écrire son roman sans résoudre ce mystère. De toute façon, l’essentiel de son propos se trouve ailleurs : dans « le fantasme d’un fou », comme il dit, et dans l’évocation d’une décennie particulière (les années 1980), filtrée par sa sensibilité d’écrivain. Ce n’est que soudainement et à propos de rien que le romancier a fait de son personnage un éventuel psychopathe. Avant tout, Bateman est l’incarnation du jeune loup matérialiste, riche et élégant, exagérément soigné, dépourvu de moralité, totalement isolé et rempli de rage. À la façon d’un nouveau Raskolnikov, il espère que quelqu’un, n’importe qui, viendra le sauver de lui-même.
Un aspect de la personnalité de Bateman étonnera le lecteur en 2021 : sa fascination pour Donald Trump – l’homme d’affaires, cela s’entend ; pas encore l’animateur de la téléréalité The Apprentice et encore moins le 45e président des États-Unis. Mentionné plus de 40 fois dans le roman, Trump est le père que Bateman n’a jamais eu, son héros et son modèle. Les électeurs américains auraient peut-être dû prendre acte de cette inquiétante filiation lors de la campagne présidentielle de novembre 2016…
1. Bret Easton Ellis, White, trad. de l’anglais (États-Unis) par Pierre Guglielmina, Robert Laffont, Paris, 2019, 304 p. ; 32,95 $.
2. Bret Easton Ellis, American Psycho, trad. de l’anglais (États-Unis) par Alain Defossé, Robert Laffont, Paris, 2019, 460 p. ; 38,95 $.
EXTRAITS
Le titre du premier chapitre [d’American Psycho], « April’s Fool Day », indique que ce qu’on va lire n’est pas exactement un récit fiable, qu’il s’agit peut-être entièrement d’un rêve, de la sensibilité collective de la culture consumériste yuppie vue à travers les yeux d’un sociopathe dérangé qui a une prise très fragile sur la réalité.
White, p. 78.
Mais c’est une époque qui juge tout le monde si sévèrement à travers la lorgnette de la politique identitaire que vous êtes d’une certaine façon foutu si vous prétendez résister au conformisme menaçant de l’idéologie progressiste, qui propose l’inclusion universelle sauf pour ceux qui osent poser des questions. Chacun doit être le même et avoir les mêmes réactions face à n’importe quelle œuvre d’art, n’importe quel mouvement, n’importe quelle idée, et si une personne refuse de se joindre au chœur de l’approbation, elle sera taxée de racisme ou de misogynie. C’est ce qui arrive à une culture lorsqu’elle ne se soucie plus du tout d’art.
White, p. 107.
Je suis peut-être en proie au dégoût de soi […], mais ce n’est pas parce que je suis gay. Je pense que la vie est essentiellement dure, une lutte pour chacun à des degrés variables, et qu’avoir un humour dévastateur, se mobiliser contre ses absurdités inhérentes, briser les conventions, mal se conduire, inciter à la transgression de je ne sais quel tabou, est la voie la plus honnête sur laquelle avancer dans le monde.
White, p. 125.
American Psycho traitait de ce que ça faisait d’être une personne dans une société avec laquelle vous étiez en désaccord, et de ce qui se passait quand vous tentiez d’accepter de vivre avec ses valeurs, sachant qu’elles étaient fausses. L’illusion et l’anxiété étaient les points focaux. La folie s’insinuait et était irrésistible. C’était le résultat de la poursuite du rêve américain : isolement, aliénation, corruption, le vide consumériste sous l’emprise de la technologie et de la culture d’entreprise. Tous les thèmes du roman ont conservé leur prépondérance trois décennies plus tard, quand le 1 % le plus riche du pays est devenu soudain plus riche qu’aucun humain auparavant, une ère au cours de laquelle un avion à réaction privé est aussi banal qu’une voiture, et les locations à un million de dollars, une réalité. New York et au-delà en 2016 était American Psychosous stéroïde.
White, p. 254-255.
À cause de la visite de ce détective, il y a de grandes chances que la journée soit gâchée. Je lui jette un regard morne, tandis qu’il s’installe sur la chaise, croisant les jambes d’une manière qui me fait froid dans le dos. Il se retourne pour voir si je suis toujours au téléphone, et je m’aperçois que je suis resté trop longtemps silencieux.
American Psycho, p. 306.
Il n’y a pas en moi une seule émotion précise, identifiable, si ce n’est la cupidité et, peut-être, un dégoût absolu. Je possédais tous les attributs d’un être humain – la chair, le sang, la peau, les cheveux –, mais ma dépersonnalisation était si profonde, avait été menée si loin, que ma capacité normale à ressentir de la compassion avait été annihilée, lentement, consciemment effacée. Je n’étais qu’une imitation, la grossière contrefaçon d’un être humain.
American Psycho, p. 322.