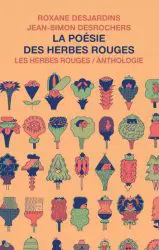La figure éditoriale est une chose aussi familière qu’étrange. Fédérateur par nature, l’éditeur est aussi destiné à se poster en marge ou à l’arrière-plan des auteurs et des œuvres, bien que sa présence soit difficile à ignorer lorsqu’on est en présence de nouveautés en librairie. Au-delà du prestige ou des contingences matérielles, il existe certainement quelque chose comme une signature de l’éditeur, mais celle-ci n’est pas faite que de rigueur et de travail ; il y a là un faisceau de projections, de tentatives, de conflits et de malentendus, au bout duquel les livres apparaissent, plongés dans un concert de voix où bien malin serait celui qui pourrait dissocier totalement le cadre du contenu. Est-ce les auteurs qui font la maison, ou la maison qui fait les auteurs, la réponse est bien sûr dans un entrelacement, une hiérarchie mobile où l’arbitraire est infléchi par les rencontres et les décisions successives.
L’exemple des éditions Les Herbes rouges, qui fêtaient récemment leur cinquantième anniversaire avec une anthologie de poèmes1, est des plus éloquents à ce sujet. Qu’est-ce qui, en cinq décennies, s’est imposé, a servi de fil conducteur à ces centaines de publications poétiques ? La chose est d’autant plus intéressante qu’il s’agit d’un cas rare, où une seule et même direction a régné durant l’entièreté de la période, soit celle des frères Marcel et François Hébert, ce dernier naviguant plus ou moins en solitaire depuis la mort du premier en 2007.
Un égrégore ?
Dans les années qui ont suivi leur fondation, Les Herbes rouges semblent s’être développées intuitivement à la façon d’une communauté anarchiste, où dans la conjonction de libertés un certain ordre s’est établi, organique et ouvert. Sans manifeste central, sans trop de métadiscours (sinon dans l’irruption pragmatique de la théorie dans les poèmes), il s’est agi avant tout d’une « plateforme d’exploration » (dixit la préface) qui s’est incarnée à travers les aléas d’un (anti-)groupe, conjonction de solitudes dont l’histoire a retenu la geste au moment où les avant-gardes ont su diversifier le discours, entre les excès de pays puis la dictature tranquille de l’intime.
De ce « groupe », le lecteur fait éminemment partie, car contrairement à ce que certains ont pu croire, on observe là un jeu capital avec la réception, une réception mise à nu, déplacée, reconfigurée en faveur de plaisirs inédits. C’est un des traits qu’énonce la préface de Jean-Simon DesRochers et de Roxanne Desjardins, et par lequel ils justifient la brièveté de leur intervention : tout en affirmant la cohérence de la production, en suggérant que l’anthologie peut se lire comme une œuvre à part entière, sinon comme un portrait d’éditeur, on coupe volontairement court à l’analyse et on se hâte de rediriger vers le mouvement interprétatif où les textes ont acquis une partie de leur valeur.
Force est de constater que le corpus gagne en effet à être réactivé ainsi, par petites bouchées, quelques pages dans l’ordre chronologique, puis dans le désordre qui vous plaira. À l’image de l’iconographie ludique qui orne la couverture, une singulière gaieté se dégage des diagonales qu’on effectue entre Normand de Bellefeuille et Josée Yvon, Marcel Labine ou Véronique Cyr. En survolant les décennies, on remarquera entre autres l’estompement d’un certain hédonisme et de l’humour noir, l’accueil d’un lyrisme moins atypique, quelques changements de paradigme, mais sans rupture définitive, en faveur d’une chambre d’échos maintenant ses fréquences à travers le changement.
Malgré des différences notoires, une comparaison avec le programme et les mécanismes sociaux entourant le Refus global est instructive2. Le groupe automatiste n’a-t-il pas justement valorisé une société parallèle, une conjonction des négations désirantes d’où émergerait un partage indéterminé de la magie, du « Trésor poétique », et ce, en contraste avec une préméditation vue comme maudite ? Comme on le sait, le rassemblement négatif de Borduas et des automatistes s’inspirait grandement de la notion d’égrégore telle qu’adaptée au surréalisme par Pierre Mabille, et désignant une communauté marginale soudée autour d’un accès privilégié au réel. Dans une perspective semblable, et non sans échos sacrés malgré son rejet du religieux, l’automatisme s’envisageait comme une association rebelle, mythifiée à plus long terme par un certain Claude Gauvreau. La conclusion de la pièce La charge de l’orignal épormyable est éloquente à cet égard : « Il faut poser des actes d’une si complète audace, que même ceux qui les réprimeront devront admettre qu’un pouce de délivrance a été conquis pour tous ».
Beaucoup d’éléments autour des Herbes rouges pointent vers un tel anarchisme épique. Les frères fondateurs, malgré une discrétion légendaire, ont acquis un ascendant indéfectible sur une fratrie d’apôtres pour qui publier aux Herbes rouges est devenu garant d’une qualité intrinsèque. La maison a ses grands aînés (Roger Des Roches, André Roy, Carole David, etc.), ses martyrs (Huguette Gaulin, Denis Vanier), ses excommunications en privé, ses rédemptions (retour récent d’un enfant prodigue, François Charron), et puis il y a cet occasionnel sentiment de supériorité en regard des autres maisons d’édition, que partagent certains auteurs plus jeunes, un parti pris qui les enveloppe d’une aura d’élus.
En l’occurrence, cette anthologie fait figure de bible : fidèlement à l’infaillibilité papale du « regard Hébert », il a été choisi un texte dans chacun des quatre cents et quelques recueils et collectifs publiés depuis le jour 1, l’époque de la revue éponyme incluse. Chaque fragment de l’édifice est ainsi sanctifié, partageant un statut de classique qui émane d’un ensemble omnipotent, alors que la préface n’est pas sans incarner une sorte de prophétie autoréalisatrice : regardez et vous verrez, tout comme nous… (Je blague en partie, car l’argument de non-hiérarchisation avancé par les anthologistes n’est pas dénué de pertinence non plus.)
Il reste que la relation entre les œuvres et le groupe est cruciale, ici. Loin de moi l’idée de crier à la supercherie, d’ailleurs, car il s’agit bel et bien d’une communauté d’esprit, aux effets avérés, ce qui contraste avec l’édition à la petite semaine trop souvent rencontrée. Mais autant le légendaire travail sur chaque vers, mot à mot, doit-il avoir des fondements vérifiables, autant l’éditeur n’est-il pas sans rappeler la figure lacanienne du « sujet supposé savoir » (ou SsS). Tranquillement assis près du fauteuil tel un analyste enfumé, le maître éditorial parle peu, mais son silence même ouvre ses patients à un travail sur soi qui oriente vers l’authenticité, là où l’arbitraire cède le pas à une nécessité intérieure qui demeure sans recette. C’est que la présence d’un SsS favorise diablement le transfert, dit-on…
Gérer la circulation
Bien malin qui pourrait définir noir sur blanc la poétique des frères Hébert, laquelle semble avoir beaucoup fonctionné par la négative, avec un effet d’inhibition positive imposant aux fidèles d’éviter les clichés qui les enchaînent au sens commun et aux coutumes livresques du moment – deux formes de censure aux contours faussement naturels et innés. Il s’agirait donc surtout, pour l’éditeur, de gérer la circulation, de canaliser la liberté des auteurs et de leur intimer une saine méfiance à l’égard d’eux-mêmes et par là, de la société entière, en passant par les marécages du milieu littéraire. Au moment où l’auteur x ou l’autrice y avancent vers la complétion de leur recueil, ils savent que là, tout autour, MONSIEUR HÉBERT les regarde, et que son œil saura déceler le moindre laisser-aller, la moindre banalité. Déjà, avec cet effet de présence, un mécanisme existe, il suffit d’abord d’y croire et le reste suivra.
À cette perspective un brin caricaturale, il faudrait ajouter que la politique éditoriale de la maison s’est très certainement assortie d’une éthique de la lecture. Lecteurs au fin museau, les frères Hébert ont su entraîner des générations de jeunes auteurs dans les rhizomes sans fin de l’intertextualité, de sorte qu’écrire est toujours une incursion dans la grande bibliothèque universelle, devant laquelle on doit témoigner d’une voracité constante afin de ne pas perdre sa propre voix.
Avec le recul panoramique dégagé par cette anthologie, on est soi-même tenté d’admettre l’existence d’une énonciation collective, aussi insaisissable soit-elle. Pensons notamment aux premières années des éditions de l’Hexagone, mais sur une durée beaucoup plus considérable et avec une intention nettement plus mise en bride. Par un effet de réseau, par une police éditoriale soutenue, une voix commune se profile, avec ses limites, ses habitus, ses manières, sa définition, puis ce qu’il faut d’indéfini pour que la force étrange des mots poursuive son flux/reflux.
En feuilletant le bouquin dans l’ordre ou le désordre, on verra des rencontres et des continuités s’opérer, tissu d’échos et de différenciations qui réduplique l’expérience initiale, à travers une jouissance singulière du sens et de sa mise en doute. Entre les saillies hirsutes de Marcel Hébert et les perplexités spirituelles de José Acquelin, entre les cut-ups corticaux de Nicole Brossard et les pensées spéculatives de Dominique Robert, lire Les Herbes rouges donne la plupart du temps lieu à une réalité distincte.
Une fois disposé cet herbier qui se veut tout sauf muséal, quelle sorte de « demain » y a-t-il encore pour les Herbes rouges3 ? À en juger par la prudence avec laquelle s’effectue la passation des pouvoirs, on pourrait croire que le vœu d’étonnement perpétuel, l’identité en creux, puis le sobre éclat qui caractérise les plus récentes périodes, cela continuera à faire son chemin et à dessiner des futurs. Métamorphose sans début ni fin, la réserve poétique ne saurait être transmise que transformée, disait le manifeste automatiste de 1948, et certains semblent en avoir pris acte.
1. Roxane Desjardins et Jean-Simon DesRochers, La poésie des Herbes rouges, Les Herbes rouges, Montréal, 2018, 445 p. ; 25,95 $.
2. Soulignée jadis par André-G. Bourassa, cette filiation a notamment été revendiquée à souhait par François Charron.
3. Rappelons l’anecdote selon laquelle le nom de la maison a été inspiré par le livre Demain les herbes rouges de Jean-Paul Filion.
EXTTAITS
tu fumais un ver de terre
et moi j’éteignais la dispute
entre le feu et sa masse
André Cassagne, Les herbes rouges, no 2, déc. 1968.
(elle s’était cherchée au retour du travail, la journée) l’incendie s’est déclaré sans le dire, brûlée de fond en comble même la dernière vie de la chatte y a passé pour l’artifice, le travail du feu, de paille éventré le phénix renaît mais elle
Sylvie Gagné, La sourcière, no 58, déc. 1977.
Si lente musique
méduse à la gorge du malaise
Le sang circule. Le bruit amorti des automobiles. Les textes passent d’une main à l’autre jusqu’aux petites heures ; parfois quelque rebelle arrive à l’improviste, tente d’assassiner l’écriture : je fais courir le bruit qu’elle a plusieurs têtes. La vierge en bois sur mon bureau n’arrête pas de retenir son fou rire, son pied caresse la tête du serpent. Nous travaillons lentement.
Philippe Haeck, Tout va bien, 1975.
de partout la soif assaille
et le petit rat de vos indécisions s’affirme
vous savez pourtant le verre solide
la vitesse moisson
prenez rictus
multiple soleil
prenez rictus
et couvez-le bien
Marie Aude Laperrière, Jours de grand appétit, 2014.
[…] s’il faut reconnaître la singularité de cette maison unique au Québec, restée depuis cinq décennies sous la même direction, ce n’est pas un regard tourné vers l’arrière que nous cherchons à susciter ici. Les années ont passé, soit : les textes restent. Nous désirons les offrir à la lecture non pour contempler le chemin parcouru, mais pour voir ce qui, en eux, demeure disponible.
Extrait de la préface, p. 11