– Quelque chose à boire ?
– Deux jus de pomme svp.
L’agent de bord me tend deux verres en plastique, j’en dépose un devant mon oncle et je prends l’autre.
J’ouvre le livre que j’avais mis sur le plateau, relis la dernière page et frissonne : « Je suis une maudite Sauvagesse. Je suis très fière quand, aujourd’hui, je m’entends traiter de Sauvagesse. Quand j’entends le Blanc prononcer ce mot, je comprends qu’il me redit sans cesse que je suis une vraie Indienne et que c’est moi la première à avoir vécu dans la forêt. Or, toute chose qui vit dans la forêt correspond à la vie meilleure. Puisse le Blanc toujours me traiter de Sauvagesse ».
Ce passage touche exactement mon questionnement et ma blessure : notre époque. Chaque jour, j’y pense : on mange de la nourriture dans laquelle on a ajouté toutes sortes d’ingrédients impossibles, on ne peut plus boire l’eau directement à la rivière, on doit se motiver pour sortir dehors et bouger.
Souvent, je pense à ce qu’était la vie dans le Nutshimit, l’arrière-pays : nourriture saine, environnement sain, vivre le quotidien en harmonie avec le vivant. J’y pense chaque jour et en même temps, je bois mon jus de pomme dans un verre en plastique à l’intérieur d’un avion qui boit des milliers de litres de kérosène.
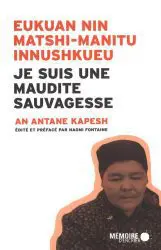 Vivre ce paradoxe m’est souvent insupportable, mais je continue quand même pour la seule raison que je suis née dans ce monde-là. C’est ce qu’An Antane Kapesh dénonçait dans l’urgence en publiant Eukuan nin matshi-manitu innushkueu / Je suis une maudite Sauvagesse1 ; l’assimilation forcée, le contrôle des ressources, le mépris envers le mode de vie des Innus : bref, la colonisation, l’impérialisme et le capitalisme. Mais pour cette grande dame, pas besoin de nommer ces concepts froids : elle sait raconter par l’expérience concrète et expliquer par son vécu toute la misère que les colonisateurs ont amenée dans le Nord. Même si ça ne faisait pas du tout partie de sa culture et de son rapport à la transmission, Kapesh s’est approprié le langage de l’étranger sur son territoire pour se faire entendre et comprendre : l’écriture.
Vivre ce paradoxe m’est souvent insupportable, mais je continue quand même pour la seule raison que je suis née dans ce monde-là. C’est ce qu’An Antane Kapesh dénonçait dans l’urgence en publiant Eukuan nin matshi-manitu innushkueu / Je suis une maudite Sauvagesse1 ; l’assimilation forcée, le contrôle des ressources, le mépris envers le mode de vie des Innus : bref, la colonisation, l’impérialisme et le capitalisme. Mais pour cette grande dame, pas besoin de nommer ces concepts froids : elle sait raconter par l’expérience concrète et expliquer par son vécu toute la misère que les colonisateurs ont amenée dans le Nord. Même si ça ne faisait pas du tout partie de sa culture et de son rapport à la transmission, Kapesh s’est approprié le langage de l’étranger sur son territoire pour se faire entendre et comprendre : l’écriture.
Quand le livre est sorti en 1976 – et encore aujourd’hui – la réception l’a cadré dans un style uniquement biographique. C’est pourtant le voir d’un point de vue réducteur et même colonialiste, car la philosophie innue prend une forme qui n’est pas semblable aux standards dominants pour exprimer ses idées. Culturellement, le récit de soi innu est automatiquement politique et philosophique. C’est-à-dire que pour comprendre le monde, les histoires sont importantes. Bien plus que les concepts. À la toute fin de ces anecdotes, provenant du présent ou de passations générationnelles, se compose un constat sur la situation énoncé de façon claire, vivante et sensible. Donc, pour comprendre l’entièreté du propos il est difficile de prendre un passage et de le plaquer en citation. Il faut vraiment lire tout, se laisser imprégner par la rondeur de la forme de la narration. Ensuite on peut comprendre avec son intelligence instinctive et émotive quel est le rapport de Kapesh à sa dénonciation politique, dans toute l’ampleur de la vérité intrinsèque déployée par cette façon de raconter et de décrier les injustices.
Ce qui préoccupe An Antane Kapesh est un enjeu humain de base : la reconnaissance, de la part des Blancs, du fait que les valeurs innues sont légitimes, et qu’il n’est pas aisé de s’adapter facilement à un envahissement. Beaucoup de colère émerge de ses mots car il y a non-consentement à l’installation du colonisateur avec ses propres lois, et à l’imposition de celles-ci aux Innus sur leur propre territoire. Une frustration grandiose et nécessaire émerge des pages à propos du pillage des ressources, des effets néfastes de l’arrivée l’alcool ainsi que du système policier et pénitentiaire qui ruine carrément la vie des Innus de Schefferville, qui ne se sentent pas concernés par ces valeurs et ces constructions sociales éloignées des leurs. Le rapport entre civilisé et non-civilisé est aussi exposé d’une façon poignante de lucidité :
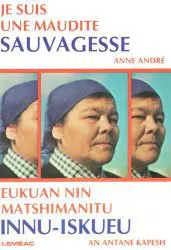 « […] il y a une seule chose qui m’ait rendue heureuse et très fière : c’est toujours l’Indien qui a pris soin, à l’intérieur des terres, de tous les étrangers qui ont eu l’idée de venir sur notre territoire. Et jamais nous n’avons entendu raconter qu’un des étrangers dont les Indiens avaient pris soin dans le bois, et qui se trouvait pourtant seul, n’ait été maltraité et offensé par eux de la façon dont le Blanc, lui, nous traite, nous les Indiens. C’est la raison pour laquelle aujourd’hui je dis : avant qu’un seul Blanc ne vienne ici dans notre territoire, nous étions déjà civilisés. Depuis que le Blanc est notre voisin, presque chaque jour nous l’entendons dire : ‘Les Indiens ne sont pas civilisés’. Depuis qu’il est notre voisin dans notre territoire, nous les Indiens, nous constatons souvent que le Blanc est moins civilisé que nous ».
« […] il y a une seule chose qui m’ait rendue heureuse et très fière : c’est toujours l’Indien qui a pris soin, à l’intérieur des terres, de tous les étrangers qui ont eu l’idée de venir sur notre territoire. Et jamais nous n’avons entendu raconter qu’un des étrangers dont les Indiens avaient pris soin dans le bois, et qui se trouvait pourtant seul, n’ait été maltraité et offensé par eux de la façon dont le Blanc, lui, nous traite, nous les Indiens. C’est la raison pour laquelle aujourd’hui je dis : avant qu’un seul Blanc ne vienne ici dans notre territoire, nous étions déjà civilisés. Depuis que le Blanc est notre voisin, presque chaque jour nous l’entendons dire : ‘Les Indiens ne sont pas civilisés’. Depuis qu’il est notre voisin dans notre territoire, nous les Indiens, nous constatons souvent que le Blanc est moins civilisé que nous ».
Tout le récit montre la difficulté de l’imposition d’un système à un autre. Il fait aussi voir le côté que l’on a très peu vu ou lu dans toute l’oppression de la colonisation : la pensée d’une femme innue née dans le Nutshimit qui a vu ses enfants envoyés au pensionnat ainsi que l’installation impérialiste des nouveaux venus. Tout le récit démontre la fierté et la certitude de la valeur d’une culture. Il nous fait voir, en même temps, l’adaptation à un changement de mode de vie radical pour un peuple près de la nature et nomade. Kapesh fait le plaidoyer ultime du mode de vie traditionnel, dans le bois, comme étant le meilleur pour les Innus.
Pour moi, choisir de réinscrire la parole d’An Antane Kapesh dans l’histoire littéraire du Québec est un acte décolonial et même révolutionnaire dans la littérature québécoise. La republication donne enfin du pouvoir à cette autrice, qui rapporte les faits conformément à sa culture traditionnelle. Cette voix a assurément sa place dans l’espace historique et essayistique québécois.
– Regarde, en bas, on voit les Rocheuses, dit mon oncle.
– Wow c’est tellement grand !
En bas, des pics neigeux dans une nature sauvage déplient une beauté incroyable. Nous les contemplons dans un très long silence.
– Toi mon oncle, tu penses-tu que vivre dans le bois c’est le meilleur mode de vie pour nous autres ?
– Ben certain. À rester au village on tourne en rond, on sait pas quoi faire. Dans le bois on s’occupe toujours. Faut trouver le juste milieu. On a perdu beaucoup de savoirs et il faut essayer de les garder.
Je retourne à ma lecture, et je me dis la même chose qu’An : « Moi je crois que l’Indien a constamment envie d’aller dans le bois mais les choses ne sont pas si simples que ça ».
* ©José Mailhot
1. An Antane Kapesh, Eukuan nin matshi-manitu innushkueu / Je suis une maudite Sauvagesse, édité et préfacé par Naomi Fontaine, trad. de l’innu par José Mailhot, Mémoire d’encrier, Montréal, 2019, 216 p. ; 21,95 $.










