Alger, 1956, un ouvrier tourneur français, Fernand Iveton, militant communiste et anticolonialiste, pose une bombe dans la manufacture où il travaille.
Le but : déstabiliser le pouvoir en place, faire le maximum de dégâts matériels en provoquant une panne d’électricité à Alger tout en veillant à ce que personne ne soit blessé. Fernand Iveton est un idéaliste. Ses convictions politiques visent un monde meilleur, et ce monde, dans l’immédiat, passe par une Algérie libre. Une Algérie où tous naissent égaux, sans égard pour leur origine, leur religion, leurs opinions politiques. L’attentat est soigneusement préparé, aussi soigneusement que peut l’être un attentat conçu par des gens qui ont davantage à cœur le bien-être de leurs concitoyens que le nombre de morts nécessaires à l’atteinte de leur idéal. La bombe sera déposée à l’endroit indiqué, mais le détonateur s’arrête dans sa course, comme le cœur de Fernand Iveton lorsqu’il voit surgir à son poste de travail des militaires qui l’empoignent et l’entraînent de force au commissariat central d’Alger. L’enfer de Fernand Iveton commence. Insultes, menaces, torture. S’ensuit un procès dont l’issue est déterminée d’avance : il s’agit davantage de faire un exemple que de rendre justice. Fernand Iveton sera le seul prisonnier politique européen à être guillotiné au moment de la guerre d’Algérie, avec l’accord du garde des Sceaux de l’époque qui, quelques années plus tard, fera abroger la peine de mort alors qu’il sera président de la France. « Iveton demeure comme un nom maudit […]. On se demande comment Mitterrand pouvait assumer ça », ont écrit l’historien Benjamin Stora et le journaliste François Malye dans François Mitterrand et la guerre d’Algérie. Un nom maudit pour certains, un libérateur pour d’autres.
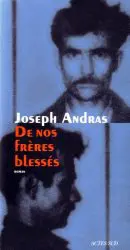 De nos frères blessés1, de Joseph Andras, relate l’interrogatoire, la détention et le procès ayant conduit à l’exécution de Fernand Iveton, le tout entrecoupé de scènes évoquant l’enfance de ce dernier et sa rencontre avec celle qui deviendra sa femme. Ces scènes servent ici à dépeindre un homme du peuple animé d’un idéal humaniste, un révolutionnaire romantique épris de justice sociale qui dépasse ses propres intérêts et ceux de l’Algérie. C’est le frère d’armes d’un Albert Camus qui n’admet pas de voir l’iniquité et l’injustice s’ériger en système social qu’il faut accepter les yeux fermés, les bras croisés. La force du roman, qui a valu à son auteur le prix Goncourt du premier roman en 20162, repose en grande partie sur l’alternance des différents épisodes ayant conduit à l’exécution de Fernand Iveton, et au style habilement maîtrisé pour en rendre crédible chacune des parties et tenir le lecteur en haleine dans leur déroulement condensé dans un roman qui fait tout juste 137 pages. Rien n’est ici superflu, ni de nature à induire chez le lecteur quelque attitude compatissante. La brutalité des faits mis en scène en opposition à l’idéal poursuivi par l’ouvrier tourneur suffit à circonscrire le propos avec toute la force évocatrice voulue sans verser dans la dénonciation revancharde ou l’apitoiement. Si ce roman a la force d’un manifeste, c’est celui de la dignité humaine opposée à l’aveuglement des pouvoirs en place prêts à tout pour préserver leurs privilèges indus.
De nos frères blessés1, de Joseph Andras, relate l’interrogatoire, la détention et le procès ayant conduit à l’exécution de Fernand Iveton, le tout entrecoupé de scènes évoquant l’enfance de ce dernier et sa rencontre avec celle qui deviendra sa femme. Ces scènes servent ici à dépeindre un homme du peuple animé d’un idéal humaniste, un révolutionnaire romantique épris de justice sociale qui dépasse ses propres intérêts et ceux de l’Algérie. C’est le frère d’armes d’un Albert Camus qui n’admet pas de voir l’iniquité et l’injustice s’ériger en système social qu’il faut accepter les yeux fermés, les bras croisés. La force du roman, qui a valu à son auteur le prix Goncourt du premier roman en 20162, repose en grande partie sur l’alternance des différents épisodes ayant conduit à l’exécution de Fernand Iveton, et au style habilement maîtrisé pour en rendre crédible chacune des parties et tenir le lecteur en haleine dans leur déroulement condensé dans un roman qui fait tout juste 137 pages. Rien n’est ici superflu, ni de nature à induire chez le lecteur quelque attitude compatissante. La brutalité des faits mis en scène en opposition à l’idéal poursuivi par l’ouvrier tourneur suffit à circonscrire le propos avec toute la force évocatrice voulue sans verser dans la dénonciation revancharde ou l’apitoiement. Si ce roman a la force d’un manifeste, c’est celui de la dignité humaine opposée à l’aveuglement des pouvoirs en place prêts à tout pour préserver leurs privilèges indus.
Le début de chacun des chapitres est particulièrement bien réussi et plonge aussitôt le lecteur dans l’atmosphère propre au déroulement qui suit, comme le tout début du roman alors que rien n’est encore joué : « Pas cette pluie franche et fière, non. Une pluie chiche », lance le narrateur, comme si était déjà inscrite dans l’air ambiant l’absence de générosité des opposants à l’idéal d’une société plus juste, comme si le drame qui va se jouer était déjà scellé. Ou cet autre passage où l’on s’assure que Fernand Iveton sera présentable pour sa première audition devant un juge d’instruction : « Au sol, ses cheveux comme un pigeon écrasé. Les ciseaux mènent à bien leur office : Fernand a bientôt le crâne à ras. On lui incline le visage sur la gauche, la lame du rasoir passe sur la joue et râpe la barbe qui, depuis son arrestation dix jours auparavant, commençait sérieusement à pousser ».
Chacun des chapitres est ainsi minutieusement ciselé, ordonné, serait-on tenté d’ajouter, avec la précision d’un horloger (pour racheter celle de l’artificier ?). Du début à la fin, tout s’enchaîne sans que cet enchaînement repose uniquement sur la succession des actions ayant conduit à l’issue fatale. Joseph Andras mise plutôt sur ce qui fait la force d’une œuvre littéraire : à la linéarité du récit propre au déroulement qui constitue notre lot quotidien, il privilégie les éléments de l’histoire qui, par la place qu’ils occupent au sein du récit et de leur déroulement, serviront au mieux le propos qui se décline ici sur un double tableau : l’idéal qui anime cet ouvrier épris de justice et la brutalité aveugle d’un système, écartelé entre deux continents, qui ne cherche qu’à faire un cas d’exemple du sort réservé à ceux qui ne partagent pas ses vues.
En ces temps où les scènes de tuerie dans les aéroports, les salles de rédaction et de spectacle, les marchés et les places publiques, ne cessent de se dérouler en boucle sur nos écrans de télévision, le roman de Joseph Andras propose une autre lecture de la lutte des laissés-pour-compte dans ce monde où les dirigeants d’entreprise accumulent en une seule journée (j’exagère : il leur en faut trois) le salaire annuel d’un ouvrier tourneur. Joseph Andras dénonce la violence aveugle d’un système qui écrase les démunis tout en nous rappelant à notre devoir de venir en aide à nos frères blessés : « Fernand lui avait toujours dit qu’il condamnait, aussi bien moralement que politiquement, la violence aveugle, celle qui frappe les têtes et les ventres au hasard, corps déchiquetés aux aléas, coup de dés, la sordide loterie quelque part dans une rue, un café ou un autobus. […] on ne combat pas la barbarie en la singeant, on ne répond pas au sang par son semblable ».
Soixante ans après son exécution, au moment où paraissent Lettres à Anne3, Fernand Iveton trouve ici réparation.
1. Joseph Andras, De nos frères blessés, Actes Sud, Arles, 2016, 137 p. ; 29,95 $.
2. Prix qu’il refusa tout de go, faut-il souligner, l’auteur souhaitant rester à l’écart des agitations médiatiques selon son éditeur, ce qui n’empêcha pas le déclenchement d’agitations : qui se cache derrière Joseph Andras ? s’est-on empressé de se demander. Le tout alimenté par le fait qu’une seule photographie circule d’Andras, le montrant de dos, crâne rasé, devant une rivière. Et s’il s’agissait simplement d’un refus de la concurrence, de la rivalité et de la compétition, notions étrangères à l’écriture et à la création selon les mots transmis par Andras aux membres du jury au moment de la remise du prix ? Que l’on ne cherche pas, écrivait-il à sa défense, à déceler la moindre arrogance ni forfanterie dans ces lignes : seulement le désir profond de s’en tenir au texte, aux mots, aux idéaux portés, à la parole occultée d’un travailleur et militant de l’égalité sociale et politique. Voilà de quoi alimenter la rumeur pour des mois à venir.
3. François Mitterrand, Lettres à Anne (1962-1995), Gallimard, Paris, 2016.
EXTRAITS
Où est la bombe, fils de pute ? Fernand a les yeux bandés par un épais morceau de tissu déchiré. Sa chemise traîne à même le sol, la plupart des boutons arrachés. Il saigne d’une narine. Un flic cogne aussi fort qu’il le peut ; la mâchoire craque légèrement. Où est la bombe ?
p. 15
J’ai plus les dates en tête, vous m’excuserez, mais ce qui est sûr c’est que ça fait des années que les Arabes s’organisent pour qu’on les entende, pour obtenir l’égalité entre tous, entre chaque communauté, chez nous, en Algérie. Ils crient dans le désert. Rien. Zéro. On les envoie derrière les barreaux et on boucle leurs partis, on les dissout, on les réduit au silence et on se pousse du col, la Culture, la Liberté, la Civilisation, tout leur défilé de majuscules, quoi, ça parade ça parade, ça se mousse dans les miroirs, plus ça brille mieux c’est, faut voir comme ils aiment ça.
p. 60
Oui, notez bien cela, monsieur le Président, notre client sait qu’il se bat pour plus que lui, il se bat pour son pays, qu’il veut libre, heureux, un pays qui puisse garantir à chacun de ses citoyens, musulmans et européens, la liberté de pensée et l’égalité, notre client ne veut rien d’autre.
p. 127











