2013. Où en est le Québec ?
Ample question à laquelle une certaine littérature politique et sociologique, abondante, tente de répondre. Les échos du printemps érable résonnent encore un an plus tard, tout comme la voix de René Lévesque, figure ici surprenante, qui continue de hanter les consciences.
Les dix essais commentés au fil des pages qui suivent expriment moins le ressassement amer des défaites référendaires qu’ils ne brossent un portait actuel de l’identité québécoise à laquelle est inévitablement rattachée la question de l’indépendance. Collectivement ou individuellement, la jeunesse québécoise promeut une réaffirmation identitaire forte qui n’en est encore qu’à ses balbutiements. Tout n’est, hélas, pas aussi rose. Certains auteurs soulignent l’éternelle hésitation des Québécois – incarnée en quelque sorte par Lévesque. Telle autre estime le nationalisme québécois « étriqué, nombriliste, paranoïaque »… Vision ici démontée.
Illustration des débuts d’une nouvelle ère pour le Québec ? Panorama, en tout cas, d’une société en pleine mutation et recherche d’autres valeurs.
Visages et perceptions du Québec
Malgré la fatigue politique dont parlait Hubert Aquin ou à cause d’elle, les livres qui scrutent ce demi-pays abondent. Tantôt pour célébrer ses mérites, tantôt pour en rappeler tel trait, tantôt pour souligner l’atteinte de tel palier.
Ce grand petit livre de Nicolas Lévesque s’ouvre sur une éclatante leçon d’humilité et d’intelligence : l’auteur se relit et se nuance. Le printemps érable a eu lieu ; l’avenir peut se lever. Lévesque ne renie pas les reproches qui lui montaient en bouche, mais il jouit du réveil. Déjà prêt à l’action, il demande, à propos des machines, de l’économie, du pays, des partis politiques, « comment les réinventer, forts que nous sommes des erreurs du passé ». Notre univers lui paraît encore adolescent, mais il le sait en gestation de maturité : « Je rêve de la possibilité d’un livre optimiste qui ne serait pas ‘à droite’ ».
Lévesque décode ce qui échappe à l’agité. À peine entend-il une banalité (« L’or est une valeur refuge ») que sa pensée malaxe le terme : « Enfin un mot pour le dire : nous vivons à l’époque des valeurs refuges (l’argent, le corps, les objets), ces repères par défaut sur lesquels nous pouvons prendre appui, en ces temps de transition vers l’imprévisible, d’attente d’un autre récit ».
À sa profession de psychanalyste, Lévesque demande beaucoup. Si, écrit-il, sa confrérie consentait à « confronter de manière solidaire les compagnies d’assurances et pharmaceutiques, le système de santé, les universités », le lien de confiance entre elle et le citoyen s’établirait ou renaîtrait. La conclusion tombe, audacieuse et militante : « L’avenir du clinicien est politique ».
Nicolas Lévesque, Le Québec vers l’âge adulte, Nota bene, Québec, 2012, 180 p. ; 13,95 $.
On associe souvent le fait de devenir adulte à se caser, à s’écraser dans le confort, alors que c’est précisément le contraire : c’est faire éclater les cases, déployer toute son énergie, vivre l’inconfort, la fatigue, le temps qui manque…
p. 64.
Entre la première édition de 2009 et cette nouvelle version, il s’est passé quelque chose d’important, le début d’un changement social qui m’a forcé à changer le titre du livre, comme pour tracer une ligne, reconnaître la mutation, inscrire le printemps jusque dans l’écorce des mots.
p. 5.
René Lévesque, Homme de la parole et de l’écrit
L’ouvrage d’Alexandre Stefanescu et Éric Bédard se concentre sur la personnalité de René Lévesque. Plus encore, il n’observe qu’une facette du personnage : sa parole et ses écrits. On y apprend, car cette activité de Lévesque demeure méconnue, qu’il a écrit des tonnes de chroniques (Journal de Montréal, Le Jour, etc.). S’y constate la libre relation de Lévesque avec l’actualité turbulente. Un rien stimule sa verve, mais tel enjeu majeur, religion ou même projet d’indépendance, n’attire pas sa plume. En ce sens, il s’associe au peuple plus qu’aux pontifes. Autre surprise, ce journaliste épris de liberté admirait chez les journalistes anglophones leur soutien à l’unité canadienne et souffrait de la neutralité de leurs collègues francophones… Au passage, l’ouvrage souligne que Lévesque bénéficia, dans son apprentissage des communications, d’immersions dans d’autres cultures (France, Angleterre, États-Unis…). Ce qui n’enlève rien à son talent !
Sous la dir. d’Alexandre Stefanescu et Éric Bédard, René Lévesque, Homme de la parole et de l’écrit, VLB, Montréal, 2012, 176 p. ; 27,95 $.
De tous les premiers ministres québécois, René Lévesque est celui qui a le plus écrit. Ces textes forment non seulement un riche corpus donnant accès aux massifs de sa pensée mais constituent en soi un beau morceau de notre patrimoine politique.
p. 33
Alors que ses mémoires comporteront plus tard de belles pages sur les premières années de sa vie, ses textes des années 1988-1976 ne sont ponctués de presque rien d’intime, de personnel, d’introspectif. […] Il n’y a presque rien, non plus, sur la foi ou la religion.
p. 42
Histoire intellectuelle de l’indépendantisme québécois T. II, 1968-2012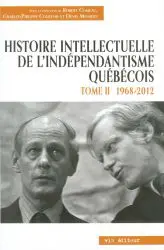
À sa manière, ce bouquin, rédigé sous la direction de Robert Comeau, Charles-Philippe Courtois et Denis Monière, continue l’Histoire intellectuelle de l’indépendantisme québécois. Alors que le premier tome donnait à lire ceux qui, de 1834 à 1968, avaient modelé et infléchi l’idéologie indépendantiste, celui-ci présente 25 portraits d’hommes et de femmes (2 seulement) qui, de 1968 à nos jours, ont repris le flambeau. Souvent, ce sont des livres qui appellent l’analyse ; procédure défendable, mais dont pâtissent les auteurs dont la contribution déborde ce cadre, par exemple Marcel Rioux ou Pierre Falardeau. Sans ouvrir un débat fastidieux sur les mérites des cités et ceux des absents, on s’étonnera de lire François Marie Bachand et de voir Yves Michaud réduit au silence. Le lecteur obtiendra compensation lorsque apparaîtront des noms moins familiers, tel André Binette résumé et compris par Eugénie Brouillet. Parmi les textes d’une justesse insigne, j’ose choisir l’introduction à la deuxième partie (Robert Comeau), le texte de Jonathan Livernois sur Pierre Vadeboncœur, la lecture de Fernand Dumont par Jacques Beauchemin.
Sous la dir. de Robert Comeau, Charles-Philippe Courtois et Denis Monière, Histoire intellectuelle de l’indépendantisme québécois, T. II, 1968-2012, VLB, Montréal, 2012, 373 p. ; 29,95 $.
Pour peu qu’on le situe dans une perspective assez large, Vers l’indépendance ? représente un moment assez singulier dans l’histoire de la pensée indépendantiste. Léger, on l’a dit, est une figure de transition dans l’histoire du nationalisme québécois, dans la mesure où il assume pleinement son vieil héritage groulxiste sans renier pour autant l’apport singulier du néonationalisme…
Mathieu Bock-Côté sur Jean-Marc Léger, p. 212.
Cette mise en tutelle originelle n’a, selon Binette, jamais cessé. L’État canadien est aujourd’hui une fédération mononationale qui, au plan juridique, nie la dimension nationale de la société québécoise. Cette dépendance se manifeste, entre autres, dans la jurisprudence constitutionnelle.
André Binette par Eugénie Brouillet, p. 252.
Fin de cycle, Aux origines du malaise politique québécois
La voix est jeune, le ton péremptoire, la réflexion décapante, le parcours fascinant. L’orientation fait claquer des couleurs peu affichées dans le débat public, celles d’un conservatisme fringant. « Les clivages politiques hérités de la Révolution tranquille semblent désuets et ils paraissent ne subsister que par la difficulté qu’a ce courant conservateur à parvenir à la pleine maturité intellectuelle et politique. »
Mathieu Bock-Côté lit l’histoire d’un œil neuf. De la présence de Gilles Grégoire près de René Lévesque, il déduit la présence au Parti québécois d’un ADN conservateur. Dans le combat du Bloc québécois, il perçoit un nationalisme déformé : « Le Bloc a ainsi introduit une innovation radicale dans l’histoire du nationalisme québécois, dans la mesure où le peuple québécois tel qu’il a pris forme historiquement et culturellement y est désormais étranger ».
Qu’on n’aille pas imputer à Bock-Côté un désaveu de l’indépendantisme. Il le juge en déficit d’inspiration, mais il estime qu’un recours au potentiel conservateur lui serait tonique : à trop insister pour que l’indépendance soit technicienne, moderniste, oublieuse des racines québécoises, peut-être a-t-on freiné son essor.
Mathieu Bock-Côté, Fin de cycle, Aux origines du malaise politique québécois, Boréal, Montréal, 2012, 184 p. ; 22,50 $.
Il s’agit en fait de remettre le Québec en mouvement de façon qu’il rompe avec un consensus progressiste qui l’asphyxie dans la rectitude politique et qui l’empêche de se donner un nouvel élan collectif.
p. 46
Le souverainisme entendu ici comme idéologie du PQ se présentait comme le parachèvement de la modernisation sociale et technocratique de la société québécoise.
p. 73
Notre indépendance, 28 Québécois s’expriment
Certains des témoignages de ce collectif proviennent de bouches connues : Françoise David, Louise Beaudoin, Pierre Curzi… Ce sont cependant les jeunes qui offrent les pages les plus percutantes : ceux et celles qui n’ont subi ni 1980 ni 1995 sont indemnes face à l’avenir.
Ainsi, Nic Payne écrit : « Faire l’indépendance, ce n’est pas s’inventer un pays, c’est rendre justice à celui que nous avons déjà ». Ainsi, Catherine Dorion exonère les humains de la déprime : « […] et si nous nous mettions à vivre comme des êtres humains, c’est-à-dire ensemble et vivant notre territoire plein d’eau, de français étrange, de sapins et de toute cette immense tendresse qui attend son heure ». Ressentiment, défaitisme, résignation, où ça ?
Le texte de Robert McKenzie demeure le plus dérangeant, tant il souligne le côté hésitant des Québécois et l’incarnation qu’en serait René Lévesque. Car Lévesque, écrit McKenzie, n’aura pas été un grand libérateur, faute d’avoir vaincu les démons qui l’incitaient à demeurer lié à l’autre Canada. « […] le Québec serait indépendant depuis longtemps, écrit-il, si les Québécois avaient la moindre idée de l’indifférence – quand ce n’est pas le pur mépris – que l’on nourrit à leur égard. »
Collectif, Notre indépendance, 28 Québécois s’expriment, Stanké, Montréal, 2012, 204 p. ; 24,95 $.
Mais on dit « Oui » à quoi ? À l’idéal ? À l’inconnu ? À une personne charismatique, à un messie ? Dire « Oui » est un acte de confiance, de foi. Pas surprenant que l’on cherche toujours cette personne ou ce mouvement à qui l’on pourra dire « Oui » ! Messie recherché pour libération immédiate.
Kathleen Gurrie, « Non », p. 43.
J’ai passé presque toute ma vie à écrire sur la politique québécoise, et sur la vie au Québec, pour un public du Canada anglais. J’aurais été plus utile si j’avais eu la possibilité d’écrire sur le Canada anglais pour des lecteurs du Québec.
Robert McKenzie, « ‘Un peu’, Le drame du Québec », p. 165.
Ambitieux, structuré, critique, ce bouquin mérite le meilleur sort. Il démontre, comme le printemps érable, que la remise du témoin indépendantiste à la jeunesse peut s’effectuer de façon gaillarde, détendue, rassérénée.
Déterminé, Jocelyn Caron progresse à pas mesurés. Au nationalisme, que certains dessèchent jusqu’à la paille, il redonne substance : « Finalement, s’ils ne sont pas mutuellement exclusifs, les concepts d’ethnie, de culture et de politique ne peuvent pas être synonymes ». Au Québec de réussir son équilibre. Face à une stagnation qui afflige des secteurs névralgiques (agriculture, environnement, éducation…), Caron suggère de miser sur la nation, seule capable de provoquer le bond salvateur. Ses exemples ne sont pas tous concluants, mais son dynamisme en rachète les imprécisions. Le rapport Pronovost devrait être lu sans le prisme de l’Union des producteurs agricoles, la proportionnelle ouvre sur des lendemains que Caron sous-estime, le projet Rabaska n’est pas mort, il est suspendu jusqu’au retour des prix élevés, etc. Et alors ? L’important, c’est ce pari confiant sur la nation.
Jocelyn Caron, Choisir le progrès national, Druide, Montréal, 2013, 475 p. ; 27,95 $.
La déclaration de Jacques Parizeau, premier ministre et chef du camp du « oui » concernant « l’argent et le vote ethnique » au soir du référendum, bien qu’elle était mal avisée et, surtout, qu’elle dégageait une forme de mépris qui ne peut être tolérée en démocratie, était pourtant factuelle…
p. 57
Aujourd’hui, l’indifférence envers les questions d’éducation, alors que c’est précisément l’éducation qui a propulsé les baby-boomers aux contrôles de l’économie québécoise, est stupéfiante.
p. 207
Arrivée au Québec en 1977, Régine Robin clame que jamais, elle ne s’est sentie chez elle en sol québécois. En pages fulminantes, dénonciations au poing, elle cherche et estime trouver mille preuves d’un nationalisme québécois étriqué, nombriliste, paranoïaque. « J’aurais aimé, écrit-elle, avoir un ou une amie intime, Québécois(e), bien sûr, avec lequel (ou laquelle) j’aurais pu parler du Québec tout à loisir… », « mais, conclut-elle, cette grâce ne me fut pas donnée ». On ne peut guère s’en étonner, tant cette universitaire de haut vol s’est depuis toujours emprisonnée comme à plaisir dans une cuirasse aux barbelés menaçants. Dans un vocabulaire apparenté à celui de Marc Angenot (ressentiment omniprésent), elle dénonce le « ressassement obsessionnel de la fixité mémorielle ». En matière sociale, elle croit trouver dans la paranoïa québécoise la source d’une inertie dont le Dominion tout entier ferait les frais : « Il y aurait tant de luttes sociales à mener à l’échelle canadienne, si le nationalisme québécois n’empêchait pas une gauche digne de ce nom d’exister ». Comme si le Canada attendait un signal du Québec pour virer à bâbord !
La charge est si globale qu’elle décourage toute discussion et rend futile tout espoir de nuance. Le « nous » québécois, pourtant scindé presque à parts égales entre fédéralistes et indépendantistes, constitue à ses yeux une orthodoxie vindicative, alors que le vote monolithique des bastions anglophones symboliserait la liberté. Des propos entendus devant la commission Bouchard-Taylor, elle soutire la preuve d’une « régression considérable » : « La religion – contre laquelle s’est faite en partie la Révolution tranquille – est appelée à la rescousse en tant que pilier identitaire de la majorité, fût-ce à titre de tradition, d’héritage culturel, de patrimoine à défaut de pratique ». À la décharge de Régine Robin, disons que d’autres, obnubilés comme elle par un pan d’âneries magistrales, ont aussi mal interprété le travail de la commission Bouchard-Taylor.
Qui veut tuer son chien prétend qu’il a la rage. En l’occurrence, le chien mérite mieux.
Régine Robin, Nous autres, les autres, Boréal, Montréal, 2011, 352 p. ; 27,95 $.
Les propos que je tiens sur le Canada ne sont en rien naïfs ou « jovialistes » comme on dit ici, et au moment où j’écris, c’est un gouvernement en tous points exécrable qui est installé à Ottawa. Mais cela n’aura qu’un temps.
p. 20
La mémoire hystérisée, agressive, met en œuvre un antagonisme perpétuel, car elle ne sait pas creuser la distance historique entre le moment où les événements traumatiques se sont produits et aujourd’hui. Elle ne peut être que revancharde et l’expression d’un inextinguible ressentiment.
p. 21












