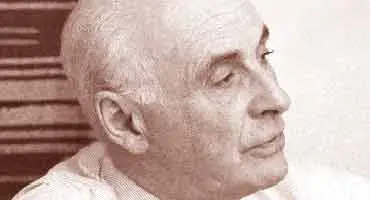« Je suis quelqu’un qui travaille comme une taupe, pour faire une chambre et non un monument. »
Intervention de F.P. au Colloque de Cerisy, 1977.
À consulter la très utile Bibliographie de Francis Ponge publiée par Bernard Beugnot, Jacinthe Martel et Bernard Veck (Memini, Paris, 1999), qui recense plus de 1500 entrées (ce qui est fort peu, si on compare, pour prendre un auteur de la même époque, aux plus de 10 000 entrées de la fortune critique d’un Sartre), on se rend compte que plusieurs des vastes contrées ouvertes par l’un des grands artistes contemporains de la fusion du réflexif et du conceptuel demeurent encore en jachère.
Heureusement, le centenaire de naissance de Francis Ponge (1999) n’a pas favorisé, loin s’en faut, que l’assemblage de pièces sans importance. Outre le lancement du premier volume des Œuvres complètes dans la « Bibliothèque de la Pléiade », qui réunit avec une stratégie subtile et respectueuse de la complexité de leur genèse et de leur chronologie tous les ouvrages parus entre 1926 et 19651, l’anniversaire a donné lieu à quelques publications éclairant la réception du poète, de même qu’à un important colloque dont on attend avec impatience la parution des actes2.
Ainsi, malgré la multiplication – modérée, il est vrai – des travaux sur Francis Ponge ces dernières années, en particulier dans le domaine de la génétique textuelle, beaucoup reste à faire : archivage scientifique, saisie sur support numérique, éditions critiques, études de fond sur d’importants massifs laissés dans l’ombre, bref une immense entreprise de réévaluation qui s’étendra évidemment sur des décennies. Pour le moment, même l’accès aux correspondances se fait laborieuse. À part les ensembles identifiés à ce jour par Bernard Beugnot3 ou ceux qu’on a publiés, en totalité ou en partie, dans divers recueils, il y a bien sûr les lettres échangées durant près d’un demi-siècle avec Jean Paulhan, l’un de ses maîtres, avec Jean Tortel, l’ami des Cahiers du Sud, de même qu’avec Carlos Seibel4 et divers autres (Philippe Jaccottet, H.-L. Mermod, Philippe Sollers, Elizabeth Walther, etc.). Là encore, un imposant chantier demeure ouvert.
La résistance fondatrice
Compte tenu des perspectives de lectures actuellement offertes, il serait vain de chercher à statuer sur la pertinence ou la justesse des interprétations. Quant à moi, je dirais que l’une des particularités de Francis Ponge réside dans sa capacité à rendre humainement manifeste par et dans la langue française la matérialité de la résistance aux discours dominants en même temps que les potentialités créatrices et pour ainsi dire libératrices, ou fondatrices, de cette résistance. C’est en ce sens que son œuvre, en croissant, me semble aussi révolutionnaire, intempestive et actuelle que, disons, celle de Freud, dont Lacan, dans son séminaire de 1953-1954 consacré aux écrits techniques du père de la psychanalyse, rappelait d’ailleurs avec Mannoni comment il concevait la saisie de la résistance dans l’expérience même du discours du sujet : « Freud prend carrément le discours comme une réalité en tant que telle, une réalité qui est là, liasse, faisceau de preuves comme on dit aussi, faisceau de discours juxtaposés qui les uns sur les autres se recouvrent, se suivent, forment une dimension, une épaisseur, un dossier. » On ne saurait mieux parler de l’expérience pongienne du monde telle qu’elle se développe d’un bout à l’autre de son œuvre, y compris depuis Le parti pris des choses, expérience que le judicieux protocole adopté par les éditeurs de la « Pléiade » permet de voir en action. Lorsque le poète observe ce qui l’entoure et le constitue, tissu dans lequel il se fond, mais qu’il transforme inévitablement par sa seule présence, un abyssal travail de mémoire s’enclenche, que rend progressivement sensible, avec les années (et de manière évidente avec la publication, en 1952, chez Mermod, de La rage de l’expression), le report de plus en plus constant du poème achevé et la publication de plus en plus systématique et nécessaire des dossiers d’écriture. À la manière d’Emmanuel Levinas, quoique dans un tout autre registre, Francis Ponge découvre une nouvelle façon d’envisager l’étant, fondée en partie sur la radicalité de l’interrogation husserlienne, l’objet et la réalité qui lui permet de se manifester prenant soudain vie, engageant leur visibilité par le biais de l’intentionnalité de la conscience.
La raison biographique
Or, si cette perspective apparaît très sensible dès Le parti pris des choses, la certitude, comme chez le philosophe, se voit rapidement troublée, ainsi que l’ont montré de nombreux commentateurs, par la présence de Freud et de Nietzsche, d’où une trajectoire beaucoup plus complexe et retorse qu’on a voulu le prétendre. Dans son introduction aux Œuvres complètes, Bernard Beugnot a tout à fait raison d’affirmer que la ténacité de Ponge se définit beaucoup moins par son formalisme, parfois patent, que par sa très haute exigence morale, dont certains accents font écho à sa culture protestante, ses démarches introspective et rétrospective se croisant alors dans le vertige pascalien d’un homme dont le but, sous la technique, avant elle, est l’HOMME. Dans ces conditions, l’aspect biographique de ce chantier qu’on peut méditer comme un éternel journal intime, un journal d’exploration textuelle, devient incontournable, ce pourquoi la riche chronologie établie par Bernard Beugnot et Bernard Veck dans la « Pléiade » à partir des archives familiales trouve toute son utilité. Comment, sans connaître la vie (pour rétrograde que puisse paraître cette idée) de quelqu’un qui a dès son plus jeune âge décidé de consacrer sa vie à l’écriture, de tout lui donner et d’en tout retirer, jusqu’à la difficile contraction de l’être, puis-je absorber ces lignes du Porte-plume d’Alger, qui agitent les deux pôles de l’existence, expérimentés à l’occasion du voyage : « Entre l’action et la contemplation, c’est un étrange état que celui du voyage. Dans un corps agité par un mouvement qui ne lui est pas propre, l’esprit trouve un repos absolument contraire au sommeil. Car s’il doit, dans l’action, se tenir appliqué, forgeron convaincu des enchaînements qu’il conçoit, et si, dans la contemplation, il lui faut combiner encore, avec une certaine passivité, l’attention à tenir grande ouverte sa porte pour n’y laisser entrer qu’un objet seulement, il se soumet par le voyage à un abandon toujours réveillé, en raison du nombre, de la variété et du rythme ahurissant des impressions qu’il reçoit » ? Ce ne sont certes pas Raymond Roussel, Blaise Cendrars ou Victor Segalen qui désapprouveraient cette nécessité d’une attention incessante du corps aux vibrations et à la floculation de la nature, aux mouvements browniens parfois imperceptibles saisis au détour de l’expression. Qu’on le veuille ou non, il faut, parlant de poésie et de littérature, y aller de la vie, la vraie, ici et ailleurs, puisque le monde perçu ne peut en définitive l’être que dans la dépendance de celui ou de celle qui le perçoit. Quand FrancisPonge parle de cette crevette, signe d’elle-même et du langage, ou de ce lézard, zébrant le mur, ou de ce soleil jouissant de son encre, chacun de ces objets change, pour autant que l’on accepte qu’ils existent en fonction de la source de la pulsion du sujet de l’écriture. Cette source conduisant à l’originaire, à un objet-source dont Jean Laplanche soutient qu’il renvoie à un objet inconscient, originaire, plutôt qu’à un objet du monde sensible, voilà bien ce que le poète de la pomme de terre et du mimosa tente patiemment, lucidement, de retrouver à travers ses infinies variations musicales et picturales.
Imaginaire de l’intériorité
Ce n’est par conséquent pas par hasard que Francis Ponge fait de chaque nouvelle pièce un espace potentiel de jeu ou mieux d’objeu, selon son propre néologisme. On a longuement discuté de sa fameuse équation PARTI PRIS DES CHOSES = COMPTE TENU DES MOTS, de ses tentatives de définitions-descriptions, de son utilisation massive du Littré ou de l’aspect monumental de sa pratique (y compris sous son angle politique), de l’importance qu’il accordait aux inscriptions latines, en rapport avec l’élaboration du récit posthume, sans oublier la notion de moviment, symbole du texte conçu comme acte d’expression, « saignée », « voie frayée vers l’œuvre5 », et non simplement comme résultat d’une production. On a également montré les relations entre l’espace cosmique et les petits objets qui se prennent dans le creux de la main et qu’affectionnait particulièrement Ponge, de même qu’on a analysé chacun des règnes qui se déploient dans son corpus. Je me demande pourtant si son imagination n’est pas d’abord et avant tout structurée par le végétal, orientée par la plongée vers l’intérieur des choses, leur fragilité intrinsèque, leur foyer d’incandescence. Ne serions-nous pas alors en présence d’une autre de ces écritures magiques, ou sacrées, cherchant à retrouver le secret de la mère, de l’habitation primordiale, de l’habitacle, du sol, voire de ce moment où, dans son évolution, le vivant aurait inversé son dedans et son dehors, la coquille des premiers êtres (tortue, huître, etc.) se déplaçant vers l’intérieur ? Davantage qu’une spéculation gratuite, il me semble qu’il y a dans cette question une piste de recherche qui nous ferait enfin sortir des exercices académiques pour penser véritablement l’œuvre de Francis Ponge6. Ainsi parviendrait-on peut-être un jour à ne plus séparer l’œuvre de son mouvement, l’écorce de son noyau. Sait-on assez à quel niveau de fonctionnement le poète a porté le symbole, hors de toute fascination ? A-t-on vraiment estimé les résonances qui se rencontrent dans ce qu’il appelait lui-même le nSud, c’est-à-dire, au-delà du phénomène, « l’essentiel » d’un objet, altérité totale, lorsqu’il l’épie, recueilli dans l’obscurité lumineuse de sa chambre ?
1. Francis Ponge, Œuvres complètes, tome I, 1926-1965, sous la dir. de Bernard Beugnot, avec la collaboration de Michel Collot, Gérard Farasse, Jean-Marie Gleize, Jacinthe Martel, Robert Melançon et Bernard Veck, Gallimard, Paris, 1999, 1210 p. Le second volume (1965-1988) comprendra le reste des ouvrages, de Pour un Malherbe jusqu’au troisième tome du Nouveau nouveau recueil, en plus de quelques textes hors recueils, des textes inédits et des entretiens.
2. Ponge résolument. Actes du colloque tenu à la fois à l’École normale supérieure de Fontenay/Saint-Cloud (1er au 3 avril 1999) et à l’Université de Philadelphie (9 avril 1999). Les recueils d’études suivants doivent également paraître sous peu : Francis Ponge, Preuves et épreuves, Presses universitaires de Lyon, Lyon ; L’établi du texte, sous la dir. de Michel Peterson, Minard, Paris. En 1999, signalons le dossier spécial de la revue œuvres et critiques, vol. XXIV, no 2.
3. Voir « Les amitiés et la littérature : Francis Ponge épistolier », par Bernard Beugnot, dans Romanic Review, vol. 85, no 4, 1995, p. 615-628.
4. Correspondance Francis Ponge/Jean Paulhan, tome I, 1923-1946 ; tome II, 1946-1968, édition établie par Claire Boaretto, Gallimard, Paris, 1986 ; Correspondances Francis Ponge/Jean Tortel, 1944-1981, édition établie par Bernard Beugnot et Bernard Veck, Stock, Paris, 1988 ; Francis Ponge, Treize lettres à Castor Seibel, L’Échoppe, Paris, 1995.
5. Francis Ponge, Actes ou textes , par Jean-Marie Gleize et Bernard Veck, Presses universitaires de Lille, Lille, 1984, p. 30.
6. C’est l’une des pistes majeures que j’explore dans un ouvrage actuellement en préparation et qui a pour titre (provisoire) Francis Ponge : la langue à bout portant.
Francis Ponge a publié, entre autres :
Pour un Malherbe, Gallimard, Paris, 1965 et 1977 ; Le parti pris des choses, Gallimard, Paris, 1965, 1988 et 2001 ; Nouveau recueil, Gallimard, Paris, 1967 ; La fabrique du pré, Skira, Genève, 1971 et 1990 ; Le grand recueil, tome 1 : Lyres, Gallimard, Paris, 1976 et 1980 ; La rage de l’expression, Gallimard, Paris, 1976 ; L’atelier contemporain, Gallimard, Paris, 1977 ; Le grand recueil, tome 2 : Méthodes, Gallimard, Paris, 1977 ; Le grand recueil, tome 3 : Pièces, Gallimard, Paris, 1977 ; Nioque de l’avant-printemps, Gallimard, Paris, 1983 ; Petite suite vivaraise, Fata Morgana, Saint-Cément, 1983 ; Pratiques d’écriture ou l’inachèvement perpétuel, Hermann, Paris, 1984 ; Correspondance, tome 1 : 1923-1946, avec Jean Paulhan, Gallimard, Paris, 1986 ; Correspondance, tome 2 : 1946-1968, avec Jean Paulhan, Gallimard, Paris, 1986 ; Pièces, Gallimard, Paris, 1989 ; Entre mots et choses, Champ vallon, Seyssel, 1991 ; Nouveau nouveau recueil, Gallimard, Paris, 1991 ; Comment une figue de paroles et pourquoi, Flammarion, Paris, 1997 ; Œuvres complètes, tome 1, « La Pléiade », Gallimard, Paris, 1999 ; Correspondance 1944-1981, avec Jean Tortel, Stock, Paris, 1999 ; Entretiens, avec Philippe Sollers, Seuil, Paris, 2001.