Semble-t-il qu’un seul plaisir comble mieux que celui de parler de soi. Ce serait celui de faire parler de soi. Que cela s’avère et ceux qui écrivent leur autobiographie s’abstiendront peut-être de se raconter en échange de l’assurance que quelqu’un d’autre dira tout le bien qu’ils pensent de leur personne.
Ce serait dommage, car certaines autobiographies, rares il est vrai, méritent lecture autant que les meilleures biographies. Il est facile de le démontrer.
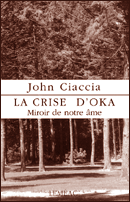
Pour diverses raisons, Joséphine Marchand1 entre tôt dans le monde culturel québécois. Fille du premier ministre Félix-Gabriel Marchand, homme cultivé et d’esprit ouvert, elle est vite initiée à toutes les formes d’écriture. Elle tiendra chronique, rédigera comme en s’amusant des pièces de théâtre, en plus d’intervenir de façon discrète mais efficace dans maintes activités artistiques. Son Journal Intime est un document qui la révèle mieux encore dans ses apprentissages que dans sa maturité. Elle y inscrit ses premières confidences à l’âge de dix-sept ans, révélant du même coup ce qu’était la société québécoise de la fin du XIXe siècle, à quoi rêvait les jeunes filles, ce qui était réputé acceptable et comment une future maîtresse de maison jugeait déjà les domestiques.
Quand l’amour aura parlé en faveur du cher Raoul, le journal de Joséphine Marchand changera de tonalité et perdra une partie de son intérêt. C’est à Raoul Dandurand que Joséphine écrira, de Raoul qu’elle parlera, sa carrière qu’elle soutiendra jusqu’au sénat inclusivement. Le journal cesse alors d’être un confident quotidien. Il continue d’être admirablement écrit, mais insiste désormais sur la vie publique et sociale et néglige l’intimité.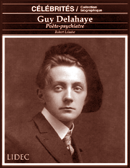
En livrant sa version de La crise d’Oka2, l’ancien ministre libéral John Ciaccia montre beaucoup de courage et fait œuvre utile. Tous ne livreront pas la même analyse des événements de 1990, mais tous devraient apprécier que certaines choses soient dites enfin. Avec clarté, émotion, douleur. Sans vanité, partisanerie, calcul. On sait désormais que l’affrontement d’Oka aurait pu être évité, qu’on aurait pu au moins en freiner le cours dévastateur, qu’on s’est entêté, même après mort d’homme, à paresser, à ergoter, à vaquer aux pires calculs partisans. John Ciaccia n’est pas tendre pour la Sûreté du Québec qu’il soupçonne d’en être encore aux charges de cavalerie contre les Indiens, pas plus tendre pour les politiciens comme Tom Sidden ou Robert Bourassa qui ne s’élèvent jamais au-dessus du petit quotidien, mais il est particulièrement dur pour ceux, universitaires recyclés en ministres ou fonctionnaires bornés, qui prétendent gérer le réel comme si les règles abstraites faisaient foi de tout. De tels livres sont si rares qu’il faut les savourer jusque dans leurs excès.Un déblaiement plus qu’une réussite.
Peut-être parce que la perspective des auteurs en est une de vulgarisation, trois biographies se qualifient comme de très acceptables déblaiements, mais demeurent à distance de la réussite. En jetant son dévolu sur l’énorme et complexe personnage qu’est Papineau3, Marguerite Paulin se lançait à elle-même un défi considérable. Elle ne le relève qu’imparfaitement ; peut-être d’ailleurs était-il impossible à relever dans le cadre d’une collection qui s’en tient, de son propre aveu, au récit biographique. Le lecteur reste néanmoins sur sa faim. Que faisait un seigneur dans un mouvement populaire qui n’aimait pas les privilèges seigneuriaux ? Comment affirmer que le vote demeure ouvert pendant tout le XIXe siècle alors que cette détestable coutume est combattue très tôt après la confédération ? Où se situaient exactement les mésententes entre les chefs de la rébellion ? Papineau était une énigme ; il le demeure.
Georges-Émile Lapalme4 est, en un sens, aux antipodes de Papineau. Son style est différent, son œuvre plus discrète, sa célébrité infiniment moindre. Comme, en plus, il passe une bonne partie de sa vie politique à recevoir les moqueries du peu subtil Maurice Duplessis, l’histoire a mis du temps à prendre conscience de ses qualités et à reconnaître le rôle pourtant majeur qu’il a joué dans la Révolution tranquille. Jean-Charles Panneton a donc raison d’apporter sa pierre à cette tardive réhabilitation. On aurait souhaité, cependant, qu’il puisse consacrer à la biographie d’un homme de culture comme Lapalme un style moins gauche et qu’il fasse sentir une plus grande empathie à l’égard de cet Alceste moderne. Telle quelle, la biographie en dit beaucoup, mais en fait sentir moins.
Robert A. Boyd5, plus encore que Georges-Émile Lapalme, est aujourd’hui méconnu. Là encore, un travail de réhabilitation s’imposait et un « hydro-québécois » aussi fervent qu’André Bolduc ne pouvait que se sentir sollicité par le défi. Il avait connu l’homme, il l’avait accompagné dans plusieurs de ses combats, il bénéficiait de la confiance de Robert Boyd et connaissait nombre de ses collaborateurs. D’où vient alors que cette biographie ne convainque pas ? Sans doute parce qu’elle est rédigée trop près de son personnage, en trop étroite complicité avec lui et avec cet État dans l’État que fut et demeure Hydro-Québec. La distance critique fait, en effet, complètement défaut. Bolduc rapporte les propos de Robert Boyd à propos des assauts du gouvernement contre l’autonomie d’Hydro-Québec et s’associe spontanément aux charges que mène l’ancien président d’Hydro-Québec contre la gent politique. Le lecteur cherche vainement la contrepartie. Tout comme il regrette de ne trouver nulle part une description le moindrement neutre de ce qu’est devenue au fil des ans la culture d’entreprise d’Hydro-Québec.Hors du champ politique, est-ce mieux ?
Les diverses formes de création artistique trouvent, et c’est heureux, leurs biographes. Mathieu-Robert Sauvé6, dont la plume vigoureuse excelle en maints domaines, se risque cette fois à portraiturer Louis Hémon. On ne blâmera certes pas Sauvé d’en prendre à son aise avec les clichés entêtés que fait lever la moindre référence à Hémon. Depuis, par exemple, qu’on connaît mieux l’intérêt de Hémon pour les sports, l’image de l’auteur se nuance, s’enrichit, déroute à l’occasion. Sauvé accentue cette tendance au point de concentrer l’attention de façon presque exclusive sur les versants moins connus du romancier. Il réussit presque trop bien son remodelage ! Une personne qui prendrait ici contact avec Hémon pour la première fois quitterait l’ouvrage de Sauvé presque sans avoir entendu parler de Maria Chapdelaine. Ce risque, je l’avoue, n’est pas bien grand et il ne faudrait pas bouder le plaisir que procure Sauvé : son Hémon vit, séduit, traque ses rêves avec un courage exemplaire. Taquinons Sauvé un instant. On veut bien croire qu’Hémon a admiré Hugo et qu’il a humblement compté les pieds dans tel alexandrin du maître. Pourquoi alors mal citer Hugo et lui faire écrire, deux fois plutôt qu’une, un alexandrin d’au moins treize pieds, quatorze si l’on oublie la mauvaise césure : « Et l’on voit de la flamme dans les yeux des jeunes gens »… ?
Le Père Émile Legault7, dont la carrière déborde largement le cadre théâtral pour englober la gamme des mass médias, reçoit de sa biographe un hommage mérité, mais trop peu critique. L’homme, certes, avait les prudences de son époque et quelques-unes en plus, mais il savait également oser et il aurait été bon que l’on sache pourquoi. Lui savait que Ghéon, avant de se consacrer à un théâtre de style apologétique, avait plutôt été de l’école de Gide et de son Immoraliste. Legault a quand même, en parfaite connaissance de cause, joué beaucoup de Ghéon. Peut-être profitait-il de l’ignorance du haut clergé et du public en général, mais il aurait été intéressant de l’entendre s’expliquer sur cette audace. Certains, malheureusement, semblent croire que « célébrer » quelqu’un, c’est ne rien dire de ses doutes, de ses hésitations ou de ses conformismes. Lidec tombe souvent dans ce travers.
Corrigeons tout de suite ce que ce jugement peut avoir d’abrupt : Lidec sait aussi, dans les circonstances les plus inattendues, tempérer l’éloge et parler vrai. C’est le cas à propos de Guy Delahaye, poète-psychiatre8. La réussite, car c’en est une, étonne d’autant plus que le biographe est aussi le fils de celui dont on parle. En plus de révéler cette parenté dès le tout premier paragraphe, Lahaise s’exprime à propos de l’étonnant poète que fut son père avec, certes, la pudeur qui sied, mais aussi avec une parfaite clarté de propos. Nulle complaisance, nulle dissimulation. Les faits d’ailleurs témoignent : 70 recensions louangent ou démantibulent, dès 1910, les poèmes de Delahaye. Grâce à lui surtout, le Québec poétique tâte du dadaïsme avant la France. Quand frappera la typhoïde en 1913, Delahaye, secoué au plus profond de l’être, entrera en lui-même, s’accrochera à Dieu et invitera sa foi et sa pratique médicale à infléchir le cours de sa poésie. L’homme passera plus de trente ans de sa vie à pratiquer sa science dans les limites de Saint-Jean-de-Dieu et y élèvera sa famille tout en se sentant toujours coupable, déclare nettement son fils, de ne pas s’être fait religieux. Robert Lahaise, au passage, n’hésitera pas, lui qui connaît mieux que quiconque le parcours québécois du dernier siècle, à se porter à la défense de ceux et celles qui dotèrent le Québec de son réseau hospitalier et qui reçoivent aujourd’hui plus de critiques que de remerciements. Voilà un portrait émouvant d’une figure méconnue par un fils qui, même en parlant de sa famille, maintient de hauts standards professionnels d’historien et d’ethnologue.
La nouvelle édition de Médard Bourgault sculpteur9 multiplie à plaisir les illustrations et les emprunts aux carnets de l’artiste. Angéline Saint-Pierre, discrète, facilite ainsi le contact entre le lecteur et Bourgault. Quand Bourgault s’éloigne de l’art religieux pour se consacrer à l’art paysan avant de revenir à sa première préférence ou quand il ose s’intéresser au nu, les confidences et les reproductions sont là pour confirmer les virages et les maturations. Le mystère n’est pas pour autant vidé de sa substance : Bourgault n’a pas attendu les conseils des connaisseurs pour tenir son journal et sa relation avec l’écriture restera toujours étonnante et, disons-le, inexpliquée. (On ne sait trop à cet égard d’où viennent certaines notations géographiques plutôt déroutantes : la Garonne en Bretagne, Wakar au Sénégal…) Bourgault n’a pas davantage attendu l’approbation de sa famille et de son milieu avant d’investir dans son exploration artistique le meilleur de ses énergies. Angéline Saint-Pierre livre de Bourgault le portrait d’un artiste inattendu, mais aussi celui d’un homme généreux de ses secrets, nourri de sa contemplation constante du réel, amoureux de la mer autant que des autres richesses de la nature. Du bon travail.
Le sport aussi attire les biographes, surtout quand l’an 2000 est marqué par le décès de Maurice « Rocket » Richard. Jacques Lamarche10, toujours précis, documenté de fiable façon, applique à la légendaire figure de Richard son aptitude à débusquer des sources nouvelles, à faire parler des témoins inattendus, à regrouper les coupures de presse significatives. En plus des traditionnelles statistiques grâce auxquelles les amateurs comparent les athlètes et les classent dans leur panthéon personnel, on a donc droit, grâce à Lamarche, à des instantanés chaleureux, pris au ras du sol et révélateurs du lien étroit qui rattachait Richard à son peuple. Longtemps après sa retraite, le bouillant Richard était partout précédé de sa légende. Partout, il tendait la main, souriait, signait des autographes, remettait le trophée ; Lamarche le démontre. Ses bouillons de colère, Richard les avait épuisés sur ses adversaires.
Roch Carrier11, conteur admirable et admirateur du célèbre numéro 9, place sur les épaules de Maurice Richard infiniment plus qu’une responsabilité athlétique. Le joueur de hockey ne traîne pas seulement ses adversaires sur son dos, mais aussi un petit peuple québécois rempli d’incertitude, voué par l’anglophonie à des rôles subalternes et sans gloire. L’adolescent Carrier, comme tant de ses contemporains, rêve de réussite ; Richard intervient, bouscule les adversaires, conquiert la coupe Stanley et rend plausible le désir de réussite. Richard administre au Québec une véritable thérapie collective, montre la voie de la fierté. Carrier en rajoute sans doute un peu, mais l’hommage rendu à Richard au moment de ses funérailles donne du poids à son interprétation. On s’étonnera du nombre d’erreurs dans l’épellation des noms propres. Tous les lecteurs ne sont pas obligés de connaître Gerry McNeil, Bronco Horvath ou Bill Quackenbush, mais écrire à leur sujet en massacrant leur nom a quelque chose de disgracieux. Tout comme est étonnante la critique qui frappe plusieurs fois Walter Gordon alors que Carrier vise plutôt Donald Gordon.Femmes d’ailleurs et d’hier
Certaines figures féminines traversent les âges avec un magnétisme inentamé. Exemples parmi tant d’autres : Consuelo de Saint-Exupéry12, Joséphine de Beauharnais13 et Madame de La Fayette14.
Le culte que l’opinion voue indéfectiblement à l’auteur du Petit Prince a forcément compromis les chances que pouvait avoir sa versatile épouse d’obtenir jamais justice. Après tout, la femme que le père du Petit Prince honore de son intérêt ne devrait-elle pas se satisfaire en silence et à domicile du reflet de sa gloire ? Paul Webster, grand connaisseur de Saint-Exupéry, est trop peu machiste pour commettre cette injustice. Certes, la jeune Salvadorienne qui ensorcèle Antoine en a déjà envoûté plusieurs et elle ne cessera guère de le faire. Webster tient pourtant la balance égale entre Consuelo et Antoine : ni l’un ni l’autre ne sont du bois dont on fait les amours exclusives. Les deux se sont aimés durablement, se réservant malgré tout l’un à l’autre une part d’eux-mêmes à laquelle nulle autre affection n’accédait. Et surtout, du point de vue de la littérature, Consuelo aura été, sans l’ombre d’un doute, la rose du Petit Prince et l’inspiratrice de la fable tout entière. En un sens, dit Webster, Antoine répare par sa fable la dette qu’il ressent à l’égard de Consuelo. Cette équité de Webster mérite tous les éloges.
La biographie que consacre l’américaine Carolly Erickson à la tumultueuse puis larmoyante épouse de Napoléon s’efforce à une équité comparable. Cette fois aussi, les torts sont partagés. Ni l’un ni l’autre n’étaient de nature conciliante ou même prudente. Ils se firent illusion tant que le désir demeura volcanique entre le Corse et la Martiniquaise, mais un rapport de force s’instaura bientôt qui favorisa Napoléon et transforma Joséphine en fontaine de larmes. La biographe ne transforme pas Joséphine en ingénue ni même en bonne stratège de l’art amoureux, mais elle impute quand même plus qu’une moitié des excès au clan Bonaparte. Car jamais le clan corse ne cessa d’exercer contre Joséphine une vendetta d’une minutieuse et morbide cruauté. Ce que Napoléon aurait peut-être accepté ou toléré, ni ses sœurs ni ses frères ne le souffraient. Même si Napoléon devait une part de son ascension à Joséphine, il s’aligna contre elle avec son clan. Même l’exil ancrera Napoléon dans un blâme excessif et carrément tribal. Joséphine n’avait pas le blindage pour résister à des assauts aussi vicieux et aussi soutenus.
Avec Roger Duchêne, la biographie devient un des beaux-arts. Les faits sont dûment exhumés et rattachés par des charnières impeccables, les versions se recoupent ou se contredisent, les témoignages sont prudemment calibrés à l’aune de la crédibilité et des sentiments. Puis, le chapitre se termine sur une synthèse où Duchêne propose un départage des hypothèses et isole les lignes de force. La démarcation est suffisamment nette entre l’indiscutable récit de l’histoire et le commentaire éditorial pour que le lecteur se sente en droit d’interpréter les faits autrement que l’historien. Comme quoi l’admirable compétence de Duchêne s’accommode d’un constant et rare respect pour son auditoire.
Autour de Marie-Madeleine de La Fayette, Duchêne ressuscite une époque. La monarchie décide de tout, la noblesse comptabilise ses titres et ses rentes, la culture se concentre en certains lieux et en des mains prestigieuses. Tout comprendre et tout lire est bien vu, mais un noble, et moins encore une femme noble, ne jugerait correct de signer de son nom un quelconque ouvrage. Cela n’est permis qu’à des classes sociales moins huppées. Madame de La Fayette niera donc jusqu’à la fin avoir écrit La princesse de Clèves, même si elle ne ménagea rien pour que le livre connaisse le succès. Duchêne montrera aussi avec quelle rigueur professionnelle les plus grands écrivains du temps, qu’il s’agisse de Madame de La Fayette ou de La Rochefoucauld, de Ménage ou de Madame de Sévigné, soumettaient leurs textes à leurs pairs, sollicitaient et suivaient leurs avis, reprenaient humblement ce qui avait déplu. On est loin de l’époque où la tentation sévit de signer ce qu’on n’a pas écrit ou de considérer comme intangible la moindre virgule d’une improvisation… (Ce qui ne veut pas dire que Louis XIV ou Napoléon me paraissent un idéal à imiter !) Et les rééditions ?
Curieusement, rééditer s’avère un art de maîtrise aussi difficile que celui de la première parution. L’opportunisme de l’éditeur influe tout autant, tout comme la paresse de l’auteur. Seules surnagent certaines rééditions opiniâtres.
Paul Dreyfus15 laisse paraître de nouveau en 2000 une biographie de Jean XXIII qui, il y a vingt-deux ans, ne suscitait déjà qu’un intérêt mitigé. Pourquoi alors rééditer ? Parce que Jean-Paul II, obsédé par son besoin de toujours proposer de nouveaux exemples de sainteté aux catholiques et, plus encore, désireux de se faire pardonner la béatification d’un pape peu sympathique par celle d’un pape chaleureux, vient de ramener dans l’actualité la ronde figure du cardinal Roncalli. Prétexte transparent et insuffisant pour justifier la réédition d’une assez mauvaise biographie.
Le paradoxe est presque sans précédent : Dreyfus, qui bénit systématiquement tout ce qu’a pu décider Jean XXIII et qui peut présumer sans risque que tout le monde aime ce pape, réussit quand même à nous quitter sur une image de Jean XXIII moins cordiale qu’au départ. C’est que Dreyfus sait reproduire le plan d’une encyclique, mais n’en comprend pas les enjeux. Il sait qu’il fut question des prêtres ouvriers français sous le règne de Jean XXIII, mais il semble ignorer ce que fut alors la réaction des Dominicains. Il n’explique pas davantage par quelle aberration le sympathique Jean XXIII laissa les directoires vaticans sous la coupe de la gérontocratie ni pourquoi des censeurs anachroniques comme le cardinal Ottaviani purent continuer à saper les moindres efforts de modernisation. Dreyfus avait, il y a vingt-deux ans, l’excuse de la trop grande proximité ; il échappe difficilement aujourd’hui à l’accusation de superficialité.
Paul Webster16, qui ne modifie pas davantage son texte de 1993 consacré à Antoine de Saint-Exupéry, n’encourt quand même pas les mêmes reproches. Il avait, dès la première version, dit l’essentiel. Il se borne donc, à l’heure de la réédition, à ajouter deux ou trois pages à l’entrée et quelques paragraphes à la sortie, de manière à tenir compte de ce qu’a pu révéler depuis lors la découverte, au large de Bandol, en Méditerranée, d’une gourmette portant le nom de Consuelo. C’est peu, mais comment exiger qu’un biographe revienne sur ce qu’il a dit et bien dit ?
Micheline Lachance17 réussit quand même à présenter une réédition qui dépasse l’excellence de la première édition. Certes, elle reprend l’essentiel de ce qu’elle avait publié en 1982 et en 1986, mais elle revient patiemment sur le texte initial, le modifie, l’étoffe, lui donne ce qui est souvent une facture plus moderne et, disons-le, plus abrupte. Micheline Lachance, en 1982 et en 1986, avait navigué entre les exigences de la vérité historique et les réticences que lui imposaient les vanités impériales du cardinal Léger. Elle n’avait jamais dit de faussetés ; elle avait remis à plus tard certaines analyses. C’est ce que la réédition peut donner.
Sans jaunisme aucun, sans non plus dévaloriser la biographie parue en deux temps en 1982 et en 1986, Micheline Lachance parle quand même plus net à l’occasion de cette réédition. Paul-Émile Léger faisait partie d’une époque et ne correspondait pas, même à son propre jugement, à la suivante. Il était allergique au travail d’équipe. Il s’arrogeait, même sur sa propre parenté, un pouvoir si exorbitant qu’on peut presque lui imputer des drames humains inutiles et scandaleux. Il n’a jamais été, en terre de mission, le missionnaire effacé qu’il avait promis de devenir. Ses œuvres africaines ont dépensé de façon erratique, souvent stérile et toujours désadaptée. Tout cela, ce n’est pas ce que dit Micheline Lachance ; c’est ce qu’on peut déduire sans risque des faits qu’elle livre à l’opinion publique avec retenue, loyauté à l’égard de ceux qui lui ont parlé et empathie avec notre besoin de comprendre. Ce qui était une très honnête biographie devient une exemplaire réédition.
La biographie, même en revenant sur ses propres traces, éclaire ainsi l’avenir autant que le passé.
1. Joséphine Marchand, Journal intime, 1879-1900, La Pleine Lune, Lachine, 2000, 275 p. ; 24,95 $.
2. John Ciaccia, La crise d’Oka, Miroir de notre âme, Leméac, Montréal, 2000, 355 p. ; 25,95 $.
3. Marguerite Paulin, Louis Joseph Papineau, Le grand tribun, le pacifiste, XYZ, Montréal, 2000, 182 p. ; 15,95 $.
4. Jean-Charles Panneton, Georges-Émile Lapalme, Précurseur de la Révolution tranquille, VLB éditeur, Montréal, 2000, 164 p. ; 21,95 $.
5. André Bolduc, Du génie au pouvoir, Robert A. Boyd, À la gouverne d’Hydro-Québec aux années glorieuses, Libre Expression, Montréal, 2000, 262 p. ; 24,95 $.
6. Mathieu-Robert Sauvé, Louis Hémon, Le fou du lac, XYZ, Montréal, 2000, 183 p. ; 15,95 $.
7. Hélène Jasmin, Père Émile Legault, Homme de foi et de parole, Lidec, Montréal, 2000, 62 p. ; 9,95 $.
8. Robert Lahaise, Guy Delahaye, Poète-psychiatre, Lidec, Montréal, 2000, 62 p. 9,95 $.
9. Angéline Saint-Pierre, Médard Bourgault sculpteur, La Plume d’Oie, Cap-Saint-Ignace, 2000, 150 p. ; 19,95 $.
10. Jacques Lamarche, Maurice Richard, Album souvenir, Guérin, Montréal, 2000, 132 p. ; 28 $.
11. Roch Carrier, Le Rocket, Stanké, Montréal, 2000, 271 p. ; 21,95 $.
12. Paul Webster, Consuelo de Saint-Exupéry, La Rose du Petit Prince, Du Félin, Paris, 2000, 158 p. ; 27,95 $.
13. Carolly Erickson, Joséphine de Beauharnais, trad. De l’américain par Jean-Baptiste Grasset, Grasset, Paris, 2000, 408 p. ; 39,95 $.
14. Roger Duchêne, Madame de La Fayette, Fayard, Paris, 2000, 523 p. ; 44,95 $.
15. Paul Dreyfus, Jean XXIII, Le Sarment, 2000, 486 p. ; 36,95 $.
16. Paul Webster, Saint Exupéry, Vie et mort du petit prince, Du Félin, Paris, 2000, 297 p. ; 42,95 $.
17. Micheline Lachance, Paul-Émile Léger, t. 1 : Le prince de l’Église, De l’Homme, Montréal, 2000, 410 p. ; 26,95 $ ; t. 2 : Le dernier voyage, De l’Homme, Montréal, 2000, 361 p. ; 26,95 $.










