Les chiffres en provenance de l’Observatoire québécois sur la culture et les communications confirment l’impression du lecteur : dans le monde de l’édition, toutes les saisons ne se valent pas. Janvier aura été plantureux, le trimestre de juin à août plutôt paisible. En littérature jeunesse, ce trimestre aura raréfié les albums et recouru surtout aux auteurs familiers pour s’adresser aux tout jeunes. Il aura, cependant, fait la part plus belle à la zone infiniment poreuse qui unit, plus qu’elle ne sépare, l’adolescent et le lecteur adulte.
 Lecture et puériculture
Lecture et puériculture
Constatons-le une fois de plus : bien des livres tournés vers l’enfance se veulent une contribution éducative en même temps qu’une distraction. Reste à réussir le dosage.
Angèle Delaunois (Niouk, le petit loup), qui ne dissimule pas sa sympathie pour un animal que la littérature a souvent mal traité, met en scène un petit loup qui ressemble comme un frère, présomption et irréflexion comprises, à combien de nos bambins. Le louveteau regrettera son imprudence, mais retrouvera vite l’affection qu’il craignait avoir perdue.
Angèle Delaunois, Niouk, le petit loup, Pierre Tisseyre, Montréal, 2001, 64 p. ; 7,95 $.
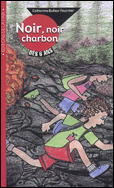 Noir, noir charbon (Catherine Dufour Fournier) oppose, avant de les éveiller à l’amitié, un jeune New-Yorkais et une débrouillarde Hawaïenne de la même génération. L’action ne manque pas et les préjugés détalent bientôt à toutes jambes. La psychologie est plutôt sommaire et les virages assez brusques, mais quand on saura que l’auteure compte à peine une douzaine de printemps, on admirera le résultat. Il plaira d’ailleurs aux contemporains de l’auteure.
Noir, noir charbon (Catherine Dufour Fournier) oppose, avant de les éveiller à l’amitié, un jeune New-Yorkais et une débrouillarde Hawaïenne de la même génération. L’action ne manque pas et les préjugés détalent bientôt à toutes jambes. La psychologie est plutôt sommaire et les virages assez brusques, mais quand on saura que l’auteure compte à peine une douzaine de printemps, on admirera le résultat. Il plaira d’ailleurs aux contemporains de l’auteure.
Catherine Dufour Fournier, Noir, noir charbon, De la Paix, Saint-Alphonse-de-Granby, 2001, 80 p. ; 7,95 $.
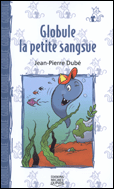 Sujet inattendu que celui-là : qui, en effet, songerait, sinon un auteur respectueux de la curiosité enfantine, à se pencher avec sympathie sur les sangsues ! Jean-Pierre Dubé (Globule, la petite sangsue et Globule et le ver de terre) réussit le tour de force de ne rien dire qui soit faux à propos de son petit vampire tout en le rendant (presque) sympathique. Les enfants, quant à eux, en déduiront que chacun a droit à son mode de vie, la sangsue comme le ver de terre. Tant mieux !
Sujet inattendu que celui-là : qui, en effet, songerait, sinon un auteur respectueux de la curiosité enfantine, à se pencher avec sympathie sur les sangsues ! Jean-Pierre Dubé (Globule, la petite sangsue et Globule et le ver de terre) réussit le tour de force de ne rien dire qui soit faux à propos de son petit vampire tout en le rendant (presque) sympathique. Les enfants, quant à eux, en déduiront que chacun a droit à son mode de vie, la sangsue comme le ver de terre. Tant mieux !
Jean-Pierre Dubé et Tristan Demers, Globule, la petite sangsue et Globule et le ver de terre, Michel Quintin, Montréal, 2001, 64 p. ; 7.95 $.
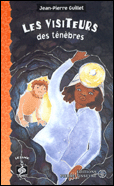 Les visiteurs des ténèbres se pencheront eux aussi sur des êtres couramment calomniés : les chauves-souris. Jean-Pierre Guillet atteint d’emblée les deux objectifs d’un tel sujet. L’aventure qu’il raconte permet aux préjugés courants de s’exprimer jusqu’à l’épuisement, mais elle conduit ensuite à l’assimilation sereine de l’information souhaitable. Les amateurs de mystère reçoivent leur dû ; ceux qui aiment savoir et comprendre en auront aussi plein les bras.
Les visiteurs des ténèbres se pencheront eux aussi sur des êtres couramment calomniés : les chauves-souris. Jean-Pierre Guillet atteint d’emblée les deux objectifs d’un tel sujet. L’aventure qu’il raconte permet aux préjugés courants de s’exprimer jusqu’à l’épuisement, mais elle conduit ensuite à l’assimilation sereine de l’information souhaitable. Les amateurs de mystère reçoivent leur dû ; ceux qui aiment savoir et comprendre en auront aussi plein les bras.
Jean-Pierre Guillet et Christiane Gaudette, Les visiteurs des ténèbres, Pierre Tisseyre, Montréal, 2001, 62 p. ; 7,95 $.
Deux petits livres du (trop ?) prolifique Laurent Chabin gardent en contact avec le monde animal, mais laisseront le petit lecteur sur sa faim. La tortue célibataire1 permet d’entrevoir le drame des espèces menacées d’extinction, mais ne précise ni le problème ni sa solution. Où sont les ours2 tourne court également et n’explique rien.
1. Laurent Chabin et Daniel Dumont, La tortue célibataire, Michel Quintin, Montréal, 2001, 46 p. ; 7,95 $.
2. Laurent Chabin et Jean Morin, Où sont les ours ?, Michel Quintin, Montréal, 2001, 48 p. ; 7,95 $.
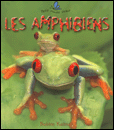 Les amphibiens de Bobbie Kalman laissent de côté la fiction et l’anthropomorphisme. On voit donc salamandres et crapauds dans toute leur beauté (?) et l’on apprend, en même temps qu’on présente aux enfants leur histoire, leur utilité, les risques que le progrès (?) leur fait courir. Les illustrations sont de premier ordre, l’information fiable et abordable.
Les amphibiens de Bobbie Kalman laissent de côté la fiction et l’anthropomorphisme. On voit donc salamandres et crapauds dans toute leur beauté (?) et l’on apprend, en même temps qu’on présente aux enfants leur histoire, leur utilité, les risques que le progrès (?) leur fait courir. Les illustrations sont de premier ordre, l’information fiable et abordable.
Bobbie Kalman, Les amphibiens, trad. de l’anglais par Guillaume Forget, Banjo, Mont-Royal, 2001, 32 p. ; 8,95 $.
Sans surprise, l’hygiène s’inscrit dans les rapports entre les enfants et la société et donc dans la littérature destinée aux enfants. Quand Max ne veut pas se laver de Dominique de Saint Mars, il est peut-être temps qu’il rencontre un chien qui se néglige encore plus que lui et qui, sans le vouloir, lui enseigne les plaisirs de la propreté. Nul n’insiste, mais la leçon est profitable.
Lili va chez la psy de Dominique de Saint Mars ne s’adresse qu’à un public restreint. En effet, autant il est bon de rassurer l’enfant qui se croit anormal parce que s’impose le recours à la psychologie professionnelle, autant il serait excessif de laisser entendre que tous et toutes doivent en passer par là. Les nuances, malheureusement, font défaut.
Dominique de Saint Mars et Serge Bloch, Max ne veut pas se laver, Calligram, Fribourg, 2001, 48 p. ; 7,95 $.
Dominique de Saint Mars et Serge Bloch, Lili va chez la psy, Calligram, Fribourg, 2001, 48 p. ; 7,95 $.
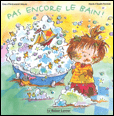 Pas encore le bain de Erna d’Entremont Mayne fait mieux encore. Une petite barbouillée, en effet, se fait fort de démontrer à quel point il est utile de retrouver sur soi les traces du dernier repas ou des plus récents châteaux de sable. Les sophismes sortent en droite ligne de la mauvaise foi enfantine et n’en sont que plus convaincants. Jusqu’à ce que l’enfant, à force de saleté, soit privée des baisers parentaux et consente à essayer autre chose. Fin, drôle, peut-être pas vrai, mais plausible.
Pas encore le bain de Erna d’Entremont Mayne fait mieux encore. Une petite barbouillée, en effet, se fait fort de démontrer à quel point il est utile de retrouver sur soi les traces du dernier repas ou des plus récents châteaux de sable. Les sophismes sortent en droite ligne de la mauvaise foi enfantine et n’en sont que plus convaincants. Jusqu’à ce que l’enfant, à force de saleté, soit privée des baisers parentaux et consente à essayer autre chose. Fin, drôle, peut-être pas vrai, mais plausible.
Erna d’Entremont Mayne et Marie-Claude Favreau, Pas encore le bain !, Banjo, Mont-Royal, 2001, 24 p. ; 7,95 $.
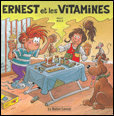 Avec Ernest et les vitamines, on revient à une pédagogie plus universelle. Paul Roux, scénariste et dessinateur, excelle à répandre l’humour et une superbe vulgarisation sur les problèmes les plus complexes. Oui aux vitamines, disent ses personnages, mais pas en quantités industrielles, pas à propos de n’importe quoi, pas sans surveillance. La prudence devient ici une compagne sympathique et qu’on peut donc écouter.
Avec Ernest et les vitamines, on revient à une pédagogie plus universelle. Paul Roux, scénariste et dessinateur, excelle à répandre l’humour et une superbe vulgarisation sur les problèmes les plus complexes. Oui aux vitamines, disent ses personnages, mais pas en quantités industrielles, pas à propos de n’importe quoi, pas sans surveillance. La prudence devient ici une compagne sympathique et qu’on peut donc écouter.
Paul Roux, Ernest et les vitamines, Banjo, Mont-Royal, 2001, 24 p. ; 7,95 $.
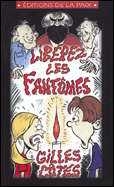 Quelques fantômes et beaucoup de magie
Quelques fantômes et beaucoup de magie
Ténèbres et fantômes font partie de l’univers enfantin et Bruno Bettelheim avait bien raison de les juger nécessaires et même thérapeutiques.
Le grand mérite de Libérez les fantômes de Gilles Côtes, ce sera, en plus de présenter un récit alerte et agréablement peu plausible, de mettre l’accent sur la connivence entre un frère et une sur. Pourquoi, en effet, cette complicité ne vaudrait-elle pas celle qui unit copains et copines et dont on parle tant ? L’énigme sera résolue, les amitiés exerceront de nouveau leur vigueur centrifuge aux dépens de l’entente fraternelle, mais un moment privilégié aura renforcé des liens méconnus.
Gilles Côtes et Marc-Étienne Paquin, Libérez les fantômes, De la Paix, Saint-Alphonse-de-Granby, 2001, 128 p. ; 8,95 $.
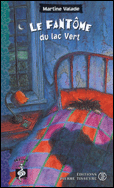 Le fantôme du lac Vert de Martinae Valade raconte aussi une histoire d’amitié. Amitié qui rapproche l’enfant de 8 ans et le vieillard de 78 ans et qui permettra d’élucider le mystère contre lequel ont buté les gens trop peu ouverts. L’auteure intègre dans le même récit des thèmes que l’on voit rarement ensemble : course au trésor, retour sur des temps enfuis, confidences d’une vieille dame plutôt que celles de l’enfant… Le tout est prenant.
Le fantôme du lac Vert de Martinae Valade raconte aussi une histoire d’amitié. Amitié qui rapproche l’enfant de 8 ans et le vieillard de 78 ans et qui permettra d’élucider le mystère contre lequel ont buté les gens trop peu ouverts. L’auteure intègre dans le même récit des thèmes que l’on voit rarement ensemble : course au trésor, retour sur des temps enfuis, confidences d’une vieille dame plutôt que celles de l’enfant… Le tout est prenant.
Martinae Valade et Fanny, Le Fantôme du lac Vert, Pierre Tisseyre, Montréal, 2001, 72 p. ; 7,95 $.
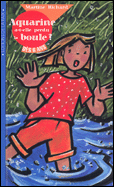 On ne sait pas trop s’il faut croire Aquarine quand elle jure n’avoir pas perdu la boule dans Aquarine a-t-elle perdu la boule ? de Martine Richard. Il se peut qu’Aquarine ait seulement la tête dure et qu’elle ne veuille pas donner raison aux adultes quand ils prétendent que les animaux ne parlent pas. Mais rien n’interdit aux enfants de se fier plutôt au poisson qui parle et de chercher où vont les animaux après leur mort. Récit qui échappe à la logique, mais qui laisse leur place au chagrin et au rêve compensatoire.
On ne sait pas trop s’il faut croire Aquarine quand elle jure n’avoir pas perdu la boule dans Aquarine a-t-elle perdu la boule ? de Martine Richard. Il se peut qu’Aquarine ait seulement la tête dure et qu’elle ne veuille pas donner raison aux adultes quand ils prétendent que les animaux ne parlent pas. Mais rien n’interdit aux enfants de se fier plutôt au poisson qui parle et de chercher où vont les animaux après leur mort. Récit qui échappe à la logique, mais qui laisse leur place au chagrin et au rêve compensatoire.
Martine Richard et Romi Caron, Aquarine a-t-elle perdu la boule ?, De la Paix, Saint-Alphonse-de-Granby, 2001, 75 p. ; 7,95 $.
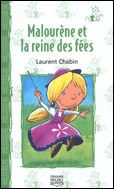 Les deux petits livres que consacre Laurent Chabin au sympathique personnage de Malourène (Malourène et la reine des fées et Malourène et la dame étrange) valorisent aussi finement l’un que l’autre la seule vraie beauté, celle du cœur. Malourène n’a pas à copier qui que ce soit, pas même la reine des fées, pour devenir une merveilleuse petite fée. Et Malourène comprend que les animaux, du moins ceux dont l’homme n’a pas déformé la sensibilité, n’ont nul besoin de la parole, puisque leur regard détecte la beauté. Du meilleur Chabin.
Les deux petits livres que consacre Laurent Chabin au sympathique personnage de Malourène (Malourène et la reine des fées et Malourène et la dame étrange) valorisent aussi finement l’un que l’autre la seule vraie beauté, celle du cœur. Malourène n’a pas à copier qui que ce soit, pas même la reine des fées, pour devenir une merveilleuse petite fée. Et Malourène comprend que les animaux, du moins ceux dont l’homme n’a pas déformé la sensibilité, n’ont nul besoin de la parole, puisque leur regard détecte la beauté. Du meilleur Chabin.
Laurent Chabin et Jean Morin, Malourène et la reine des fées et Malourène et la dame étrange, Michel Quintin, Montréal, 2001, 64 p. ; 7,95 $.
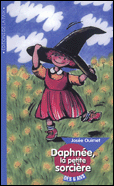 À dire vrai, Daphnée n’a de sorcière que le chapeau (Daphnée, la petite sorcière de Josée Ouimet). Par ses autres caractéristiques, elle appartient tout bonnement à l’espèce enfantine. Elle se construit des scénarios, rêve de faire goûter à son chat un gâteau de sable qu’elle imagine empoisonné, s’étonne de voir l’étrange voisine cueillir et apprêter les pissenlits que son père préfère chasser de sa pelouse. Sympathique, curieuse, friande de connaissances, Daphnée s’ouvre avec naturel à d’autres coutumes.
À dire vrai, Daphnée n’a de sorcière que le chapeau (Daphnée, la petite sorcière de Josée Ouimet). Par ses autres caractéristiques, elle appartient tout bonnement à l’espèce enfantine. Elle se construit des scénarios, rêve de faire goûter à son chat un gâteau de sable qu’elle imagine empoisonné, s’étonne de voir l’étrange voisine cueillir et apprêter les pissenlits que son père préfère chasser de sa pelouse. Sympathique, curieuse, friande de connaissances, Daphnée s’ouvre avec naturel à d’autres coutumes.
Josée Ouimet et Romi Caron, Daphnée, la petite sorcière, De la Paix, Saint-Alphonse-de-Granby, 2001, 80 p. ; 7,95 $.
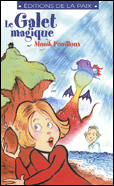 Après les animaux qui parlent et ceux qui se contentent de regarder, il fallait bien s’attendre à ce que les galets eux-mêmes revendiquent le droit de s’exprimer. C’est fait avec Le galet magique de Monik Pouilloux. Ce galet volubile possède des pouvoirs considérables, dont celui de transporter Marine dans un autre univers et de lui faire rencontrer Agilorapidorusé dont le caractère s’améliorera rapidement. Le récit, évoluant dans un monde simplifié, téléscope les évolutions et fait naître l’amitié dans le sillage immédiat de l’affrontement. On aurait pu quand même souhaiter une écriture plus soignée. Même en langage parlé, il n’est pas indispensable de demander : « Tu es où ? »
Après les animaux qui parlent et ceux qui se contentent de regarder, il fallait bien s’attendre à ce que les galets eux-mêmes revendiquent le droit de s’exprimer. C’est fait avec Le galet magique de Monik Pouilloux. Ce galet volubile possède des pouvoirs considérables, dont celui de transporter Marine dans un autre univers et de lui faire rencontrer Agilorapidorusé dont le caractère s’améliorera rapidement. Le récit, évoluant dans un monde simplifié, téléscope les évolutions et fait naître l’amitié dans le sillage immédiat de l’affrontement. On aurait pu quand même souhaiter une écriture plus soignée. Même en langage parlé, il n’est pas indispensable de demander : « Tu es où ? »
Monik Pouilloux et Marc-Étienne Paquin, Le galet magique, De la Paix, Saint-Alphonse-de-Granby, 2001, 111 p. ; 8,95 $.
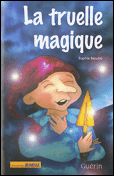 La truelle magique de Sophie Bérubé possède des pouvoirs dont Fleur, égoïste et imprudente, a vite fait d’abuser. À elle et à elle seule les étoiles, la lune, le soleil. Mais quand le ciel est ainsi dépeuplé, Fleur comprend son erreur. Beau récit, superbes illustrations, apprentissage du bon sens sans lourdeur moralisatrice.
La truelle magique de Sophie Bérubé possède des pouvoirs dont Fleur, égoïste et imprudente, a vite fait d’abuser. À elle et à elle seule les étoiles, la lune, le soleil. Mais quand le ciel est ainsi dépeuplé, Fleur comprend son erreur. Beau récit, superbes illustrations, apprentissage du bon sens sans lourdeur moralisatrice.
Sophie Bérubé, La truelle magique, Guérin, Montréal, 2001, 40 p. ; 4,95 $.
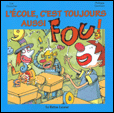 Quelques solitaires
Quelques solitaires
Rares sont, dans cette cuvée, les formats particuliers qui abondent à l’époque des fêtes. Citons-en quand même trois qui ne sont d’ailleurs pas sans mérites. L’école, c’est toujours aussi fou ! Luc Durocher s’adonne pour la troisième fois à une superbe haute voltige linguistique. Ces clichés que l’on utilise sans penser à ce que l’enfant peut en comprendre sont pris au pied de la lettre et dessinés en conséquence. Bel exercice. Et drôle.
Luc Durocher et Philippe Germain, L’école, c’est toujours aussi fou !, t. 3, Banjo, Mont-Royal, 2001, 24 p. ; 7,95 $.
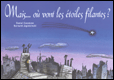 Un très bel album produit par Les 400 coups tente de répondre à l’éternelle question Mais… où vont les étoiles filantes ? de Bernard Jagodzinski. Car le mystère se retrouve partout, aussi bien dans le ciel australien que dans celui du Groënland. L’occasion est belle, et le dessinateur l’exploite admirablement, de styliser gentiment chaque coin du globe et d’unir tous les peuples dans un même regard vers le ciel. La réponse ? Allez voir.
Un très bel album produit par Les 400 coups tente de répondre à l’éternelle question Mais… où vont les étoiles filantes ? de Bernard Jagodzinski. Car le mystère se retrouve partout, aussi bien dans le ciel australien que dans celui du Groënland. L’occasion est belle, et le dessinateur l’exploite admirablement, de styliser gentiment chaque coin du globe et d’unir tous les peuples dans un même regard vers le ciel. La réponse ? Allez voir.
Bernard Jagodzinski et Daniel Casanave, Mais… où vont les étoiles filantes ?, Les 400 coups, Montréal, 2001, 28 p. ; 10,95 $.
Le mystère du lac de Pierre Hamon marque l’entrée d’un nouvel acteur en littérature destinée aux jeunes. L’intention est nette : il s’agit d’inciter les jeunes à créer leurs propres entreprises. La littérature n’a pas grand chose à attendre de cette pédagogie plutôt utilitaire. Admettons cependant que le travail est professionnel, que l’intrigue se défend fort bien et que, par conséquent, le jupon ne dépasse pas trop souvent.
Pierre Hamon et François Miville-Deschênes, Le mystère du lac, Éditions Dorimène/L’Institut de la fondation de l’entrepreneurship, Charlesbourg, 2000, 72 p.
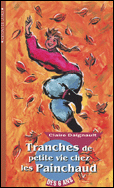 Valeurs éprouvées ou proposées
Valeurs éprouvées ou proposées
Même si La courte échelle occupe toujours efficacement le territoire qu’elle a conquis au fil des ans, d’autres éditeurs se taillent à ses côtés un espace non négligeable. Par exemple, les éditions Pierre Tisseyre et les éditions De la Paix.
Tranches de petite vie chez les Painchaud de Claire Daignault ne passera pas à l’histoire comme le meilleur texte de l’auteure. Faute d’une histoire à raconter, on se rabat sur des clichés et sur des calembours dont bien peu font sourire. L’éditeur n’aide pas à la cause en consacrant au moins une douzaine de pages à la promotion de ses bouquins et de ses collaboratrices. Un jeune auditoire n’y verra aucun intérêt.
Claire Daignault et Romi Caron, Tranches de petite vie chez les Painchaud, De la Paix, Saint-Alphonse-de-Granby, 2001, 84 p. ; 7,95 $.
 La même maison fait mieux avec Julien César de Jocelyne Ouellet. On comprend vite que Julien, à force de rêver des victoires qu’il aurait pu remporter à une autre époque et sous un autre épiderme, se rend partout indésirable. Le jour vient, cependant, où Julien découvre le plaisir de raconter ses rêves au lieu de les assener. La violence cède sagement la place à l’expression et les mots se substituent aux poings, pour le plus grand plaisir de tous et, au premier chef, de Julien. On ne saurait demander mieux.
La même maison fait mieux avec Julien César de Jocelyne Ouellet. On comprend vite que Julien, à force de rêver des victoires qu’il aurait pu remporter à une autre époque et sous un autre épiderme, se rend partout indésirable. Le jour vient, cependant, où Julien découvre le plaisir de raconter ses rêves au lieu de les assener. La violence cède sagement la place à l’expression et les mots se substituent aux poings, pour le plus grand plaisir de tous et, au premier chef, de Julien. On ne saurait demander mieux.
Jocelyne Ouellet et Marc-Étienne Paquin, Julien César, De la Paix, Saint-Alphonse-de-Granby, 2001, 111 p. ; 8,95 $.
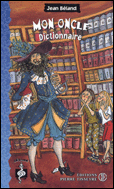 Dans Mon oncle Dictionnaire de Jean Béland, des adolescentes trop curieuses sont piégées par celui qu’elles croyaient tromper. La finesse de l’astuce rachète un peu la lourdeur du texte et détourne un peu l’attention d’une typographie qui, parce qu’on sous-estime les jeunes lecteurs, multiplie les majuscules au lieu de s’en remettre à l’intelligence. À trop insister, il arrive qu’on lasse.
Dans Mon oncle Dictionnaire de Jean Béland, des adolescentes trop curieuses sont piégées par celui qu’elles croyaient tromper. La finesse de l’astuce rachète un peu la lourdeur du texte et détourne un peu l’attention d’une typographie qui, parce qu’on sous-estime les jeunes lecteurs, multiplie les majuscules au lieu de s’en remettre à l’intelligence. À trop insister, il arrive qu’on lasse.
Jean Béland et Élisabeth Eudes-Pascal, Mon oncle Dictionnaire, Pierre Tisseyre, 2001, 64 p. ; 7,95 $.
 Signalons, en insistant juste assez, une émouvante réussite : le Simon et Violette d’Andrée-Anne Gratton. L’histoire est fine, l’écriture intelligente, les personnages magnifiquement plausibles. L’aventure, pourtant, commençait mal. Qu’allait faire Simon, transplanté dans une nouvelle école et invité comme tout le monde à présenter à la classe un de ses grands-parents ? Doit-il avouer qu’il n’a, lui, aucun grand-parent ? Va-t-il se porter pâle ? L’idée lui vient de faire appel à une vieille dame et d’en faire une grand-mère d’occasion. Problème résolu ? Non pas, car l’éphémère grand-mère porte le nom de Violette et s’habille d’étrange manière. La suite révélera les étonnantes ressources de la vieille dame et marquera le début d’une chaleureuse amitié. Magnifique.
Signalons, en insistant juste assez, une émouvante réussite : le Simon et Violette d’Andrée-Anne Gratton. L’histoire est fine, l’écriture intelligente, les personnages magnifiquement plausibles. L’aventure, pourtant, commençait mal. Qu’allait faire Simon, transplanté dans une nouvelle école et invité comme tout le monde à présenter à la classe un de ses grands-parents ? Doit-il avouer qu’il n’a, lui, aucun grand-parent ? Va-t-il se porter pâle ? L’idée lui vient de faire appel à une vieille dame et d’en faire une grand-mère d’occasion. Problème résolu ? Non pas, car l’éphémère grand-mère porte le nom de Violette et s’habille d’étrange manière. La suite révélera les étonnantes ressources de la vieille dame et marquera le début d’une chaleureuse amitié. Magnifique.
Andrée-Anne Gratton et Leanne Franson, Simon et Violette, Pierre Tisseyre, Montréal, 2001, 62 p. ; 7,95 $.
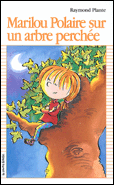 De La courte échelle, la production est abondante, en provenance d’auteurs familiers, mais aussi de recrues. Raymond Plante ramène sa Marilou Polaire (Marilou Polaire sur un arbre perchée1), d’abord réticente à l’idée de manger des escargots, mais capable, faim oblige, de changer d’idée. Les personnages, fermement campés, parlent et bougent avec le naturel né d’une longue fréquentation. Le titre, Raymond Plante le souligne, renvoie à Italo Calvino.
De La courte échelle, la production est abondante, en provenance d’auteurs familiers, mais aussi de recrues. Raymond Plante ramène sa Marilou Polaire (Marilou Polaire sur un arbre perchée1), d’abord réticente à l’idée de manger des escargots, mais capable, faim oblige, de changer d’idée. Les personnages, fermement campés, parlent et bougent avec le naturel né d’une longue fréquentation. Le titre, Raymond Plante le souligne, renvoie à Italo Calvino.
Dans un autre bouquin, Raymond Plante met de nouveau en scène Jeff et Juliette, ses deux jeunes vagabonds de l’espace et du temps. Grâce à l’étrange tunnel qui leur ouvre les chemins les plus inattendus, ils se mettent cette fois à la recherche de La petite fille tatouée2. Malheureusement, le récit est si attentif à préparer la suite qu’il en oublie de présenter une intrigue substantielle.
1. Raymond Plante et Marie-Claude Favreau, Marilou Polaire sur un arbre perchée, La courte échelle, Montréal, 2001, 64 p. ; 8,95 $.
2. Raymond Plante, La petite fille tatouée, La courte échelle, Montréal, 2001, 96 p. ; 8,95 $.
La Sophie de Louise Leblanc (Sophie court après la fortune) reprend du service elle aussi. Elle s’imagine riche, adulée, enviée. Mais encore faut-il gagner le gros lot et donc parier, parier, parier. Sophie encaisse une cinglante leçon, mais elle retombe sur ses pieds et entreprend de raconter son expérience à ceux et celles que le jeu peut tenter. Grâce à Louise Leblanc, ce qui aurait pu être moralisateur est aussi souriant qu’utile.
Louise Leblanc et Marie-Louise Gay, Sophie court après la fortune, La courte échelle, Montréal, 2001, 64 p. ; 8,95 $.
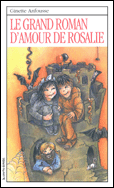 La Rosalie de Ginette Anfousse (Le grand roman d’amour de Rosalie) n’allait pas demeurer à l’écart de ce qu’on pourrait appeler le carambolage des amours juvéniles. Quand les adultes ont des amours à géométrie variable, pourquoi les jeunes échapperaient-ils à une certaine versatilité et comment Rosalie ne douterait-elle pas de la constance de son grand héros viking ? Elle devra traverser une période de doute et voir si, de l’autre côté… Le métier de Ginette Anfousse est si patent qu’on peut espérer l’élimination d’expressions comme « trop exagéré » ou « aussi pire ».
La Rosalie de Ginette Anfousse (Le grand roman d’amour de Rosalie) n’allait pas demeurer à l’écart de ce qu’on pourrait appeler le carambolage des amours juvéniles. Quand les adultes ont des amours à géométrie variable, pourquoi les jeunes échapperaient-ils à une certaine versatilité et comment Rosalie ne douterait-elle pas de la constance de son grand héros viking ? Elle devra traverser une période de doute et voir si, de l’autre côté… Le métier de Ginette Anfousse est si patent qu’on peut espérer l’élimination d’expressions comme « trop exagéré » ou « aussi pire ».
Ginette Anfousse et Marisol Sarrazin, Le grand roman d’amour de Rosalie, La courte échelle, Montréal, 2001, 96 p. ; 8,95 $.
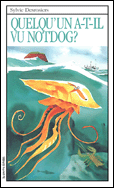 Notdog, chien laid et détective médiocre, est quand même de nouveau mis à contribution par Sylvie Desrosiers (Quelqu’un a-t-il vu Notdog ?), avec un résultat aussi inattendu qu’heureux. Il est vrai qu’une méduse avait aidé Notdog à devenir aussi discret que désirent l’être les meilleurs enquêteurs. Les inséparables, quant à eux, fournissent leur quote-part habituelle d’analyse, de curiosité et, dans le cas de John, d’approximations linguistiques. Un bon récit dans une série qu’adorent les jeunes.
Notdog, chien laid et détective médiocre, est quand même de nouveau mis à contribution par Sylvie Desrosiers (Quelqu’un a-t-il vu Notdog ?), avec un résultat aussi inattendu qu’heureux. Il est vrai qu’une méduse avait aidé Notdog à devenir aussi discret que désirent l’être les meilleurs enquêteurs. Les inséparables, quant à eux, fournissent leur quote-part habituelle d’analyse, de curiosité et, dans le cas de John, d’approximations linguistiques. Un bon récit dans une série qu’adorent les jeunes.
Sylvie Desrosiers et Daniel Sylvestre, Quelqu’un a-t-il vu Notdog ?, La courte échelle, Montréal, 2001, 96 p. ; 8,95 $.
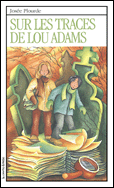 Sur les traces de Lou Adams de Josée Plourde, c’est une véritable reconstitution historique réussie par Anne et son amie Claude. Il a suffi d’une pierre tombale, avec ses initiales énigmatiques, pour que s’éveille la curiosité des deux comparses, curiosité qui ne prendra du repos qu’une fois le passé délesté de ses secrets. L’intrigue est solidement structurée, les révélations plus que plausibles, l’enquête menée avec ce qu’il faut d’intuition et de doute.Le thème des jugements téméraires, jugements dont les jeunes n’ont évidemment pas le monopole, revient à l’avant-scène grâce à deux plumes de grand calibre.
Sur les traces de Lou Adams de Josée Plourde, c’est une véritable reconstitution historique réussie par Anne et son amie Claude. Il a suffi d’une pierre tombale, avec ses initiales énigmatiques, pour que s’éveille la curiosité des deux comparses, curiosité qui ne prendra du repos qu’une fois le passé délesté de ses secrets. L’intrigue est solidement structurée, les révélations plus que plausibles, l’enquête menée avec ce qu’il faut d’intuition et de doute.Le thème des jugements téméraires, jugements dont les jeunes n’ont évidemment pas le monopole, revient à l’avant-scène grâce à deux plumes de grand calibre.
Josée Plourde et Doris Barrette, Sur les traces de Lou Adams, La courte échelle, Montréal, 2001, 96 p. ; 8,95 $.
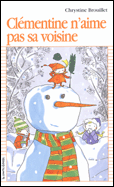 Dans Clémentine n’aime pas sa voisine, Chrystine Brouillet donne la parole à Clémentine, minuscule et méfiante lutine. Celle-ci en profite pour déblatérer contre la nouvelle voisine. Comme si, d’avance, elle voulait empêcher Gustave de se lier à Juliette. Jalousie ? Allez savoir ! Peut-être les lutines ressemblent-elles aux humaines jusque dans leurs petits défauts, mais peut-être que non. Chose certaine, la vie se charge vite de préciser la vraie nature de la nouvelle voisine.
Dans Clémentine n’aime pas sa voisine, Chrystine Brouillet donne la parole à Clémentine, minuscule et méfiante lutine. Celle-ci en profite pour déblatérer contre la nouvelle voisine. Comme si, d’avance, elle voulait empêcher Gustave de se lier à Juliette. Jalousie ? Allez savoir ! Peut-être les lutines ressemblent-elles aux humaines jusque dans leurs petits défauts, mais peut-être que non. Chose certaine, la vie se charge vite de préciser la vraie nature de la nouvelle voisine.
Chrystine Brouillet et Daniel Sylvestre, Clémentine n’aime pas sa voisine, La courte échelle, Montréal, 2001, 64 p. ; 8,95 $.
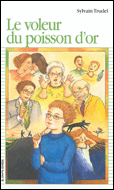 Dans l’histoire que raconte Sylvain Trudel (Le voleur du poisson d’or), la condamnation du mendiant, préjugés aidant, précède l’enquête. À quoi, d’ailleurs, celle-ci pourrait-elle servir ? Quand disparaît un petit poisson d’or, qui douterait de la culpabilité du vagabond mal recyclé depuis ses années de Klondyke ? Nicolas, qui s’était lié d’amitié avec le personnage, s’entête à le défendre, au risque d’indisposer tous les bien-pensants du village, à commencer par sa propre parenté. L’attitude est belle, mais le résultat ? Chez Sylvain Trudel, littérature et bons sentiments ne s’opposent pas.
Dans l’histoire que raconte Sylvain Trudel (Le voleur du poisson d’or), la condamnation du mendiant, préjugés aidant, précède l’enquête. À quoi, d’ailleurs, celle-ci pourrait-elle servir ? Quand disparaît un petit poisson d’or, qui douterait de la culpabilité du vagabond mal recyclé depuis ses années de Klondyke ? Nicolas, qui s’était lié d’amitié avec le personnage, s’entête à le défendre, au risque d’indisposer tous les bien-pensants du village, à commencer par sa propre parenté. L’attitude est belle, mais le résultat ? Chez Sylvain Trudel, littérature et bons sentiments ne s’opposent pas.
Sylvain Trudel et Suzane Langlois, Le voleur du poisson d’or, La courte échelle, Montréal, 2001, 64 p. ; 8,95 $.
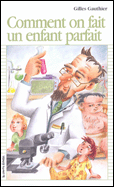 Deux titres, malgré le prestige des auteurs, laissent un peu songeur. Quand Gilles Gauthier se demande Comment on fait un enfant parfait1, sa réponse est plus bizarre que séduisante. Passe encore qu’un couple rêve d’un enfant, même si la cinquantaine a sonné. Passe encore qu’il fasse confiance au docteur Frank N. Schtein. Mais faut-il vraiment que ces imprudentes fréquentations débouchent sur des triplés aux caractéristiques inégales et parfois monstrueuses ? On ose espérer que la suite qui est promise nous ramènera le Gauthier qu’on avait appris à apprécier.
Deux titres, malgré le prestige des auteurs, laissent un peu songeur. Quand Gilles Gauthier se demande Comment on fait un enfant parfait1, sa réponse est plus bizarre que séduisante. Passe encore qu’un couple rêve d’un enfant, même si la cinquantaine a sonné. Passe encore qu’il fasse confiance au docteur Frank N. Schtein. Mais faut-il vraiment que ces imprudentes fréquentations débouchent sur des triplés aux caractéristiques inégales et parfois monstrueuses ? On ose espérer que la suite qui est promise nous ramènera le Gauthier qu’on avait appris à apprécier.
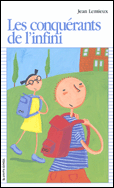 Il en va de même du nouveau texte de Jean Lemieux, Les conquérants de l’infini2. Comme dans le précédent ouvrage rédigé à l’intention des jeunes, une excellente idée de départ ne parvient pas à s’incarner vraiment. L’infini, thème fascinant s’il en est à l’âge où surgissent les inquiétudes métaphysiques, est tantôt présenté comme une interminable addition de chiffres tantôt comme le lieu où le jeune FX est rendu. Dans les deux cas, l’histoire manque de chair. Les œuvres offertes par Jean Lemieux aux adultes sont de si grande qualité qu’il trouvera bientôt un ton adapté aux jeunes.
Il en va de même du nouveau texte de Jean Lemieux, Les conquérants de l’infini2. Comme dans le précédent ouvrage rédigé à l’intention des jeunes, une excellente idée de départ ne parvient pas à s’incarner vraiment. L’infini, thème fascinant s’il en est à l’âge où surgissent les inquiétudes métaphysiques, est tantôt présenté comme une interminable addition de chiffres tantôt comme le lieu où le jeune FX est rendu. Dans les deux cas, l’histoire manque de chair. Les œuvres offertes par Jean Lemieux aux adultes sont de si grande qualité qu’il trouvera bientôt un ton adapté aux jeunes.
1. Gilles Gauthier et Pierre-André Derome, Comment on fait un enfant parfait, La courte échelle, Montréal, 2001, 64 p. ; 8,95 $.
2. Jean Lemieux et Sophie Casson, Les conquérants de l’infini, La courte échelle, Montréal, 2001, 64 p. ; 8,95 $.
Quand l’espace s’amplifie
Si ces derniers arrivages n’égalent pas toujours certaines surabondances du passé, ce qui est aujourd’hui destiné aux jeunes adultes ou aux adolescents persistants, comme on voudra, est d’une richesse incomparable. Comme si la littérature destinée aux jeunes arrivait à maturité et renonçait enfin aux frontières artificielles entre le livre offert aux adolescents et le livre tout court. Si tel est le cas, saluons une tendance heureuse.
Michel Lavoie est de ces éducateurs inventifs et respectueux qui pratiquent la maïeutique littéraire de la plus admirable façon. Il excelle à identifier très tôt les jeunes talents, à leur donner confiance et visibilité. Il possède ce don, inentamé après des années, de s’étonner devant les potentiels tout neufs et de présumer, avec une superbe confiance, qu’ils tiendront parole. Son Évasions, recueil de textes rédigés par de jeunes audaces, fournit la preuve qu’il a raison : il faut, tant certains textes sont intelligemment construits, se redire constamment, avec une sorte d’incrédulité, qu’ils proviennent vraiment d’adolescentes. Car, il faut le constater et y réfléchir, la jeune littérature est affaire féminine.
Michel Lavoie.(sous la dir. de), Évasions, Vents d’Ouest, Hull, 127 p. ; 9,95 $.
 Louise Simard (Les chats du parc Yengo) fait partie de ces auteurs qui logent une recherche minutieuse en amont comme en aval de l’imaginaire. Tout comme elle a patrouillé la route de Parramatta avant de raconter l’histoire des patriotes québécois déportés aux antipodes, elle a balisé minutieusement le territoire où se déroulent les aventures de Claude, son aventureuse et généreuse jeune vétérinaire. Le récit y gagne en crédibilité, les valeurs de Claude en solidité.
Louise Simard (Les chats du parc Yengo) fait partie de ces auteurs qui logent une recherche minutieuse en amont comme en aval de l’imaginaire. Tout comme elle a patrouillé la route de Parramatta avant de raconter l’histoire des patriotes québécois déportés aux antipodes, elle a balisé minutieusement le territoire où se déroulent les aventures de Claude, son aventureuse et généreuse jeune vétérinaire. Le récit y gagne en crédibilité, les valeurs de Claude en solidité.
Louise Simard, Les chats du parc Yengo, Pierre Tisseyre, Montréal, 2001, 144 p. ; 10,95 $.
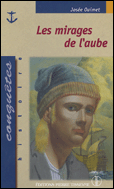 Dans Les mirages de l’aube, Josée Ouimet fait converger l’un vers l’autre des destins improbables, celui du jeune Français que bouscule la stratification sociale, et celui de la jeune Amérindienne que Jacques Cartier a emmenée en France et qu’il ne parvient pas à protéger comme il le voudrait. Josée Ouimet raconte bien et donne à ses personnages une séduction faite de sincérité un peu naïve et d’indestructible soif de liberté. L’époque renaît de ces pages, sans la sécheresse des manuels d’histoire ni le conformisme des rectitudes politiques.
Dans Les mirages de l’aube, Josée Ouimet fait converger l’un vers l’autre des destins improbables, celui du jeune Français que bouscule la stratification sociale, et celui de la jeune Amérindienne que Jacques Cartier a emmenée en France et qu’il ne parvient pas à protéger comme il le voudrait. Josée Ouimet raconte bien et donne à ses personnages une séduction faite de sincérité un peu naïve et d’indestructible soif de liberté. L’époque renaît de ces pages, sans la sécheresse des manuels d’histoire ni le conformisme des rectitudes politiques.
Josée Ouimet, Les mirages de l’aube, Pierre Tisseyre, Montréal, 2001, 182 p. ; 10,95 $.
 Phénomène courant en littérature pour adultes, mais rarissime dans celle qui nous occupe ici, Le cycle de la vie de Sabrina Turmel fait intervenir l’écriture elle-même dans le récit. Le narrateur s’arrête périodiquement et s’interroge sur la justesse de ses décisions et sur la pertinence des difficultés qu’il jette sur la route de ses personnages. Pourquoi, par exemple, a-t-il créé un personnage qui courtise sa Moéra ? Technique sans doute déroutante, mais qui peut, mieux que bien des cours magistraux, faire entrer le jeune public dans le saint des saints, dans ce lieu qui n’est pas un lieu, mais où les personnages créés par un auteur jouissent d’une inconcevable autonomie. Étonnant et certainement fécond.
Phénomène courant en littérature pour adultes, mais rarissime dans celle qui nous occupe ici, Le cycle de la vie de Sabrina Turmel fait intervenir l’écriture elle-même dans le récit. Le narrateur s’arrête périodiquement et s’interroge sur la justesse de ses décisions et sur la pertinence des difficultés qu’il jette sur la route de ses personnages. Pourquoi, par exemple, a-t-il créé un personnage qui courtise sa Moéra ? Technique sans doute déroutante, mais qui peut, mieux que bien des cours magistraux, faire entrer le jeune public dans le saint des saints, dans ce lieu qui n’est pas un lieu, mais où les personnages créés par un auteur jouissent d’une inconcevable autonomie. Étonnant et certainement fécond.
Sabrina Turmel, Le cycle de la vie, De la Paix, Saint-Alphonse-de-Granby, 2001, 112 p. ; 8,95 $.
 Danielle Simard offre un livre aux multiples mérites (Le pouvoir d’Émeraude). C’est pourtant devant une écriture extraordinairement jouissive et devant l’immense tumulte des personnalités mises en mouvement qu’il faut s’incliner. Émeraude, en effet, vit en contact avec une famille élargie où le père brocanteur achète sans doute plus qu’il ne vend, où la mère et ses amies s’abandonnent avec santé à toutes les fantaisies, où un jeune et mystérieux jeune homme séduit toutes les générations. Quand ce Tzigane fait don à Émeraude d’un petit accordéon aux pouvoirs incontrôlables, tout est en place pour la grande aventure. Et, d’un bout à l’autre du livre, déferle une écriture emportée, libre, aux rythmes imprévisibles. Les adolescents qui s’y abandonneront se sentiront conviés à vivre, et leurs aînés se demanderont s’ils n’ont pas raté quelque chose.
Danielle Simard offre un livre aux multiples mérites (Le pouvoir d’Émeraude). C’est pourtant devant une écriture extraordinairement jouissive et devant l’immense tumulte des personnalités mises en mouvement qu’il faut s’incliner. Émeraude, en effet, vit en contact avec une famille élargie où le père brocanteur achète sans doute plus qu’il ne vend, où la mère et ses amies s’abandonnent avec santé à toutes les fantaisies, où un jeune et mystérieux jeune homme séduit toutes les générations. Quand ce Tzigane fait don à Émeraude d’un petit accordéon aux pouvoirs incontrôlables, tout est en place pour la grande aventure. Et, d’un bout à l’autre du livre, déferle une écriture emportée, libre, aux rythmes imprévisibles. Les adolescents qui s’y abandonneront se sentiront conviés à vivre, et leurs aînés se demanderont s’ils n’ont pas raté quelque chose.
Danielle Simard, Le pouvoir d’Émeraude, Pierre Tisseyre, Montréal, 2001, 136 p. ; 10,95 $.
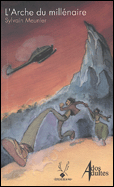 Sylvain Meunier est, lui aussi, de ces auteurs effervescents dont le contact ne peut qu’enrichir et libérer les jeunes générations. L’arche du millénaire aborde, en effet, d’entrée de jeu, à la fois des thèmes aussi modernes que le souci écologique et l’intérêt pour le cosmos tout entier, et aussi éternels que la relation père-fils et l’amour. Quand s’ajoute la jalousie d’un scientifique pour celui qui le dépasse et que se manifeste l’intransigeance sectaire, le jeune Olivier trouve des défis à sa mesure ; ses compétences techniques hors du commun ne suffiront pas à assurer sa survie et la réussite de sa mission. On est ici en présence d’un écrivain doué et qui sait traiter les jeunes comme des pairs.
Sylvain Meunier est, lui aussi, de ces auteurs effervescents dont le contact ne peut qu’enrichir et libérer les jeunes générations. L’arche du millénaire aborde, en effet, d’entrée de jeu, à la fois des thèmes aussi modernes que le souci écologique et l’intérêt pour le cosmos tout entier, et aussi éternels que la relation père-fils et l’amour. Quand s’ajoute la jalousie d’un scientifique pour celui qui le dépasse et que se manifeste l’intransigeance sectaire, le jeune Olivier trouve des défis à sa mesure ; ses compétences techniques hors du commun ne suffiront pas à assurer sa survie et la réussite de sa mission. On est ici en présence d’un écrivain doué et qui sait traiter les jeunes comme des pairs.
Sylvain Meunier, L’arche du millénaire, De la Paix, Saint-Alphonse-de-Granby, 2001, 200 p. ; 9,95 $.
Ann Lamontagne, qui aime se colleter avec des thèmes exigeants, s’intéresse dans Sabaya, toujours avec le même doigté, à la réincarnation. Il est fréquent, en pareils cas, de s’adresser surtout à ceux et celles qui acceptent l’hypothèse d’une existence incarnée au fil des siècles dans des enveloppes diverses et de ne pas perdre de salive et d’encre à évangéliser les indécrottables sceptiques. Telle n’est pas l’approche d’Ann Lamontagne. Elle raconte à quiconque veut l’entendre, et il n’est pas facile de se fermer les oreilles, que le Patrick disparu par suicide n’a pas pour autant quitté Sabaya. Il est encore là, tout près, dans une autre enveloppe. L’auteure ne plaide pas, mais elle laisse la possibilité se déployer librement, susciter l’incrédulité ici, l’adhésion là-bas. Si l’on prend en compte que l’écriture d’Ann Lamontagne se soucie du mot juste, de l’expression racée, du clin d’il intelligent, on comprendra qu’il s’agit là d’un bouquin qui, par sa forme autant que par son attitude d’écoute respectueuse, civilise en même temps qu’il intéresse.
Ann Lamontagne, Sabaya, Vents d’Ouest, Hull, 2001, 196 p. ; 9,95 $.
Le père d’Alex est-il L’espion du 307 de Louise-Michelle Sauriol ? Les agents venus l’arrêter l’affirment, mais Alex ne croira pas aisément à la culpabilité de son père. S’engage donc, dès l’arrestation, une enquête certes dangereuse, mais qui fournira à Alex l’occasion de voyager, de s’initier aux mystères des thérapies génétiques et de se faire valoir auprès de l’autre sexe. Les rebondissements sont nombreux, les virages rarement prévisibles, le rythme presque constamment maintenu. Une lecture que toutes les générations peuvent apprécier.
Louise-Michelle Sauriol, L’espion du 307, Vents d’Ouest, Hull, 2001, 168 p. ; 9,95 $.
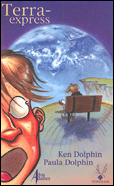 Terra express de Paula et Ken Dolphin passionnera tous les cybernautes, mais pas eux seulement. La recherche que doivent mener Ursule et Max dans le cadre d’une exigence collégiale les oblige à recourir aux meilleurs logiciels d’exploration géographique. Max, qui ne voit pas Ursule dans sa soupe, laisse sa compagne faire la majeure partie de la rédaction. Il ne s’en tirera pourtant pas si aisément, car Ursule disparaît et le professeur exige de Max qu’il complète le travail. La suite doit autant au monde psychologique qu’à l’informatique. Max, en effet, cherche tout autant le complément d’information requis par le professeur que la trace d’une compagne devenue impressionnante. Ingénieux, moderne, structuré comme une épreuve de décryptage, le bouquin est, de surcroît, très correctement rédigé. Et Ursule, que les machos le sachent, dépasse nettement Max en compétence informatique.
Terra express de Paula et Ken Dolphin passionnera tous les cybernautes, mais pas eux seulement. La recherche que doivent mener Ursule et Max dans le cadre d’une exigence collégiale les oblige à recourir aux meilleurs logiciels d’exploration géographique. Max, qui ne voit pas Ursule dans sa soupe, laisse sa compagne faire la majeure partie de la rédaction. Il ne s’en tirera pourtant pas si aisément, car Ursule disparaît et le professeur exige de Max qu’il complète le travail. La suite doit autant au monde psychologique qu’à l’informatique. Max, en effet, cherche tout autant le complément d’information requis par le professeur que la trace d’une compagne devenue impressionnante. Ingénieux, moderne, structuré comme une épreuve de décryptage, le bouquin est, de surcroît, très correctement rédigé. Et Ursule, que les machos le sachent, dépasse nettement Max en compétence informatique.
Paula et Ken Dolphin, Terra express, De la Paix, Saint-Alphonse-de-Granby, 2001, 130 p. ; 8,95 $.
Denis Côté, jeune vieux routier de la littérature destinée aux jeunes, entreprend avec La machination du Scorpion noir ce qui deviendra une série à épisodes multiples. Le personnage est, en effet, bâti pour durer et sa famille, qui participe malgré elle à ses tribulations, est équipée de caractéristiques aux applications infinies. Jos Tempête, riche, athlétique, prudent et renseigné, ne parvient pourtant pas à soustraire sa fille Iliade aux sbires à peine humains des mafias asiatiques. Il devra donc, malgré un secret que ne révèle pas ce premier épisode, appeler à la rescousse un trio de mousquetaires rescapés d’aventures anciennes. (L’un d’eux, étonnamment, se prévaudrait de « cent trente kilos de muscles, répartis sur un squelette d’un mètre soixante et un… » ) Ne dévoilons pas le dénouement. On aura quand même compris que Jos Tempête sera pleinement rétabli quand débutera la prochaine tranche de ses aventures. Denis Côté a localisé un filon que bien peu d’auteurs exploiteraient aussi bien que lui.
Denis Côté et Frédéric Rébéna, Les aventures de Jos Tempête, La machination du scorpion noir, Nathan, Paris, 2001, 206 p. ; 12,95 $.
 Au départ, André Marois (Les voleurs d’espoir) avait fait ample provision d’atouts plus qu’avantageux : informatique, inquiétude nationale, dépaysement temporel… Cela n’aura pas suffi. Le bouquin, en effet, dérape aisément vers le mauvais goût, le simplisme, la facilité. L’excellent auteur qu’est André Marois demeure ici nettement en-deça de ses possibilités.
Au départ, André Marois (Les voleurs d’espoir) avait fait ample provision d’atouts plus qu’avantageux : informatique, inquiétude nationale, dépaysement temporel… Cela n’aura pas suffi. Le bouquin, en effet, dérape aisément vers le mauvais goût, le simplisme, la facilité. L’excellent auteur qu’est André Marois demeure ici nettement en-deça de ses possibilités.
André Marois, Les voleurs d’espoir, La courte échelle, Montréal, 2001, 158 p. ; 9,95 $.
Terminons sur deux romans qui, comme les meilleurs de ceux qui viennent d’être évoqués, ignorent la ligne de démarcation entre jeunes et adultes et conviendraient à tous les publics. Le premier, Si deux meurent… de Robert Sutherland, raconte, à cadence rapide, les tribulations d’un jeune couple venu examiner le lointain chalet dont leur famille vient d’hériter. L’accueil de la population locale n’a rien de chaleureux et les menaces deviennent rapidement explicites. Cela ne fera pas reculer Sandy et David, mais les mettra à plusieurs reprises à deux doigts de la mort. Vivant, alerte, ingénieux. Quelques maladresses déparent la traduction.
Robert Sutherland, Si deux meurent…, trad. de l’anglais par Michelle Tisseyre, Pierre Tisseyre, Montréal, 2001, 216 p. ; 34,95 $.
 Maryse Pelletier (La fugue de Leila est de ces auteurs dont on peut acheter les livres de confiance, avant même de savoir de quoi exactement ils traitent. Elle excelle à créer l’atmosphère, elle accorde autant d’importance au cadre physique, s’il est pertinent de le faire, qu’aux sentiments enfouis au plus profond des personnalités. À cela s’ajoute une audace stylistique qui se manifeste différemment d’un livre à l’autre, mais qui explore sans cesse de nouveaux recours. Dans un autre livre (L’odeur des pivoines, chez le même éditeur), elle osait remettre en question l’existence d’un personnage et même l’éliminer au beau milieu du récit. Cette fois, elle se permet de clore d’une courte phrase en italique bon nombre des étapes de son récit et de synthétiser de cette manière le sens de ce qui précède. Tous les lecteurs ne goûteront pas cette intervention, mais il est fascinant d’en observer l’efficacité. De toutes manières, Leila est un être si attachant, si mystérieux, si vulnérable aussi, que Vincent, et son lecteur avec lui, a raison de tout entreprendre pour la retrouver, la ramener à son orchestre et à la vie.
Maryse Pelletier (La fugue de Leila est de ces auteurs dont on peut acheter les livres de confiance, avant même de savoir de quoi exactement ils traitent. Elle excelle à créer l’atmosphère, elle accorde autant d’importance au cadre physique, s’il est pertinent de le faire, qu’aux sentiments enfouis au plus profond des personnalités. À cela s’ajoute une audace stylistique qui se manifeste différemment d’un livre à l’autre, mais qui explore sans cesse de nouveaux recours. Dans un autre livre (L’odeur des pivoines, chez le même éditeur), elle osait remettre en question l’existence d’un personnage et même l’éliminer au beau milieu du récit. Cette fois, elle se permet de clore d’une courte phrase en italique bon nombre des étapes de son récit et de synthétiser de cette manière le sens de ce qui précède. Tous les lecteurs ne goûteront pas cette intervention, mais il est fascinant d’en observer l’efficacité. De toutes manières, Leila est un être si attachant, si mystérieux, si vulnérable aussi, que Vincent, et son lecteur avec lui, a raison de tout entreprendre pour la retrouver, la ramener à son orchestre et à la vie.
Maryse Pelletier, La fugue de Leila, La courte échelle, Montréal, 2001, 156 p. ; 9,95 $.
Cuvée particulièrement alléchante, par conséquent, surtout par les titres qui oublient de se demander à quel public ils appartiennent.










