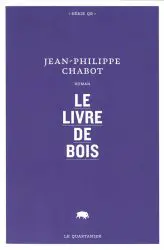Bien qu’elle défie les généralisations, il semble qu’une certaine mouvance « néoterroir » continue de faire des petits en territoire québécois.
Entre les films et séries télé réinterprétant des classiques de la trempe du Survenantet d’Un homme et son péché(il y aurait aussi un Menauddans les plans, nous prévient-on), et les remakeslittéraires récents de Maria Chapdelaineet de La Scouine, la campagne et le passé canadiens-français suscitent sans cesse de nouveaux regards. Comme s’il y avait là un vide à combler, une nécessité plus ou moins lyrique d’une « prise de terre ». C’est dans ce contexte que surgit Jean-Philippe Chabot avec Le livre de bois, un ouvrage ambigu qu’il faudrait simultanément lire comme un hommage à nos contes et romans de jadis, et comme un palimpseste à l’ironie possiblement perverse.
Tenant de la verve d’un Victor-Lévy Beaulieu et du savant délire verbal d’Hervé Bouchard (voir p. 30), l’écriture de Chabot est fermement accrochée à ses racines nationales, mais c’est pour les travailler dans l’ombre, à la manière d’un champignon très agressif. Ç’aurait pu n’être qu’un exercice de style très honorable, tissant et entrecroisant d’une main de maître les emprunts, sauf que la transformation s’étend ici jusqu’au réenchantement, atteignant, comme chez les auteurs cités, aux strates actives du grand dépotoir mythique.
Certains motifs de base sont dérivés de la « Chasse-galerie » dans ses diverses versions, ainsi que de L’influence d’un livred’Aubert de Gaspé fils, alors que le personnage de Jacques – qui est également un bon Jack – prend congé du chantier hivernal puis, en pleine tempête, tombe sous l’emprise de sa bête imaginaire. Il commet alors un sacrilège accidentel en tuant un veau égaré, ce qui l’entraîne dans une mécanique maudite alors qu’en essayant d’enfouir sa victime, il découvre un livre en bois, lequel aura une terrible influence autant sur son destin que sur ses origines. C’est qu’à la croisée du nouveau roman et du merveilleux, le fameux ouvrage s’avère réfléchir la vie de Jacques, donnant lieu à un jeu de chaises musicales entre le dedans et le dehors qui finira par engloutir la structure du réel.
Au passage, un narrateur narquois brouille les registres et multiplie les références cryptées, comme lorsque de façon inattendue les vers de Nelligan viennent hanter le portrait : « Ses espoirs gisaient gelés comme des étangs sous ses yeux ». Le parler populaire et les barbarismes, côtoyant un ton littéraire à l’excès, se trouvent inclus dans un artifice à grand déploiement, alors que les boursouflures stylistiques éclatent pour donner lieu à une radicale fête du récit. Souveraine et jouissive, la parole semble parfois déverrouiller des placards dans l’inconscient collectif, sans qu’on soit sûr de ce qui vient de nous arriver. Serait-ce que le livre a sur nous un effet semblable à ce que le livre fictif déploie sur Jacques ?
« Le Haut-Pays, se disait-il dans sa tête en lisant comme le font certaines personnes qui ne savent pas exactement se concentrer sur ce qu’elles lisent, c’est un pays que moé, Jacques Côté, je veux ben habiter là. » Guidé jusqu’aux cieux via la terre et le langage, notre homme semble se découvrir une force de fondation suffisante pour créer des pays élevés, faisant ainsi écho au docteur Ferron et à son Ciel de Québec, où l’imagination s’appropriait activement l’histoire. « Habiter le Haut-Pays – mieux le coloniser – c’était recommencer une toile après en avoir manqué une autre », est-il dit dans Le livre de bois, dont tout le mouvement fait de la mémoire une spirale vers l’avant.
Affublé de la mention « roman canadien-français », ce livre québécois imite son personnage, lorsque celui-ci tente d’utiliser son instrument de bois afin d’infléchir l’avenir immédiat. Lisant les dernières pages où son présent est en train de s’ajouter, il tente d’intervenir mais arrive toujours un moment trop tard, alors même que l’augmentation de son temps de lecture réduit de plus en plus la marge où des événements nouveaux peuvent apparaître. Il s’agit là, par la bande, d’une terrifiante et comique mise en scène de la littérature et des rapports qu’elle entretient avec la vie. Si le papier des livres provient des arbres, il y a quelque chose de satanique ou de faustien à confier aux lettres l’entièreté de notre aspiration à pousser vers les cieux – d’où, peut-être, l’insistant retour du « retour à la terre ».
D’un autre côté de chez Côté, on insiste en filigrane sur la salvation qu’amène la parole, avec son pouvoir d’effacement et de recommencement : « Moé, Jâcques Côté, chus pas mal bon, comme je le disé-je par avant, pour ramasser mes bévues ». On comprend que dans une autre vie (et chez autre éditeur) Chabot évolue en poésie, lui qui, tels Novarina, Bouchard et l’auteur anonyme de la Bible, prend acte de l’authentique strate d’existence dont accouche cette patente nommée le verbe.
LE LIVRE DE BOIS
- Le Quartanier,
- 2017,
- Montréal
135 pages
18,95 $
Loading...
Loading...