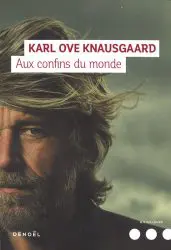Au tout début du quatrième livre de cette vaste entreprise de mémoire qu’est Mon combat – et qui se concentre cette fois-ci sur les dernières années de l’adolescence et les premières de l’âge adulte –, Karl Ove Knausgaard décrit ainsi les livres qu’il lit à cette époque : « […] des livres sur des jeunes hommes qui ne trouvaient pas de place dans la société et espéraient davantage de la vie qu’une somme d’habitudes, qu’une famille, bref, des jeunes hommes qui exécraient le conformisme et recherchaient la liberté ».
On ne saurait mieux résumer l’état d’esprit qui l’habitait au moment où s’ouvre Aux confins du monde alors qu’à dix-huit ans, il quitte le foyer familial pour la première fois et part enseigner dans un bled perdu dans le cercle polaire. Là, loin de tout, dans sa nouvelle indépendance, il pourra – pense-t-il – s’adonner à sa passion, l’écriture.
L’autre grande affaire qui occupe l’esprit de Karl Ove, ce sont les filles. Même les gamines de quatorze ou quinze ans qui sont dans sa classe le troublent. Il faut savoir qu’à dix-huit ans, il est toujours puceau. Pire, pas moyen pour lui de recourir à la masturbation : « [J]e ne savais pas comment faire ». Dévoré par un désir incessant, il trouve un dérivatif à son désert sexuel dans l’alcool, souvent jusqu’à la perte de conscience. « L’alcool rend tout grand, c’est un vent qui souffle sur la conscience, c’est des vagues qui se brisent, des forêts qui se balancent et une lumière qui dore tout ce que tu vois, parant d’une certaine beauté la personne la plus laide et la plus répugnante. C’est comme si toute objection et tout jugement étaient balayés d’un revers de la main, et comble de générosité, tout, je dis bien tout, était beau. »
Dans la longue nuit des hivers polaires, entre ses cuites et ses heures d’enseignement, il rédige ses premières nouvelles. Inquiet de son talent, il les fait lire à son entourage. Il est aux anges quand un oncle, poète lui aussi, le complimente. Il est au bord des larmes quand son grand frère n’y voit qu’efforts maladroits. Mais fier et orgueilleux, il ne se laisse pas arrêter pour autant (« Personne n’avait à me dire ce que je devais faire ») et fait une demande d’admission dans une école d’écriture à Bergen. Il y sera admis. Le « roman » s’achève sur cette ouverture et sur le récit de la nuit où il perd « à répétition » sa virginité dans les bras d’une jeune Islandaise délurée.
On a tout dit sur Karl Ove Knausgaard et sur le long selfie littéraire que constituent les 3 500 pages de Mon combat. Porté aux nues dans les pays nordiques, il a été boudé par l’intelligentsia française (Pierre Assouline en tête) qui l’accuse de n’enfiler que des banalités, voire des trivialités, et pour qui son œuvre n’est qu’un long tissu de platitudes. Ailleurs, dans le monde intellectuel anglo-saxon (Zadie Smith, Jeffrey Eugenides, Jonathan Franzen, par exemple), on considère que ces mêmes reproches prouvent, au contraire, l’honnêteté de la démarche de Karl Ove Knausgaard, qui ne cherche ni à séduire, ni à sublimer, ni à impressionner, surtout pas à taire ou à camoufler la banalité. Pour eux, ce « Proust norvégien » veut plutôt mettre à plat, dans sa nudité crue, une simple vie d’homme. Pour notre part, c’est cette quête de vérité sans artifice qui nous a énormément séduit aussi bien dans Aux confins du monde que dans les trois précédents ouvrages.
AUX CONFINS DU MONDE
MON COMBAT LIVRE IV
- Denoël,
- 2017,
- Paris
648 pages
42,95 $
Trad. du norvégien par Marie-Pierre Fiquet
Loading...
Loading...

1
2
ESPACE PUBLICITAIRE
DERNIERS NUMÉROS
DERNIERS COMMENTAIRES DE LECTURE
Loading...