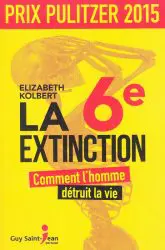Lauréate du prix Pulitzer de l’essai en 2015, Elizabeth Kolbert est journaliste au New Yorker. Militante écologiste, elle est l’auteure de trois ouvrages, dont Field Notes from a Catastrophe: Man, Nature, and Climate Change (2006), qui l’a rendue célèbre. La 6e extinction est son premier livre traduit en français.
Le titre fait référence à la disparition de l’humanité, que redoute un nombre croissant de chercheurs. Elle serait la sixième extinction de masse à survenir depuis un demi-milliard d’années et la plus dévastatrice depuis celle des dinosaures. S’appuyant sur les travaux de savants de diverses disciplines telles la géologie, la botanique et la biologie marine, les accompagnant souvent sur le terrain, de San Diego jusqu’à l’Islande et l’Amazonie, Kolbert montre comment l’être humain en est venu à altérer les conditions de vie sur terre et mettre notre monde à l’agonie. Elle relate l’éradication qui guette ou a déjà affligé différentes espèces, comme la grenouille dorée du Panamá ou le rhinocéros de Sumatra. Son enquête est à la fois instructive, divertissante et effarante. Véritable « document-choc », La 6e extinction démontre efficacement l’imputabilité de l’homme dans le fiasco environnemental planétaire. Le volume se clôt sur une singulière note d’espoir : pour surmonter le désastre qu’il a lui-même engendré, l’homme devra peut-être se résoudre à coloniser d’autres planètes. Tout simplement !
Guy Saint-Jean éditeur propose ici une « adaptation québécoise » de la traduction parue en France chez Vuibert. En comparant les deux versions, on en vient vite à douter du bien-fondé d’une telle initiative. Cette adaptation consiste notamment à fournir les équivalents en pouces et en pieds de mesures du système métrique ou à ajouter des précisions terminologiques, en indiquant par exemple que les scinques géants sont une « sorte de reptile » (sic), qu’une ammonite est « un mollusque » et qu’un herpétologiste est « un zoologiste qui étudie les reptiles ». Ailleurs, les adjectifs numéraux sont convertis en chiffres (« 1000 souris » au lieu de « mille souris »), les passés simples sont remplacés par des passés composés ou des plus-que-parfaits, tandis que des passages sont reformulés et des paragraphes redécoupés. Ainsi, « La première fois que j’entendis parler des grenouilles d’El Valle » devient : « J’ai découvert l’histoire des grenouilles d’El Valle ». Était-ce nécessaire ? On dirait plutôt une façon de sous-estimer l’intelligence du lecteur québécois.
ESPACE PUBLICITAIRE
DERNIERS NUMÉROS
DERNIERS COMMENTAIRES DE LECTURE
Loading...