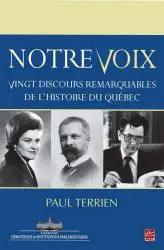Comme l’annonce l’auteur en introduction, Notre voix est « une distillation des 66 textes » de son recueil Les grands discours de l’histoire du Québec (2010), augmentée de 6 éléments « pour couvrir un plus large éventail de thèmes ». L’objectif de ce livre, dit-il, est d’offrir « un survol chronologique de notre histoire au moyen de discours ayant eu un retentissement important et illustrant les réalités politiques et sociales du moment ».
Le statut de la langue française au Québec et la pertinence de l’union fédérative canadienne sont ici des sujets récurrents. D’une part, en effet, on défend le droit des francophones de s’exprimer dans leur langue, au parlement (le député Michel-Eustache-Gabriel-Alain Chartier de Lotbinière, en 1793), en matière de foi religieuse (le chef nationaliste Henri Bourassa, en 1910) et au quotidien (le ministre Camille Laurin, en 1977) ; en 1988, le député Clifford Lincoln se prononce quant à lui contre la loi de l’affichage unilingue français dans la province. D’autre part, des parlementaires prennent parti pour ou contre la Confédération canadienne : les George-Étienne Cartier (en 1865), Pierre Elliott Trudeau (en 1980) et Brian Mulroney (en 1991) s’opposent ainsi à l’option antifédéraliste des Louis-Joseph Papineau (en 1867), Claude Charron (en 1975), René Lévesque (en 1977) et Jacques Parizeau (en 1994). On retrouve également dans ce débat, auquel prend part l’abbé Lionel Groulx (en 1937), la pensée fortement autonomiste de Maurice Duplessis (en 1942), de même que la courte mais vibrante affirmation de Robert Bourassa (en 1990) au sujet de la société distincte du Québec.
Sur un autre plan, soulignons l’inclusion d’un sermon de Jean-Jacques Lartigue, futur évêque de Montréal, qui prône l’indépendance de l’Église vis-à-vis du pouvoir politique tout en exhortant les Canadiens à la fidélité envers la Grande-Bretagne lors de la guerre de 1812-1814 contre les États-Unis : « […] soyez soumis à tous ceux qui vous gouvernent, quand même ils seraient injustes à votre égard, car c’est à la volonté de Dieu », va-t-il jusqu’à dire dans une envolée qu’aucun citoyen ne souffrirait sans doute d’entendre aujourd’hui. Si la conférence de 1846 du journaliste Étienne Parent sur la nécessité de « l’industrie […] comme moyen de conserver notre nationalité » est bien connue, il n’en va pas de même de celle de l’homme d’affaires montréalais Joseph Versailles visant, en 1921, à promouvoir chez les jeunes les carrières économiques et financières. Paul Terrien retient aussi le nom d’un autre tribun oublié, le député Albert Gervais, qui a brossé devant l’Assemblée législative, le 23 janvier 1964, un tableau fort instructif de l’évolution de l’éducation au Québec. Rares et peu concrétisées dans les archives québécoises, la voix des Premières nations et la contribution féminine au développement de notre société sont représentées par le bref mais parfois cinglant discours d’un chef micmac aux Français, au XVIIe siècle, et par celui de la ministre Marie-Claire Kirkland-Casgrain militant au Parlement de Québec, en 1964, pour l’égalité des femmes devant la loi.
Chacun des vingt textes recueillis est précédé d’une succincte biographie de l’auteur et d’une mise en situation du discours, de la conférence ou du sermon prononcé. N’est pas inscrite cependant la référence bibliographique de ces « voix » politiques, sociales et religieuses qui, par ailleurs, n’ont pas toutes été débarrassées de leurs gênantes coquilles et autres anomalies ; et le lecteur aurait peut-être souhaité lire la version complète des interventions des orateurs plutôt que les seuls extraits donnés, dans la majorité des cas. Les discours de Notre voix donnent en revanche le goût de remonter aux 66 textes du recueil de 2010.
ESPACE PUBLICITAIRE
DERNIERS NUMÉROS
DERNIERS COMMENTAIRES DE LECTURE
Loading...