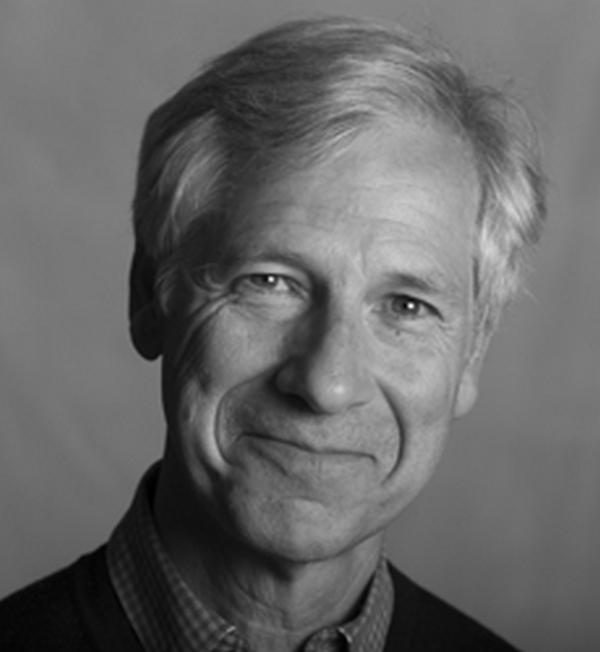Si l’on peut s’attendre à ce que les carnets s’inscrivent dans la continuité, le constat peut à première vue étonner en ce qui concerne le dernier roman d’André Major. Bien sûr, le style est autre, le rythme répond à d’autres règles, le climat que l’on veut instaurer diffère, voire 2 Major À quoi Boreall’humeur qui y règne, mais l’impression générale qui s’en dégage tend plus à évoquer l’harmonisation d’une démarche que le tracé de sillons narratifs distincts. Comme si, avec la venue de la maturité, comptait davantage la poursuite d’une œuvre dont les différentes ramifications ne cherchent plus qu’à rejoindre, qu’à alimenter une seule et même source : la parole. Ce qu’en d’autres mots, Antoine, le narrateur d’À quoi ça rime ?, exprime ainsi en reprenant les propos que Kafka adressait à Max Brod peu avant sa mort : « […] l’impression que l’essence même de l’art, que l’existence de l’art consiste à créer la possibilité d’une parole vraie d’être à être. Et Antoine se dit que c’est justement la recherche d’une telle parole qui finit immanquablement par le ramener aux mots de certains écrivains et à ses propres mots, à son propre besoin de raconter en espérant rendre la vie réelle, comme dit Pessoa ». Le propos du roman n’est autre que cette quête de la vie réelle qui ne peut, n’en déplaise aux matérialistes, se révéler, prendre forme, qu’au contact des mots. Et la quête d’Antoine se décline ici en trois temps. Pour respecter les dernières volontés d’un oncle, tout à la fois alter ego et prolongement du narrateur, celui-ci se rend à Lisbonne afin de répandre les cendres de son oncle le long du Tage. De courte durée, le voyage offre à Antoine, également écrivain, un temps d’arrêt qui lui permet d’entrevoir et de décider comment se dérouleront les années qu’il lui reste après avoir perdu sa conjointe et accumulé quantité de carnets dans lesquels il s’apprête à plonger, tout autant qu’il hésite à le faire. Suit le retour à Montréal, au cœur de l’automne, mais avec suffisamment de temps devant lui pour entreprendre la construction d’une cabane, dont il a jeté les plans à Lisbonne, le long d’une rivière où il pourra se réfugier et ainsi donner suite à son projet d’écriture. Ce repli monastique et l’attention soutenue aux petites choses du quotidien font ici écho au souhait évoqué ci-dessus d’inscrire au plus près le désir de raconter une histoire en espérant rendre la vie réelle. Et c’est à ce moment que surgit, surtout dans la troisième partie du roman, le personnage d’Irena, effacée et discrète, qui vient rappeler à Antoine que la vie réelle coule non seulement dans la lumière et ses miroitements flamboyants inondant la forêt laurentienne, mais dans les veines d’êtres faits de chair et d’os, nourris d’espoirs et de désillusions qui nous amènent, un jour ou l’autre, à nous demander à notre tour : à quoi ça rime ? Il n’est donc pas étonnant que le roman se termine en boucle, comme la vie.
[wd_hustle id="5" type="popup"]Mode lecture zen[/wd_hustle]
ESPACE PUBLICITAIRE
DERNIERS NUMÉROS
DERNIERS COMMENTAIRES DE LECTURE
Loading...