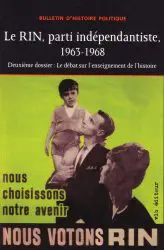À lui seul, le dossier que le Bulletin d’histoire politique consacre au Rassemblement pour l’indépendance nationale (RIN) démontre la pertinence d’un enseignement de l’histoire favorisant « l’arrimage entre l’histoire politique et l’histoire sociale, la reconnaissance du travail de transmission des connaissances des enseignants, le rétablissement d’une trame chronologique ». En effet, c’est en respectant cette pédagogie que l’examen du RIN joint le passé au présent et investit le passé et le présent dans l’édification de l’avenir.
Le RIN mourut jeune, mais il força les autres partis à se situer par rapport à l’indépendance du Québec et à parier sur l’État et sa planification. Grâce à lui, le peuple québécois put mesurer la différence entre le respect du citoyen et l’embrigadement des foules. Un mouvement politique modifiait le tissu social.
Le témoignage d’Andrée Ferretti est, à cet égard, exemplaire et déterminant. Pourquoi le Parti québécois (PQ) fut-il d’abord le Mouvement Souveraineté-Association ? Maturation du projet ? Hésitation de René Lévesque ? Andrée Ferretti dit autre chose : « […] j’ai toujours pensé que le mouvement pour l’indépendance ne saurait se constituer en parti qu’au moment où la majorité du peuple aura été convaincue de son absolue nécessité et prête à la réaliser et à l’assumer ». Autrement dit, le parti qui ne s’assure pas de la compréhension du peuple risque la solitude…
Le texte de Janie Normand sur la droite québécoise traditionnelle explique plusieurs des tiraillements qui déchirent le PQ depuis un demi-siècle. Si l’idée d’indépendance nationale convenait à beaucoup, les divergences éclataient quant au choix entre révolution et ajustement, entre bouleversement et évolution. Manifestement, le désir d’un front uni conduisit les partenaires-malgré-eux à des ententes mal cimentées. En montrant le culte du Regroupement national (RN) pour des valeurs de type pétainiste (foi, famille, patrie), Normand explique les clivages qui, depuis, traversent le camp des indépendantistes. « Aujourd’hui encore, écrit Réjean Pelletier, l’électorat traditionaliste s’avère toujours être l’un des pivots nécessaires à l’élection d’un gouvernement péquiste majoritaire ».
Le dossier fait sa part à l’hommerie. Charismatique, Pierre Bourgault donna force au plaidoyer indépendantiste ; méfiant, René Lévesque « ne désirait pas la disparition du RIN. Il préférait voir ce parti continuer son action et ne pas retrouver ses militants dans ses rangs ». L’un et l’autre, tels des orignaux mêlant jusqu’à la mort leurs panaches belliqueux, se forcèrent à des contorsions aux conséquences entêtées.