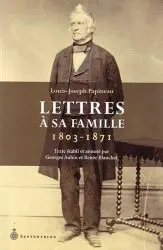Mission impossible et pourtant accomplie. Louis-Joseph Papineau, suivi à la trace par un trio minutieux et alerte, est restitué à la fois à ses convictions et à son sens aigu de l’adaptation. Ce qu’il est en politique – capable de constance, mais rarement imprudent –, Papineau l’est aussi dans la gestion des relations familiales et l’administration de sa seigneurie de la Petite-Nation. Comme au cours des étapes précédentes, Yvan Lamonde apporte au bilan son sens de la synthèse et sa nette perception des lignes de force, tandis que le duo Aubin-Blanchet se fait un devoir et même un scrupule d’éclairer chacune des multiples interventions de Papineau.
Car c’est peut-être un des plus fascinants aspects de cet homme que son intense attention à tout le réel. Il est au fait des plus récentes théories au sujet de la vaccination (de la vaccine, disait l’époque), différencie tel basilic de son cousin, rassure la mère qui ne sait comment résorber une hernie abdominale chez un enfant, complète le mince revenu de son exil parisien en enseignant la botanique, etc. Qu’on n’aille pourtant pas en conclure à une quelconque superficialité du tempérament. Plus de la moitié des 403 lettres regroupées dans ce sixième tome de la correspondance de Papineau portent, en effet, sur un objet exigeant et circonscrit : la gestion d’une seigneurie de 176 000 arpents à laquelle s’intéressent pour des raisons variables plus de 700 censitaires, locataires ou pilleurs. L’enjeu est net : ou bien Papineau assainit la gestion d’un domaine dont la politique et ses aléas l’ont tenu éloigné pendant des années, ou bien c’en est fait de la sécurité d’une descendance dont Papineau porte fièrement la responsabilité. L’effort de rattrapage est fascinant à observer. Papineau presse ses collaborateurs d’appliquer la loi avec constance, mais il demeure sensible aux malheurs individuels et déroge lui-même à ses ukases. Ses lettres sont, à cet égard, d’une humanité aussi séduisante qu’imprévisible. Du ton du patron, il passe à celui du parent affectueux. Il multiplie les reproches à ses émissaires, mais se rappelle toujours en cours de route que ces intermédiaires lui sont intimement apparentés et très chers : son frère Denis-Benjamin, son neveu Joseph-Benjamin-Nicolas et le mari de la fille de Denis-Benjamin. L’exigence est souvent abrupte, le rétablissement de l’affection ne fait jamais défaut.
Plusieurs des plus substantielles missives datent de l’exil parisien. Soustrait à la trépidance politique et libéré des quémandeurs de tout poil, Papineau prend le temps de s’expliquer, de nuancer, de comparer l’Europe et les États-Unis, d’expliquer en détail les roueries du 10 Downing Street. Plus tard, peut-être la disparition de son épouse Julie marquera-t-elle, à sa manière, un autre changement de ton, comme si Papineau s’efforçait à la gaieté, à l’humour et à la galanterie pour mieux apaiser sa solitude.
Un chantier se ferme : grâce à l’indéfectible professionnalisme d’une petite équipe, le Québec peut enfin presque tout savoir d’une de ses plus impressionnantes figures.