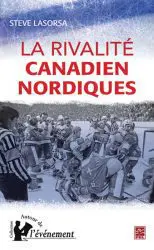Avec La rivalité Canadien-Nordiques, Steve Lasorsa veut évaluer la signification historique et nationaliste d’un affrontement symbolique qui passe par le sport. En faisant de la bagarre générale du Vendredi saint l’événement-clé de la rivalité entre Montréal et Québec au hockey, l’auteur plaide, avec raison, pour un examen des passions populaires. Toutefois, l’essai accumule les imprécisions, les lieux communs, les formules creuses, les erreurs, les jugements à l’emporte-pièce, sans perspective réellement historique. À lire l’auteur, tous les Québécois, sans exception, ont été happés par la confrontation sportive (comme si les indifférents au hockey n’existaient pas), les années 1980 sont une époque de « ferveur nationaliste », le choix d’une équipe (et de son chandail) détermine une position constitutionnelle. La thèse défendue par l’auteur n’est pas nouvelle ni originale, mais elle a son mérite : le conflit entre le Canadien et les Nordiques dépasse l’enjeu sportif et canalise les oppositions entre les postures politiques de la population québécoise. La rivalité serait alors un lieu de déplacement des conflits d’appartenance, bien que l’auteur ne s’intéresse nullement à comprendre la nécessité et les circonstances de ce déplacement symbolique. Pour défendre sa thèse, l’historien s’inspire des journaux de l’époque, des témoignages des joueurs et des participants, mais sans consulter les analyses politiques québécoises existantes. Pire, le contexte est peu pris en compte (au hockey, dans le sport nord-américain, dans les autres domaines culturels, notamment médiatiques). Tout se passe comme si la rivalité n’avait qu’une signification nationaliste, alors que la compétition entre les villes de Québec et de Montréal est présente depuis l’essor de l’Amérique française, et qu’une bagarre entre deux frères ontariens (les Hunter) n’est pas la base idéale pour saisir une facette du néo-nationalisme post-référendaire. La rhétorique guerrière des journalistes est certes mise en évidence, mais Lasorsa en abuse à son tour, comme s’il y avait une complaisance dans son propos à outrer les antagonismes politiques et la valeur symbolique d’une bagarre générale, dont au final il ne parle pas.
L’essai de Lasorsa veut signaler la force symbolique du hockey, mais il le fait en postulant qu’un essai sur le sport doit être amusant et bourré de métaphores fades concernant le jeu (comme cette table des matières calquant la périodisation du jeu : ô combien original !). Les phrases incomplètes sont légion, les erreurs grammaticales abondent, les approximations tiennent lieu d’argumentation, les redites apparaissent partout et les faits en prennent parfois pour leur rhume (le fédéralisme devenant un sous-genre du nationalisme ; l’arrivée de joueurs anglophones est datée de la faillite des Maroons, alors qu’elle a lieu beaucoup plus tôt, etc.). Cet essai n’est pas celui qu’on attendait pour comprendre un épisode marquant de l’histoire québécoise contemporaine.