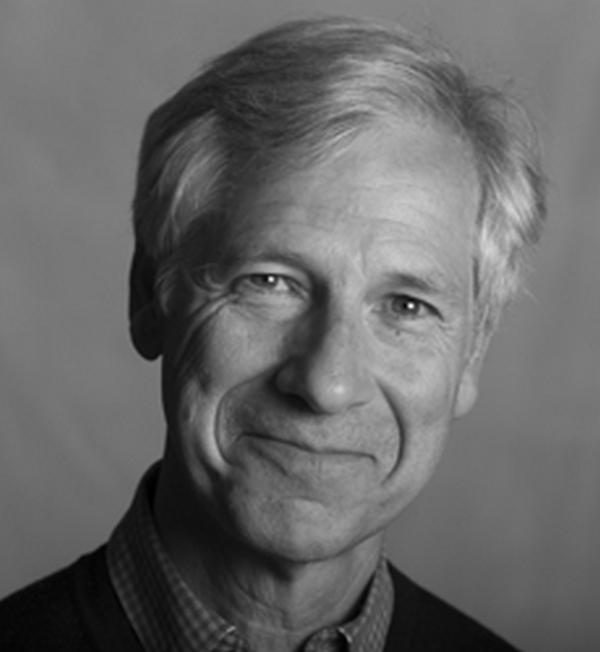Lorsque la décision fut prise de consacrer ce numéro des « Cahiers Fernand Dumont » à la « crise de l’éducation », comme le souligne son directeur, Serge Cantin, rien ne laissait présager que le Québec allait sortir de sa torpeur le temps d’un printemps érable qui mobiliserait des centaines de milliers d’étudiants et de sympathisants, toutes générations confondues, sur la question des frais de scolarité. Pointe de l’iceberg de la crise, le malaise était toutefois plus profond, comme l’illustrent éloquemment les vingt articles ici réunis qui regroupent autant d’auteurs d’horizons divers (tant disciplinaires, générationnels que nationaux) qui ont répondu à l’appel de textes lancé à l’automne 2011 autour des questions suivantes : où en est l’idéal de la démocratisation scolaire 50 ans après la publication du rapport Parent ? Que transmet aujourd’hui l’école ? A-t-elle perdu sa fonction d’enracinement dans des valeurs communes ? La littérature a-t-elle toujours une place dans le cursus scolaire ? Quelle histoire veut-on enseigner ? Et les sciences, quel rôle veut-on leur faire jouer ? Et l’université ? On le voit, les questions sont multiples et sont pour la plupart demeurées sans réponse. Surtout, elles appellent à une réflexion qui va au-delà de la succession des changements structuraux qui ont eu cours depuis la parution du rapport Parent.
L’ouvrage, dans lequel la pensée et les travaux de Fernand Dumont se font écho, se divise en quatre parties. La première présente des critiques d’un point de vue interne du système scolaire, notamment sous l’angle du frein que représente la hausse des frais de scolarité dans le développement du Québec, rappelle l’importante mutation culturelle entraînée par la laïcisation du système scolaire, et dénonce l’assèchement, voire la stérilisation des contenus au profit des modes de transmission pédagogiques (la lente disparition des contenus littéraires en est un exemple récurrent). La seconde partie réunit des points de vue autour des finalités de l’école où l’on trace notamment un portrait critique de l’enseignement de la littérature dans les collèges depuis la réforme de 1994, et où l’on s’interroge également sur les liens entre la crise de l’éducation et la crise de la modernité telle que pressentie par Hannah Arendt et analysée par Fernand Dumont. Le parallèle établi par l’auteur est ici fort éclairant. La troisième se penche sur les problèmes liés aux idéologies transmises (notamment au regard de l’enseignement de l’histoire nationale et politique), aux réformes et aux structures scolaires et, non le moindre des problèmes, à la financiarisation des universités. Enfin, une dernière partie s’attarde au phénomène de l’individualisme et des nouvelles technologies d’information et de communication.
Un aussi rapide survol ne peut rendre hommage à la qualité des contributions réunies dans ce livre, mais il est à espérer qu’elles alimenteront les nécessaires débats à venir sur ces questions.