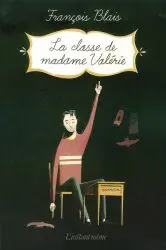Comment, débordant de verve et servi par sa merveilleuse agilité d’écriture, François Blais aurait-il pu résister à la tentation de proposer au lecteur un faisceau stroboscopique de destins ? Suivre un seul individu, cela n’aurait-il pas été pour lui paresse et facilité ? Pourquoi, en effet, puisqu’il sait se détendre et s’amuser tout en franchissant des rapides en sautant d’un rocher à l’autre, se limiterait-il à un seul flux et à un seul risque ? Pour notre plus grand plaisir, Blais ose grand et large, toujours plus grand et plus large. La classe de madame Valérie, c’est non pas un roman scolaire en forme de cours magistral versant un savoir dans des outres juvéniles, mais une écoute offerte par une aînée à 25 incubateurs d’avenir ; plus encore, c’est l’accueil à pleine envergure offert à 26 cheminements. Sans jamais nous révéler le tout d’aucun d’entre eux, Blais nous les aura tous et toutes incarnés de façon chaleureuse et plausible (à deux courtes exceptions près). À partir de trois points fixés à propos de chacune et de chacun, au lecteur de se prendre pour Euclide et d’imaginer 26 droites ou autant de courbes.
Blais s’oblige à mieux encore. Certes, il saisit ses personnages en trois temps de leur parcours (1990, 1997 et 2011), mais il concentre les péripéties dans les trois derniers jours d’octobre de chacune de ces années, autrement dit dans l’avant-veille, la veille et le jour de l’Halloween. Façon peut-être de resserrer le cadre et la symbolique pour mieux honorer l’imprévisible liberté des multiples destins. À d’autres époques, le défi était de se plier à la prosodie du sonnet sans rogner les ailes de l’inspiration ; il est, chez Blais, d’observer 26 papillons (oui, oui, madame Valérie aussi) sans les épingler mortellement. Superbe déferlement qui restitue une identité nette à chaque personnage tout en faisant voir l’influence sur le groupe de l’érosion imputable au temps. De son côté, l’importance accordée à l’Halloween souligne peut-être la faculté accordée aux humains, de leur plus jeune âge à celui de la maturité, d’arborer plusieurs masques avant de capter ou de retrouver leur identité profonde.
Malgré ces contraintes voulues et assumées par l’auteur, l’idée de crépitement ou de pétillement demeure présente à l’esprit du lecteur pendant tout le livre : la classe de madame Valérie comprend 25 enfants d’une douzaine d’années appelés à s’exprimer avec naturel et effervescence, à former des clans, à aimer (temporairement) telle beauté, à choisir tel ou tel comportement, à verser dans la fantaisie, le caprice, la rancune… Ils grandiront à Shawinigan (Shawi), mais on les retrouvera plus tard, transplantés, prolongés ou redéfinis, à Hull, à Québec et dans combien d’autres décors. Le livre se refermera sans livrer d’autres conclusions que celle d’une vibration libre, généreuse, sans cesse réinventée. Encore, svp !