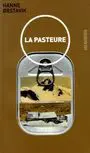Le bout du bout du monde se situe sans doute au nord-est de la Norvège, là où le pays se confond avec ses voisins finlandais et russe. Dans le grand blanc du Finnmark, sur la mer de Barents, vit depuis dix mille ans le peuple Same – ou Saami. Hanne Ørstavik y est née en 1969 et y conduit son personnage, Liv, 35 ans, doctorante en théologie.
La pasteure est luthérienne bien sûr, car l’action se passe en Scandinavie, là où les femmes prêtres sont nombreuses. « Ceci est le sang du Christ. J’ai fait un pas de côté, versé du vin dans la coupe suivante. » Liv veut vraiment être un bon ministre dévoué à sa communauté. « Je me tenais devant l’autel pendant qu’on chantait un psaume. Et il y avait une telle paix. »
La thèse de théologie de Liv, commencée en Allemagne, l’a amenée dans ce coin perdu de la Laponie où a eu lieu en 1852 l’insurrection des Sames contre les Norvégiens. À moins que ce ne soit contre les chrétiens car si les Sames ont été évangélisés dès le XIIe siècle, leurs croyances animistes traditionnelles persistent encore. Ou alors parce que les Européens leur avaient menti : « […] le conflit avait trait à la société, au pouvoir ».
Liv entend les douleurs du passé et celles d’aujourd’hui, dont les siennes propres, les amours multiples et torturées, les morts brutales, la culpabilité, la fuite en avant. La pasteure est honnête ou tente de l’être mais le drame lui colle à la peau et la rattrape. « Je m’étais ramenée avec mes gros sabots. Maladroite, lourde, collante, voilà comment je m’étais radinée, infichue de l’aider. »
La pasteure est un roman grave, une écriture dense de dialogues intérieurs, un roman de femmes aussi : la narratrice, son amie disparue dénommée Kristiane et sa fille, la sacristaine same Nanna et ses enfants Maja et Lillen, et puis la jeune Same, paroissienne suicidée. « Je ne sais pas si j’ai la foi, ou si la foi que j’ai peut m’être d’aucun secours. »
Neuvième roman de Hanne Ørstavik, La pasteure a remporté le Brage, prestigieux prix littéraire norvégien.