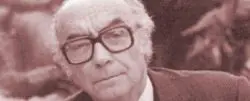Les lecteurs de José Saramago connaissent bien ses phrases sinueuses, ses dialogues déjantés où le changement d’interlocuteur se limite à des majuscules soudain insérées dans le texte, le foisonnement d’idées et de clins d’œil, la truculence un peu baroque du style, l’intelligence aussi, la finesse, l’ironie. À ce titre, le dernier roman1 du Nobel portugais ne devrait pas les décevoir.
 Ajoutons à ces attributs cette habitude de Saramago d’intervenir sans cesse dans son histoire, à titre d’auteur plus que de narrateur souvent, brisant le fil du récit comme pour mieux appeler le lecteur à ses côtés, l’invitant à regarder et à construire avec lui l’histoire qui se déroule un peu au hasard, lentement, au rythme des hommes et des femmes qui l’habitent et la construisent eux aussi, en même temps que nous. Ce jeu narratif, Saramago le peaufine depuis longtemps. Dès ses premières œuvres, il s’est mis à jouer avec le temps, l’espace, le vraisemblable, la narration. Dans Le Dieu manchot, dès 1987 donc, on le voit se promener dans son récit presque comme un touriste en cavale. Puis, dans Histoire du siège de Lisbonne, en 1992, et plus encore peut-être dans L’Évangile selon Jésus-Christ, en 1993, pour ne nommer que ces titres, on le verra s’approcher des choses et aussitôt s’en éloigner, pour ensuite les ressaisir au vol, les exprimer autrement, les trafiquer avec cet humour sournois et complice à la fois qui le caractérise tant. Sa position variable, tant face au lecteur qu’à ses personnages, ses différents lieux d’intervention, ses anachronismes délibérés, sa façon de déconstruire son récit pour mieux le reconstruire par la suite, certes tout cela pourra donner l’impression que l’aventure ludique de la lecture est en train de céder le pas à l’analyse universitaire. Or quelques pages suffisent à rassurer le lecteur : Saramago s’amuse, il ne discourt pas. Et il n’en tient qu’à nous lecteurs de le suivre dans les méandres de son imagination débordante et de ses nombreux jeux ; lesquels, s’ils peuvent en effet alimenter l’analyste en moult impressions savantes, et nous faire réfléchir sur le rôle actif du lecteur dans l’œuvre littéraire et sur bien d’autres considérations fort sérieuses, il faut le rappeler, sont d’abord et avant tout… des jeux !
Ajoutons à ces attributs cette habitude de Saramago d’intervenir sans cesse dans son histoire, à titre d’auteur plus que de narrateur souvent, brisant le fil du récit comme pour mieux appeler le lecteur à ses côtés, l’invitant à regarder et à construire avec lui l’histoire qui se déroule un peu au hasard, lentement, au rythme des hommes et des femmes qui l’habitent et la construisent eux aussi, en même temps que nous. Ce jeu narratif, Saramago le peaufine depuis longtemps. Dès ses premières œuvres, il s’est mis à jouer avec le temps, l’espace, le vraisemblable, la narration. Dans Le Dieu manchot, dès 1987 donc, on le voit se promener dans son récit presque comme un touriste en cavale. Puis, dans Histoire du siège de Lisbonne, en 1992, et plus encore peut-être dans L’Évangile selon Jésus-Christ, en 1993, pour ne nommer que ces titres, on le verra s’approcher des choses et aussitôt s’en éloigner, pour ensuite les ressaisir au vol, les exprimer autrement, les trafiquer avec cet humour sournois et complice à la fois qui le caractérise tant. Sa position variable, tant face au lecteur qu’à ses personnages, ses différents lieux d’intervention, ses anachronismes délibérés, sa façon de déconstruire son récit pour mieux le reconstruire par la suite, certes tout cela pourra donner l’impression que l’aventure ludique de la lecture est en train de céder le pas à l’analyse universitaire. Or quelques pages suffisent à rassurer le lecteur : Saramago s’amuse, il ne discourt pas. Et il n’en tient qu’à nous lecteurs de le suivre dans les méandres de son imagination débordante et de ses nombreux jeux ; lesquels, s’ils peuvent en effet alimenter l’analyste en moult impressions savantes, et nous faire réfléchir sur le rôle actif du lecteur dans l’œuvre littéraire et sur bien d’autres considérations fort sérieuses, il faut le rappeler, sont d’abord et avant tout… des jeux !
Il est aussi intéressant de se pencher sur la façon qu’a Saramago de nous présenter non seulement son histoire, mais l’Histoire. Car ce dernier roman, comme bien d’autres dans le passé, aussi invraisemblable que cela puisse paraître à l’occasion, nous présente des événements historiques. Certes, la plupart sont complètement tombés dans l’oubli, mais la trame historique est bel et bien là, le lecteur vigilant peut vérifier à sa guise. Il ne faudrait pas cependant que cela l’empêche de plonger dans le pur plaisir des mots et du récit. Car il faut aller au-delà de la Nouvelle Histoire à laquelle on associe souvent Saramago, où l’accent est mis justement sur les menus détails toujours oubliés par les chroniqueurs traditionnels, et où le jeu très borgésien entre réel et fiction est omniprésent. Cela est aussi divertissant, certes ; mais, il faudra davantage se laisser bercer par le simple mouvement des phrases et des personnages, s’amuser à voir les rouages du récit, les détours de l’histoire, se sentir parfois extérieur, parfois témoin, ballotté par les rôles changeants qu’on nous fait tenir et que se voient attribuer les personnages, voire le narrateur lui-même.
Surtout il faudra ici se laisser conduire par la lenteur désopilante et pourtant si sage de notre personnage principal : un éléphant ! Car, oui, c’est bien d’un éléphant qu’il est ici question, un majestueux pachyderme d’Asie, dénommé Salomon, ou Soliman, c’est selon, que le roi du Portugal, João III, et son épouse, Catherine d’Autriche, offrent en cadeau de mariage à l’archiduc Maximilien d’Autriche, gendre de Charles Quint. C’est le voyage de cet éléphant et de son escorte, entre Lisbonne et Vienne, que nous raconte Saramago dans cette fable inénarrable. Les rencontres, heurts et politesses, joies et craintes de tout acabit, nous sont présentés en vrac au fur et à mesure de la lente progression de la troupe le long des routes du Portugal, de la Castille, de la Provence, de l’Italie et enfin de la froide Autriche. Caprices, stratégies, langueurs, brèves tendresses, miracles, querelles et réconciliations, tout y passe dans ce fort original Voyage de l’éléphant. Surtout la nature humaine, ses hauts et ses bas ; et, par-dessus tout, l’absurde mais émouvant désir de durer, avec le majestueux éléphant comme métaphore ultime, celle de la vie source de fiction.
C’est le dernier roman en français de Saramago. On se demande où il pourra aller ensuite. Jeune fou de 88 ans, que nous réserve-t-il encore ? Pour les pressés ou les polyglottes, un roman vient de paraître en portugais (Caim, 2009). On y retrouve Caïn, son frère Abel, les éternels tourments des hommes devant le destin et devant (?) Dieu… On y retrouve le style, le rythme, le ballet stylistique de toujours. On pourra le lire bientôt en espagnol : sa traductrice – et au demeurant épouse – espagnole (fière grenadine), Pilar Del Río, a sans doute déjà terminé sa traduction, avec son habituelle touche magique. Suivra peu après sans doute la traduction française. Et en français, nous ne sommes guère en reste, Geneviève Leibrich sera encore là certainement, comme depuis des lustres : et quel bonheur pour nous lecteurs de pouvoir compter sur une fidèle, une grande traductrice, qui reste là d’un livre à l’autre, pour maintenir le cap, sans faux bond, ni trop près ni trop loin, juste là où on l’attend, comme la douce ombre de l’auteur que se doit d’être tout traducteur.
Entre Kundera et Calvino, en passant par Pessoa parfois, nous continuons à suivre Saramago dans ses méandres, ses réflexions, ses abandons. Et c’est tout un plaisir, que nous ne voulons surtout pas voir cesser.
1. José Saramago, Le voyage de l’éléphant, traduit du portugais par Geneviève Leibrich, Seuil, Paris, 2009, 215 p. ; 29,95 $.
José Saramago a publié, entre autres :
Le Dieu manchot, Albin Michel, 1987 et Points, 1996 et 2008 ; L’année de la mort de Ricardo Reis, Seuil, 1988 et Points, 1992 et 1998 ; Le radeau de pierre, Seuil, 1990 et Points, 2010 ; Histoire du siège de Lisbonne, Seuil, 1992 et Points, 1999 ; L’Évangile selon Jésus-Christ, Seuil, 1993 et Points, 2000 ; L’aveuglement, Seuil, 1997 et Points, 2000 ; Les poèmes possibles, Jacques Brémond, 1998 ; Tous les noms, Seuil, 1999 et Points, 2001 ; Quasi objets, Points, 2000 ; Manuel de peinture et de calligraphie, Seuil, 2000 et Points, 2002 ; Le conte de l’île inconnue, Seuil, 2001 et Alexandre Stanké, livre CD, 2007 ; La caverne, Seuil, 2002 et Points, 2003 ; Pérégrinations portugaises, Seuil, 2003 ; L’autre comme moi, Seuil, 2005 et Points, 2006 ; La lucidité, Seuil, 2006 et Points, 2007 ; Les intermittences de la mort, Seuil, 2008 et Points, 2009 ; Le voyage de l’éléphant, Seuil, 2009 ; Le cahier, Le cherche midi, 2010.
EXTRAITS
Ce sera au fond comme si, dans un film, chose inconnue en ce seizième siècle, nous collions des sous-titres dans notre langue pour suppléer à l’ignorance ou à une connaissance insuffisante de la langue parlée par les acteurs.
p. 34-35
Et maintenant, si nous ne craignions pas de commettre un anachronisme très grave, nous aurions envie d’imaginer l’archiduc parcourant la distance jusqu’à son carrosse sous un baldaquin de cinquante épées sorties de leur fourreau, cependant il est plus probable que ce genre d’hommage ait été l’idée d’un des siècles frivoles qui suivront.
p. 154
Il est vrai que le cornac ne sauva pas l’archiduchesse, mais il aurait pu le faire puisqu’il l’avait imaginé, et c’est cela qui compte.
p. 189