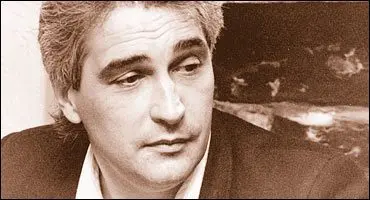L’écrivain et poète Renaud Longchamps a reçu en 1992 le Grand Prix de poésie de la fondation Les Forges pour son recueil Décimations : la fin des mammifères. Cette distinction suivait de quelques années celle du Prix Émile-Nelligan, obtenu en 1989 pour un autre recueil, Légendes/Sommation sur l’histoire.
On pourrait jouer du rapprochement littéraire pour situer la démarche du poète. Si l’on considère l’ensemble de son œuvre, force est de reconnaître qu’elle n’est pas sans lien avec la prophétie de Rimbaud : « Un jour, la poésie sera matérialiste », puisque sa poésie en exprime à merveille l’esprit. Elle a quelque chose aussi du murmure serré des textes de Michaux, poète des replis de la vie, des chimies et des matières. On y trouve également du Artaud recyclé à froid aux fournaises stellaires. Mais il y a surtout, qui lui est propre et rend sa poésie semblable à nulle autre, visible dans Décimations plus qu’ailleurs dans ses textes, un poète qui veille aux confins, là où nous ne sommes plus qu’un tassement de neurones, de cellules, de muqueuses, de gènes ; et là encore où nous redevenons des représentants interchangeables de l’Espèce, voire une pulsion aveugle du vivant cherchant dans le meilleur des cas à se libérer des « sept cordes » de la matière.
Le Grand Prix de poésie accordé à Décimations : la fin des mammifères consacrait aussi près de vingt années de travail et de publication continue depuis la sortie en 1973 de Paroles d’ici. L’occasion était belle de rencontrer Renaud Longchamps, de l’interroger sur son cheminement.
Nuit blanche : Le recueil Décimations : la fin des mammifères comprend deux parties : « Retour à Miguasha » et « Décimations ». Parlons d’abord de « Décimations », qui a donné son titre au recueil : sa lisibilité étonne quand on le compare non seulement aux textes de la première partie, « Retour à Miguasha », mais à l’ensemble de votre œuvre. Est-ce de propos délibéré ? Pour rejoindre un plus large public ?
Renaud Longchamps : Je ne sais pas si je rejoindrai un plus grand public amateur de poésie. Cent, mille, dix mille lecteurs ? C’est ridicule. Prenons par exemple le cas de Stephen Hawking. Son livre Une brève histoire du temps (Flammarion, 1989) a été récemment un grand succès de librairie. Je suis prêt à parier ma chemise que pas un acheteur sur cent l’a lu d’une couverture à l’autre. Et que pas un sur mille l’a compris. Alors De toute façon, pour moi, la poésie n’a jamais été le lieu de la facilité sentimentale, ni celui de la p’tite passe émotionnelle. La poésie est le territoire païen de la révélation. Ce recueil serait le moins hermétique de mon œuvre ? Peut-être. Du moins, je l’espère.
Il est vrai que j’ai fixé des balises sémantiques visibles et des paramètres scientifiques accessibles à un public élargi. Mais vous êtes priés de croire que je n’ai aucune visée mercantile. Trop d’écrivains diluent leur style et dilapident leur talent dans la débauche polygraphique. Avec pour résultat que les meilleurs adorent le Veau d’or et salivent avec leur siècle.
Nous vivons une époque de désintégration générale. Et nous sommes en phase d’acculturation accélérée. Des manipulateurs de tout acabit tentent d’imposer à un public troublé et affolé une mythologie rédemptrice ou salvatrice dont les dieux ou les émissaires seraient bien sûr les gentils extraterrestres. Selon ces manipulateurs, ils débarqueraient bientôt et nous révéleraient la panacée. Ils institueraient un gouvernement mondial démocratique, juste et équitable, abolissant au passage les guerres et les autres avatars de la condition humaine. Dans l’esprit de plusieurs, intelligence cosmique rime avec sagesse galactique. Inutile de vous dire que tout ça est grotesque, pour ne pas dire ridicule.
J’ai recueilli récemment les confidences de professionnels à l’emploi de grosses compagnies et des gouvernements. Face à la confusion générale et à la destruction de tous les consensus, l’élite même de notre société ne sait plus où donner de la tête. L’Orient et l’Occident attendent avec fébrilité un signe du ciel, un Guide, un Maître. Croyez-moi, ce signe viendra, mais il ne sera pas celui attendu. Car le ciel est désespérément vide de signes humains. Oui, l’humanité est unique dans l’univers. L’amour humain est unique. De même la haine et toutes les passions accessoires propres au cerveau des mammifères supérieurs. Quant à l’intelligence, c’est le comportement biologique le plus répandu dans l’univers, mais avec des finalités différentes pour chaque espèce. Cruel paradoxe
Bref, la lisibilité de mon recueil est une manière d’avertissement. Il y a urgence en la demeure !
L’urgence, toujours l’urgence
Il y a en effet un sentiment d’urgence, un signal d’alarme dans Décimations qui aurait pu incliner à rendre moins elliptique l’écriture. Je pense à votre trilogie en prose, une exception formelle qui a dû vous être inspirée par les questions immédiates dont vous vouliez traiter.
R. L. : Dans le cycle de Babelle, je décris les « forces de marée » qui brisent les civilisations, les sociétés, les cultures et les individus. De tout temps, les forces centrifuges prédatrices et sexuées s’attaquent à la vie et en détournent la finalité. Dans le premier tome (Après le déluge), le héros anonyme subit la violence, verbale et physique, de sa collectivité, dans une suite de tableaux crus et cruels où s’entrechoquent et s’entrecroisent histoire, langues, us et coutumes, etc. Dans le second tome (L’escarfé), le héros rend la monnaie. Il torture, saccage et tue. Ce roman évoque les clips contemporains, la violence individualiste, gratuite et débridée. Sa violence ne se rattache plus à l’Histoire ou à l’idéologie. Il annonce la néo-barbarie du XXIe siècle. Enfin, Américane décrit le processus d’acculturation du Québec à la civilisation pragmatique et utilitariste nord-américaine. Dans cette trilogie, il s’agissait de rendre compte de « l’état nauséeux des êtres et des choses », de la réalité apoétique, décervelante, où la matière marchande se fait l’écho de la matière brute – et la prose, en effet, se prêtait mieux à ce genre d’exercice.
Le sentiment d’urgence que je ressentais à l’époque de Babelle, eh bien, je l’éprouve aujourd’hui de nouveau dans la trilogie que j’amorce avec La fin des mammifères. Ce dernier recueil sera bientôt suivi de L’humanité véloce et de Ataraxie.
Comment interpréter l’exergue à Décimations ? Vous citez dans un premier temps Gaston Miron : « Sans la poésie, la science ne peut échapper à la science », pour ensuite compléter par la paraphrase suivante : « Sans la science, la poésie ne peut échapper à la poésie ».
R. L. : Je dis tout simplement que le poète vit avec son siècle et qu’à ce titre il doit tenir compte, dans ses écrits, de la connaissance contemporaine. Nous savons depuis plus de soixante-quinze ans que la lumière se plie à la gravité. Mais je constate avec stupéfaction que cette réalité n’a pas encore été resacralisée en poésie par la presque totalité des poètes de ce siècle ! Pour eux aussi le soleil continue de se coucher à l’horizon
Mais l’exergue rappelle aussi la fidélité au projet initial de fondre ensemble poésie et science. Votre œuvre jusqu’ici – il y a près d’une vingtaine d’ouvrages derrière Décimations – peut être vue comme un éloge des deux discours, poétique et scientifique, dont l’esprit se retrouve en effet fusionné dans vos textes. Où en est votre réflexion sur la poésie et la science ?
R. L. : La science privilégie le mesurable et le reproductible. Elle ne reconnaît pas l’aléatoire et quand elle en trouve sur son chemin, elle finit toujours par le mettre en équations. Par contre, la poésie met au jour des réseaux divers de sens, multipliant les entrées et les sorties. C’est le monde de l’interprétation plurielle, de l’émotion et de l’impression, irréductible à la raison. L’univers de la nécessaire imprécision. A priori, les deux univers sont inconciliables. Dans ma poésie, je présente la science à la poésie, et vice versa. Mauvais marieur ! Ça crée une tension textuelle très difficile à supporter, car le lecteur est toujours déchiré entre raison et émotion. J’avoue que ça déconcerte ; mais cette approche est essentielle afin de réconcilier ces contraires. À la limite, je vise une synthèse logico-émotionnelle qui se rapprocherait du vertige froid et du sentiment océanique, pour ne pas dire du nirvana.
La hiérarchie cosmique
La présence de loin la plus troublante dans votre recueil est celle des « Maîtres » auxquels est consacré un chapitre. Ils sont ici et là décrits d’une façon qui donne à penser à quelque force extraterrestre. Vous leur prêtez des intentions fort précises à l’égard de l’humanité, dont sa décimation, sauf erreur. D’où vous vient cette conviction ?
R. L. : Le chapitre intitulé « Les Maîtres » est une métaphore. Elle illustre la Surréalité, à l’intérieur de laquelle la Réalité humaine se dilate, s’agite et se contracte. Bref, nous habiterions une Réalité universelle indétectable à nos cinq sens et à notre logique, au même titre que le cerveau des animaux domestiques ne peut pas et ne pourra jamais saisir les tenants et aboutissants des multiples activités humaines. Je postule l’existence de Maîtres dont la finalité inclut la finalité humaine. Malheureusement, elle n’est pas celle dont nous rêvons Hors de la raison humaine, point de salut animal. Hors de la Surréalité, point de salut humain.
Quant à la décimation, j’ai emprunté ce concept au paléontologue Stephen Jay Gould. Il affirme que l’évolution de la vie ne progresse pas selon une diversité croissante, mais par diversification et décimation, c’est-à-dire par élimination aléatoire et gratuite de la plupart des lignées évolutives de même origine. Le sens même de la vie se trouverait alors bouleversé tant dans sa direction que dans sa signification. Gould ajoute que les espèces disparaîtraient ou survivraient pour des raisons multiples et circonstancielles qui ont peu à voir avec la bonne vieille théorie darwinienne de l’adaptation et de la spécialisation. Bref, à ce jeu de la roulette russe, ce ne serait pas nécessairement les meilleurs mais les plus chanceux qui survivraient. Voilà de quoi ramener au sol les orgueilleux, « l’employé du mois » en littérature ou le concept de la « qualité totale ».
Décimations est un ouvrage non seulement poétique mais didactique, puisqu’on y retrouve, entre autres, distribuée dans tout le recueil, une histoire en raccourci de l’humanité, des origines à nos jours. Histoire terrible qui ne laisse présager aucun espoir pour le futur. « L’humanité heureuse » n’aura été qu’une fiction du désir. Est-ce que je simplifie trop ?
R. L. : L’humanité est une poupée gigogne. Elle n’est pas la plus petite, ni la plus grande des espèces. Je ne sais quel ordre elle occupe dans la hiérarchie cosmique, mais j’affirme que nous n’occupons pas le Panthéon. Du moins, pas pour le moment. Et aux croyants, je dis que Dieu n’est pas seul à regarder la Terre. Dans une certaine mesure, je rejoins la pensée de Charles Fort quand il écrit dans Le livre des damnés que « nous sommes la propriété de quelqu’un, nous servons à quelqu’un ou à quelque chose, nous sommes utilisés ». Bien sûr, tout être humain se révolte à la pensée qu’il pourrait un jour être utilisé par une force inconnue qui le manipulerait contre son gré, pour une finalité qui le dépasserait et dépasserait pour ainsi dire son libre arbitre. C’est pourtant ce qui se passe actuellement sur la Terre.
À ce jour, des chercheurs courageux ont catalogué des dizaines de milliers d’observations d’ovnis, des milliers de rencontres du troisième type, des centaines d’enlèvements. Des dizaines de milliers de cas de mutilations animales s’ajoutent également à ce répertoire à la fois fascinant et terrifiant. J’aimerais qu’on arrête de se cacher la tête dans le sable. J’aimerais que nos Rationalistes commencent à étudier sérieusement le phénomène des objets volants non identifiés, et que l’Université y donne son aval. Croyez-moi, c’est une question de vie ou de mort !
Quant au destin de l’humanité, on a évalué la durée de vie moyenne d’une espèce à cinq millions d’années. Je ne sais combien de millions d’années nous portons en nos gènes : deux, trois, cinq Certes, nous sommes le fruit d’un hasard prodigieux et d’une nécessité boiteuse ! Au hasard je rattacherais ici le concept de décimation ; et je rangerais la sexualité et la prédation du côté de la nécessité.
Mais nous avons une infirmité dérangeante : trois cerveaux spécialisés (reptilien, des vieux mammifères, rationnel) qui parfois collaborent, qui surtout s’opposent et se combattent. Si l’espèce humaine s’éteint un jour, que ce soit par accident ou à la suite de l’action décimatoire des Maîtres, nous ne bouleverserions pas grand-chose dans l’ordre – ou le désordre, c’est selon ! – de l’univers. Nous assisterions à l’extinction d’une espèce qui tenta le pari difficile de comprendre le sens de son passage.
Les sites paléontologiques de Burgess (Colombie-Britannique) et de Miguasha (Québec) vous ont beaucoup inspiré : est-ce leur proximité ou leur importance particulière qui ont retenu votre attention ?
R. L. : Leur proximité n’a pas d’importance. Les fossiles des schistes de Burgess et de Miguasha nous enseignent que la vie ne privilégie jamais une forme particulière. Que la prédation et la sexualité pétrissent les formes vivantes dans une succession d’espèces intermédiaires soumises au hasard de la décimation. Encore là, en extrapolant, nous pouvons affirmer que l’espèce humaine est également une espèce intelligente intermédiaire qui obéit aux mêmes lois de la sexualité et de la prédation, auxquelles nous devons ajouter, aujourd’hui, la supra-loi de la décimation.
Le biologiste Jacques Monod a écrit justement un jour que « tout être vivant est aussi un fossile ».
Je et nous
La première partie du recueil Décimations est intitulée « Retour à Miguasha », allusion à un recueil antérieur, Miguasha. Du nous solidaire de l’humanité, on passe au je, aux liens plus intimistes, si on peut dire, avec la préhistoire humaine, la matière, en un point du temps où rien n’est encore joué pour nous. Est-ce que ce nous et ce je ne résument pas les deux ordres de préoccupation de l’œuvre poétique ? Tantôt tournée vers l’humanité, tantôt vers ce qui l’a rendue possible ?
R. L. : L’histoire intime est aussi l’histoire de l’espèce, qu’on en soit ou non conscient. Et comme l’humanité elle-même n’est qu’un point dans l’espace-temps, il y a place pour d’autres rêveries, pour d’autres matières que la seule matière humaine. L’histoire intime est également l’histoire de l’humanité dans la mesure où le je augmente le silence de ses métaphores et de ses interrogations. Dans la mesure où le je passe à l’histoire sans faire d’histoires et qu’il devienne un nous qui ne serait plus « un crime commis en commun » (Freud).
Une question touchant cette fois la réception de votre œuvre. Le dossier substantiel que vous nous avez remis pour faciliter nos recherches montre que vos ouvrages ne sont pas passés inaperçus, dans la petite comme dans la grande presse. Une centaine d’articles et plusieurs études, sans compter les entrevues, ont accompagné votre travail des vingt dernières années. Plusieurs poèmes ont été traduits en anglais et en italien. Bref, le dialogue semble avoir été bon entre l’œuvre et le lecteur, peut-être restreint en nombre – nous sommes en poésie – mais fidèle.
R. L. : J’en suis heureux. Mais je regrette que les poètes accordent trop d’espace et de temps au présent, sans se soucier de préparer les futurs impérissables. Un poète n’est pas un commentateur sportif, tout de même ! Le quotidien, qu’il laisse donc ça aux ramasseurs de crottes de chiens ! Je regrette que les médias consacrent trop d’espace et d’encre à de pauvres grimaceux, à de tristes râleuses, à tous ces farceurs de la nécessité accessoire qui nous chuchotent des histoires cochonnes mal racontées. N’oublions pas le mot de Rimbaud : « L’action n’est pas la vie, mais une façon de gâcher quelque force, un énervement. »
Renaud Longchamps a publié :
Paroles d’ici, à compte d’auteur, 1973 ; L’homme imminent, à compte d’auteur, 1973 ; Anticorps/ Charpente charnelle, l’Aurore, 1974 ; Sur l’aire du lire, Les Herbes rouges No 24, 1975 ; Didactique : une sémiotique de l’espèce, du Corps, 1975 ; Main armée, du Corps, 1976 ; Terres rares, du Corps, 1976 ; Fers moteurs, Les Herbes rouges No 44, 1976 ; Comme d’hasard ouvrable, Cul Q, 1977 ; L’état de matière, Les Herbes rouges No 57, 1978 ; Babelle 1, Après le déluge, VLB, 1981 ; Le désir de la production, VLB, 1981 ; Anticorps, (poèmes 1972-1978), VLB, 1982 ; Miguasha, VLB/Le Castor Astral, 1983 ; Babelle 2, L’escarfé, VLB, 1984 ; Anomalies, La Nouvelle Barre du Jour No 148, 1985 ; Le détail de l’apocalypse, VLB, 1985 ; Babelle 3, Américane, VLB, 1986 ; Légendes/Sommation sur l’histoire, VLB, 1988 ; L’échelle des êtres, VLB, 1990 ; Décimations 1 : la fin des mammifères, Écrits des Forges, 1992 ; Décimations 2 : l’Humanité véloce, Écrits des Forges, 1994 ; Décimations 3 : Ataraxie, Écrits des Forges, 1996.