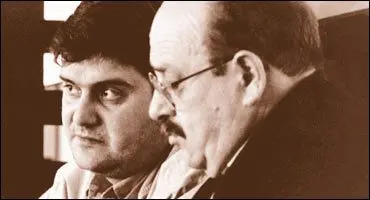L’un est jeune, l’autre moins ; l’un écrit en catalan, l’autre en castillan ; l’un s’intéresse à des lieux abstraits et universels, l’autre arpente et sillonne sa ville comme s’il écrivait autant avec sa plume qu’avec des cartes de ville, des plans de métro, des photos aériennes.
Sergi Pàmies et Manuel Vázquez Montalbán sont copains, tous deux fervents de politique (Pàmies est le fils d’un ancien dirigeant du parti communiste catalan, le PSUC ; Montalbán en est un militant de longue date), et comme ils aiment parler littérature autant que politique, notre entretien s’est déroulé à mi-chemin entre les deux, encore que dans de telles contrées ces distinctions soient parfois bien aléatoires.
Aussi, pour Manuel Vázquez Montalbán, le choix d’écrire en espagnol n’a rien à voir avec la politique. Homme de gauche, il s’est toujours battu pour les travailleurs, pour la justice, et aussi pour le catalan. Mais la bande sonore de l’enfance, c’est en espagnol qu’il l’entend encore. Et si c’est en cette langue qu’il a décidé d’écrire, c’est pour sentir et retrouver ce pays de l’enfance et de la mémoire. Ce n’est donc pas un choix politique, historique, ni même commercial, c’est une décision linguistique et personnelle qui est strictement liée à l’acte de création.
Sergi Pàmies a choisi le catalan simplement parce qu’il est dans la trentaine et que sa bande sonore à lui est catalane. Simple question de moment, dira-t-il, et d’évidence : il vit en catalan, il écrit en catalan. Peu de place au politique ici encore, mais tout de même un désir d’affirmation : Pàmies explique qu’il veut rejoindre l’universel à travers sa propre langue. Il est vrai que ses nouvelles, loufoques et saugrenues, mettent en scène des lieux flous où les seuls repères sont, ici et là, de vagues bars blancs que seul un initié pourrait associer à Barcelone. Mais au-delà du désir d’exprimer l’universel en effaçant toute marque géographique, n’y a-t-il pas aussi l’intention de démontrer que sa langue est aussi universelle ? Comme sont universels, dira Pàmies avec son humour incisif, les téléromans de série B.
De même, quand Pedro Carvalho, le célèbre personnage de la série noire de Montalbán, déambule dans les rues de Barcelone en rêvassant en espagnol, ce n’est pas pour représenter le Barcelone d’aujourd’hui (on y entendrait plutôt du catalan), mais bien pour reproduire le paysage de l’enfance de l’auteur. Cette récupération de la mémoire, dira Montalbán, n’a pu se produire qu’à la fin des années 60, quand le régime de Franco commençait à donner des signes d’épuisement : l’imagination, la fantaisie et, par conséquent, la fiction reprenant leurs droits.
Pàmies qui avait 15 ans à la mort de Franco, ce 20 novembre 1975, n’a pas souffert du bouchon qui avait scellé l’imagination de tout un peuple. En revanche, il a connu l’extraordinaire explosion qui a suivi la chute de la dictature ; cette grande secousse de liberté, d’espoir, de modernité.
L’immédiat sonore
La fin du franquisme, pour Montalbán, c’est l’affirmation d’une culture, et l’aboutissement d’un long et douloureux parcours ; pour un Sergi Pàmies, c’est d’abord la fête, la folie, la vie immédiate. On comprend pourquoi, quand il se met à écrire, il s’arrête aux images qui l’entourent, tant sonores que visuelles, réelles ou légèrement trafiquées. La fiction devient un outil merveilleux lui permettant de s’approcher du monde à la façon d’un félin, en quête non plus d’une mémoire mais des éléments qui lui permettront de se construire une mémoire à son goût. L’intérêt n’est plus de reproduire le passé, mais d’interpréter les charges symboliques qui accompagnent les images et les sons de la ville (la publicité, les voix, la musique, etc.). Le lien avec la réalité perd son importance, seule la charge symbolique compte (pas besoin de connaître Hawaï ou Bombay pour reconnaître et ressentir la célèbre chanson du groupe rock madrilène Mecano, Hawaï – Bombay).
« La proposition imaginaire, magique, qui vient du son d’un lieu, d’un nom ou d’une chose est cela même qui te permet de te créer une mémoire, explique Pàmies. Le son a pris aujourd’hui une telle importance qu’il peut te faire aimer ou non un endroit, un être, un objet, sans même le connaître. Ce qu’évoque Gilles Pellerin, dans sa nouvelle ’S’il fallait qu’elle se taise’ : ‘[…] des choses comme prendre l’autre dans ses bras et prononcer son nom en ré mineur ‘juste à ce moment-là, tout s’écroule : Yolande’. Ou encore la recréation que nous ferions de Samarkand, de ses mille minarets, de ses folles histoires d’amour, de ses sombres intrigues dans les palais ; peu importe que Samarkand soit aujourd’hui une ville affreuse, et que son histoire ait ou non déjà existé, l’effet est là : la sonorité fonctionne, une mémoire est en train de se créer. »
Exotisme et réalité
« La ville, explique Montalbán, est un territoire d’occultation du mythe. » Barcelone, dans sa série de Pedro Carvalho, est un matériau narratif, sans plus. Un autre personnage. L’exotisme, quant à lui, procède autrement. Une réalité n’est toujours exotique que pour un étranger à cette réalité ; et encore, seulement s’il refuse de s’y intégrer. Mais peut naître par la suite un autre exotisme, qu’il conviendrait peut-être d’appeler évocation : une réalité lointaine et irréelle que seuls un son, une impression rendent perceptible à un étranger.
Montalbán parle ici de décalage de l’information. « Auparavant, dit-il, si l’on voulait parler de Samarkand, il fallait y être allé. Aujourd’hui, c’est inutile : les médias nous saturent d’information sur toutes les villes et tous les mythes du monde. » L’intérêt, en fiction, n’est donc pas de reproduire une réalité préexistante, mais bien de construire une nouvelle mémoire. L’exotisme n’est sans doute plus que ce refus touristique de s’intégrer à un lieu réel, car dès lors que le lieu est inconnu, l’exotisme d’antan n’existe plus, seule l’évocation joue, nous habite et nous permet de créer de nouveaux mythes. Quand Pàmies, dans sa nouvelle judicieusement intitulée « Mémoire », raconte : « Sans y être allé, j’ai connu Pékin, Lisbonne, Adelaïde », c’est justement de mythe sonore qu’il s’agit, et d’une façon qui semble vouloir appeler la fin d’un certain exotisme. Et quand il écrit, dans « L’âme de la rascasse » : « Il observe tout en pensant qu’il est lui aussi un spectateur de toute cette mise en scène, à la différence près qu’il en est aussi un des protagonistes », ne pourrions-nous déceler, dans ce désir d’intégration au paysage, un autre appel à la fin de ce certain exotisme ?
Mais que faire quand on n’a plus la foi ?
L’exotisme mort, la culture retrouvée pour ne pas dire récupérée, les grandes causes et le nationalisme en chute libre, que reste-t-il si la quête de l’universel ne suffit plus ? Montalbán ne quitte pas le PSUC pour ne pas donner ce plaisir à ceux qui voudraient tant le voir abandonner le communisme et renier son passé. Mais lui-même a perdu la foi, il ne milite plus, il écrit et se limite à croire à son écriture et, envers et contre tout, sans formule ni moyen désormais, à la justice. Pour Pàmies, la politique n’est intéressante aujourd’hui qu’au niveau municipal. « Maires de tous les pays, unissez-vous ! », lance-t-il, goguenard. Et s’il est vrai qu’en Amérique latine, la politique et le métier d’écrivain continuent de faire bon ménage, en Europe, en Amérique, il est bien difficile d’imaginer un Mario Vargas Llosa, un Octavio Paz, un Ernesto Sabato. Que reste-t-il, alors, des vieux rêves de changer le monde ? « Il nous reste encore à lutter contre le nouvel ordre mondial », d’affirmer Montalbán.
Or s’il semble que seule la littérature offre encore quelques armes, il faut convenir qu’elles sont bien fragiles. Car que la ville soit peinte avec le détail d’une carte géographique ou limitée à quelques bars blancs, après tout, quelle importance ? Mais qu’à cela ne tienne ! c’est au moins la marque de ce qui reste quand même la foi disparaît : la liberté. Sans compter le plaisir : celui, manifeste, que représente la fiction pour des auteurs comme Sergi Pàmies et Manuel Vázquez Montalbán ; celui, intime et précieux, de leurs lecteurs.
Sergi Pàmies a publié :
Aux confins du fricandeau, Jacqueline Chambon, 1988 et Serpent à plumes, 1994 ; Infection, Jacqueline Chambon, 1989 ; L’instinct, Jacqueline Chambon, 1993 ; La première pierre, Jacqueline Chambon, 1995.
Manuel Vázquez Montalbán a publié, entre autres :
Meurtre au comité central, Seuil, 1982, « Points », Seuil, 1987, 10/18, 1991 ; Les oiseaux de Bangkok, Seuil, 1987, 10/18, 1991 ; Le pianiste, Seuil, 1988, « Points », Seuil, 1990 ; Recettes immorales, Le Mascaret, 1988, 1993 ; Les mers du sud, 10/18, 1988 ; La rose d’Alexandrie, Christian Bourgois, 1988, 10/18, 1990 ; Les thermes, Christian Bourgois, 1989, 10/18, 1991 ; La joyeuse bande d’Atzavara, Seuil, 1989, « Points », Seuil, 1991 ; Hors jeu, Bourgois, 1991, 10/18, 1992 ; Histoires de politique, Bourgois, 1990 ; Tatouage, Bourgois, 1990, 10/18, 1992 ; Ménage à quatre, Seuil, 1990, « Points », Seuil, 1992 ; Happy end, Complexe, 1990 ; Le tueur des abattoirs, Seuil, 1991 ; Paul Gauguin, Flohic, 1991 ; Histoires de famille, Christian Bourgois, 1992 ; Galindez, Seuil, 1992 ; Histoires de fantômes, Christian Bourgois, 1993 ; J‘ai tué Kennedy ou les mémoires d’un garde du corps, Christian Bourgois, 1994 ; Manifeste subnormal, Christian Bourgois, 1994 ; Assassinat à Prado del Rey et autres histoires sordides, Christian Bourgois, 1994 ; Sabotage olympique, Christian Bourgois, 1995 ; Saga maure, Marval, 1995 ; Trois histoires d’amour, Christian Bourgois, 1995 ; Aperçus de la planète des singes, Seuil, 1995 ; La gourmandise, Discours de Robinson sur la morue, Textuel, 1995 ; L’étrangleur, Seuil, 1996 ; Les travaux et les jours, Actes Sud, 1996 ; Les recettes de Pepe Carvalho, Christian Bourgois, 1996 ; Au souvenir de Dardé, Christian Bourgois, 1996.