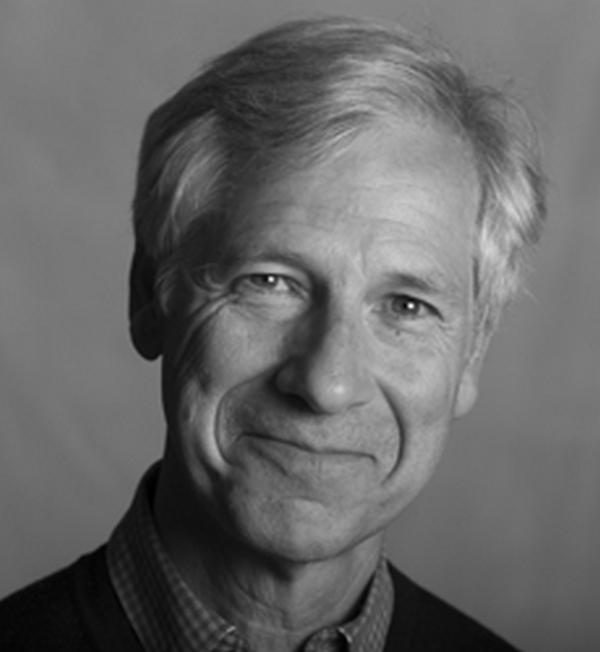Nous avions rendez-vous non pas au café du Commerce, où se déroulent plusieurs de ses nouvelles, mais à celui du Château Frontenac où se tenait la vingt-deuxième Rencontre québécoise internationale des écrivains1 à laquelle Annie Saumont participait pour la seconde fois. Un sac de la Fnac2 entre les mains, comme un signe de reconnaissance qui ne s’en voulait pas un, Annie Saumont attendait dans l’entrée.
Si elle paraît fragile au premier abord, l’engouement et la passion qu’elle voue manifestement à la nouvelle ont vite fait de chasser cette impression première. Il n’y a qu’à la voir, qu’à l’entendre lire l’une de ses nouvelles en public. Elle attaque le début d’un texte comme un coureur le départ d’une course, car elle sait qu’un lecteur se gagne – ou se perd – dès la première phrase. Et, comme en faisait foi le silence qui planait sur la salle le soir où elle a lu un inédit, comme en témoignent également les nombreux prix que son œuvre lui a valus jusqu’à ce jour, dont le Prix Renaissance de la nouvelle 1994 pour Les voilà quel bonheur et le Goncourt de la nouvelle en 1981 pour son recueil Quelquefois dans les cérémonies, Annie Saumont est de ces écrivains qui savent gagner leurs paris. Là où j’avais cru percevoir une certaine fragilité, il n’y avait qu’une grande modestie.
La venue d’Annie Saumont au Québec coïncidait avec la deuxième édition de son recueil de nouvelles, Si on les tuait, dans lequel l’acuité du regard, doublé par moments d’un humour, d’une ironie à peine feinte, continuent de caractériser une démarche où l’équilibre entre émotion et construction narrative est toujours maintenu. Un recueil où le lecteur retrouvera les thèmes chers à Annie Saumont : l’incommunicabilité, l’enfance, la violence larvée de nos sociétés dites modernes ou, pour reprendre le constat que fait l’un de ses personnages, « […] un monde à être paumé sans savoir vers qui se tourner ».
« J’ai toujours eu envie d’écrire des nouvelles », dira d’emblée Annie Saumont. « Ça correspond à ma façon de concevoir l’écriture. » Bien qu’elle ait publié trois romans, ce que je lui rappelle pour comparer son travail de romancière et de nouvelliste, Annie Saumont s’empressera d’affirmer ne pas être du tout romancière. Ses romans répondaient avant tout à une exigence d’éditeur qui ne voulait pas publier un recueil de nouvelles comme première publication d’un auteur. Des romans aujourd’hui épuisés ou introuvables, ce dont elle ne se plaint pas. « Je ne suis pas du tout fière de ces premiers romans, m’avouera simplement Annie Saumont sans chercher pour autant à les renier, mais j’ai l’excuse d’avoir été obligée de le faire pour arriver à être publiée. » Sinon, elle n’en a toujours eu que pour la nouvelle, pour ce genre qu’elle dit être assez particulier, qui demande qu’on n’explique rien, que tout au plus on fasse voir.
Très liées à la réalité des années 1980 et 1990, les nouvelles d’Annie Saumont mettent souvent en scène des personnages qui se débattent avec leurs souvenirs. Sans s’être transformés en véritables cauchemars, leurs rêves se sont effrités et l’image qu’ils projettent est celle de gens qui ont raté ou qui sont en train de rater leur vie. Qu’il s’agisse de relations de couples, de relations parents-enfants, de la condition des immigrants en France ou de gens que la vie a simplement moins gâtés, le regard d’Annie Saumont révèle presque toujours une brisure, un moment de rupture d’équilibre, un point de non-retour où tout bascule pour les personnages, sans qu’ils comprennent vraiment ce qu’il leur arrive. Annie Saumont avoue être davantage intéressée par les gens qui ont une certaine difficulté d’être, qui ne savent pas s’exprimer, par les paumés quoi. « De quoi parler d’autre ? nous demandera-t-elle à son tour. Si on ne parle pas de la douleur, je ne vois pas de quoi on peut parler. Raconter le bonheur, ça n’a pas beaucoup d’intérêt. » Quant aux autres, les gens normaux, Annie Saumont avoue ne pas pouvoir en dire grand-chose de toute façon. Elle est simplement heureuse qu’ils soient si bizarres.
Dégraisser, encore et toujours
Annie Saumont insiste sur le fait qu’elle ne cherche pas à expliquer les choses ni à répondre à d’inutiles pourquoi, encore moins à être la porte-parole des déshérités. Elle tend plutôt à lever le voile sur ce qui nous est caché, à révéler ce qui se dissimule derrière les apparences. En cela, le regard qu’elle porte sur le monde se veut avant tout révélateur, à la manière du photographe qui nous livre ses images sans justification autre que l’image elle-même. Ce qui ne l’empêche pas d’avoir recours, tout comme le photographe, à toutes les subtilités de ton, de contraste, d’angles de prise de vue, de vitesse qui s’offrent à elle. « J’essaie de rester en dehors des choses, dira Annie Saumont, de faire voir sans montrer, de mettre le lecteur dans une position où il voit lui-même ce que j’ai envie qu’il voit, mais sans rien expliquer, sans essayer de livrer de messages. Il n’est pas question de donner d’explications, tout au plus doit-on donner des éléments, des repères. C’est au lecteur de remplir les blancs. Chez les nouvellistes, nous avons cette expression qui rend bien l’art de la nouvelle : tu n’as pas assez dégraissé. Il faut toujours veiller à retirer tout ce qui est inutile, à en dire le moins possible, en s’assurant tout de même de dire l’essentiel pour que le lecteur ne soit pas perdu. C’est un équilibre difficile à établir, dire plus avec moins, mais au fond la nouvelle c’est ça. »
Cette économie de moyens à laquelle Annie Saumont fait allusion repose sur une grande maîtrise de l’écriture autant que sur un sens aguerri du rythme que doit avoir une nouvelle. Elle relit d’ailleurs ses textes à voix haute pour mieux les sentir, déceler les failles, corriger les faiblesses. Pour elle, comme elle le répétera à plusieurs reprises au cours de notre entretien, tout l’art de la nouvelle consiste à ne pas en dire trop et son travail vise toujours à davantage de concision. « Je travaille énormément mes textes, je les reprends pendant des jours et des jours et parfois même après que le livre a été publié. Je note les choses qui auraient pu être affinées davantage. » N’y a-t-il pas risque de trop corriger ? Certains textes à la forme moins achevée vibrent davantage que d’autres qui me sont apparus plus figés. Annie Saumont admet que le risque est réel, qu’il y a un moment où on abîme peut-être le texte. « Mais, ajoute-t-elle aussitôt comme pour s’excuser, c’est parfois difficile de s’arrêter. Le plus souvent j’hésite, je me dis que tel passage aurait pu être mieux dit, que tel mot aurait été préférable. Il m’arrive tout de même à l’occasion de relire un texte et de me dire que je ne peux vraiment rien y changer, mais c’est assez rare. »
Le monde par tous les bouts
D’un recueil à l’autre, les lecteurs d’Annie Saumont baignent dans un univers que prolonge la parution de chaque nouveau recueil. Même si l’on retrouve le même type de personnage, elle renouvelle constamment les points de vue narratifs tout en conservant un ton et un rythme qui lui sont très personnels. Il n’y a pas de nette démarcation entre deux recueils, si ce n’est que chacun forme un tout cohérent, un ensemble de textes qui, chacun à sa façon, témoignent de l’univers fictionnel de l’auteure. « J’essaie de varier la façon de rendre les choses. Je cherche à prendre le monde un petit peu par tous les bouts. Il y a forcément quelque chose qui demeure à la fin. Ça doit être ça le style, une espèce de permanence qui se retrouve dans ce qu’on écrit. »
C’est avant tout cette permanence, cette constance dans le ton, la forme et le rythme que recherche Annie Saumont. Lorsque je lui fais remarquer qu’il n’y a pas de nette démarcation d’un recueil à l’autre, que tel texte aurait pu tout aussi bien figurer dans tel livre plutôt que dans tel autre, elle acquiesce volontiers : « Au départ, je n’ai pas de projet de recueil, mais j’écris des nouvelles. Et puis, de temps à autre l’éditeur me demande : – Alors, ce recueil, quand vient-il ? – J’essaie alors de composer le livre, parce qu’il y a tout de même des nouvelles qui ne doivent pas se retrouver l’une à côté de l’autre. À ce moment-là, j’organise l’ensemble et, éventuellement, j’écris une ou deux nouvelles qui me semblent nécessaires pour équilibrer le recueil. Mais, au départ, il ne s’agit pas vraiment d’un projet de recueil, je rassemble plutôt mes nouvelles quand je pense en avoir suffisamment, en laissant de côté celles qui ne s’intègrent pas bien à l’ensemble. J’espère seulement que l’unité du livre vient du fait que c’est moi qui l’ai écrit. »
Annie Saumont n’en a pas moins signé un recueil thématique au sens propre du terme, Moi les enfants j’aime pas tellement. Elle avoue l’avoir fait en grande partie parce qu’elle en avait assez de s’entendre dire justement : « Ah ! Annie Saumont, elle parle toujours des enfants. » « J’ai protesté un peu parce que dans mes autres livres je ne parle pas que des enfants, je parle tout aussi bien des adultes, même si l’enfance, elle vous colle à la peau. Puisque je suis cataloguée, m’étais-je alors dit, je vais écrire un livre où tous les personnages seront des enfants, enfin presque parce qu’il y a tout de même des personnages adultes qui tournent autour. »
Le thème de l’enfance, avec ses illusions et ses premières désillusions, sa naïveté mais aussi sa perspicacité, sa franchise parfois désarmante, n’en demeure pas moins un thème récurrent chez Annie Saumont, thème qu’elle traite avec une grande sensibilité sans jamais verser dans le sentimentalisme.
Au bord du fantastique
Annie Saumont n’aime pas écrire de façon linéaire et classique. Dans certaines nouvelles, elle n’hésite pas à déployer différents points de vue narratifs qui se fondent les uns aux autres et provoquent ainsi un effet de prisme qui restitue une tout autre image de la réalité, souvent plus absurde, plus insoutenable et, n’était de l’humour, certaines nouvelles nous feraient l’effet d’un véritable coup de poing. « L’humour permet d’enlever un peu de poids aux choses souvent assez horribles que je raconte. Et puis ça donne une certaine tonicité à l’histoire parce que je ne tiens pas non plus à écrire des histoires désespérées. Il y a de l’humour dans la vie, ça compte beaucoup vous savez. »
La plupart des dialogues sont également fondus au texte, ce qui accentue l’effet d’amalgame qui concourt à briser la linéarité des récits et à suggérer une autre façon de voir le monde. Lorsque je m’étonne qu’on l’ait déjà comparée à Eudora Welty, l’une des grandes nouvellistes américaines à qui rebutent les contours flous, chez qui l’approche narrative est davantage classique, explicite et descriptive, Annie Saumont avoue se sentir davantage près d’un écrivain comme Julio Cortázar, qu’il est en fait son nouvelliste de référence. Ainsi, même si la plupart de ses nouvelles sont campées dans un univers très réaliste, même si on ne peut à proprement parler la ranger dans la catégorie des écrivains fantastiques, ni même avec ceux qui pratiquent ce que l’on a appelé le réalisme magique, Annie Saumont n’en revendique pas moins une place qui lui est propre. « Il est vrai qu’on ne peut caractériser mon écriture de fantastique, mais j’insuffle parfois un peu de fantastique dans le quotidien. Parce qu’il y a des moments, des choses dans la vie quotidienne qui ont un caractère particulier et qui permettent une espèce de tremblement au bord du fantastique, entre le fantastique et le réel. » Mais, contrairement à Cortázar qui traverse de l’autre côté du miroir, Annie Saumont demeure de ce côté-ci des choses. Par choix ? « Vous savez, me répond-elle aussitôt, on ne choisit pas vraiment. On est plutôt choisi par ce qu’on écrit, par ses personnages, par son histoire. Il n’y a pas de choix prémédité, enfin pas pour moi. Il n’y a pas de décision arrêtée au départ, du genre : – Voilà ce que je veux écrire –. On est plutôt entraîné par son écriture sans trop savoir où l’on va et ce n’est qu’après, une fois que l’histoire est écrite, qu’on se dit : – Ah oui, voilà ce que j’ai voulu faire. – C’est assez fascinant de se laisser aller et de se dire : – On va voir où ça va nous mener –, même si quelquefois ça ne mène nulle part. »
1. Cette entrevue était d’abord parue dans en 1994 dans le numéro 58 de Nuit blanche.
2. Fédération nationale d’achats des cadres. Grand magasin où l’on vend des disques et des livres.
Annie Saumont a publié :
Marcher dans les déserts, Calmann-Lévy, 1963 ; Jouer de l’harmonica, Mercure de France, 1968 ; La vie à l’endroit, Mercure de France, 1969 ; Dis, blanche colombe, Belfond, 1976 ; Enseigne pour une école de monstres, « Blanche », Gallimard, 1977 ; Dieu regarde et se tait, « Blanche », Gallimard, 1979 ; Quelquefois dans les cérémonies, Prix Goncourt de la nouvelle 1981, « Blanche », Gallimard, 1981 ; Marc et la plante d’Afrique, avec Franck Saumont, « Feu follet », Messidor, 1982 ; Une île sur papier blanc, avec Franck Saumont, « Folio benjamin », Gallimard, 1984 ; Si on les tuait ?, Luneau Ascot, 1984 et Julliard, 1994 ; Il n’y a pas de musique des sphères, Luneau Ascot, 1985 ; La terre est à nous, Prix de la nouvelle de la ville du Mans 1988, Ramsay, 1987 ; Je suis pas un camion, Grand Prix de la nouvelle de la Société des Gens de Lettres, Seghers, 1989 ; Triolet No 2, Nouvelles nouvelles, 1989 ; Moi les enfants j’aime pas tellement, « Libre court », Syros-Alternatives, 1990 ; Le pont, la rivière, L’Élémentaire », Métailié, 1990 ; Quelque chose de la vie, « Mots », Seghers, 1991 ; Les voilà, quel bonheur !, Prix Renaissance de la nouvelle 1994, Julliard, 1993 et Pocket, 1996 ; Le lait est un liquide blanc, Julliard, 1995 ; Après, Julliard, 1996 ; « La plus belle histoire du monde », nouvelle inédite, Nuit blanche, no 66, printemps 1997.
À jour printemps 1997.