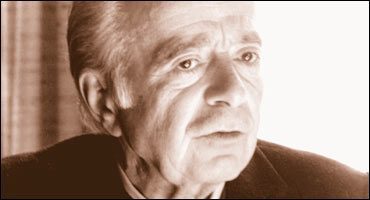L’œuvre du romancier et nouvelliste Antonis Samarakis, né à Athènes en 1919, jouit d’une estime internationale, ce que sont venus confirmer le Grand Prix littéraire de Bruxelles (1972) pour l’ensemble de son œuvre, le Grand Prix de la littérature policière (1970) pour son roman La faille (déjà primé en Grèce en 1966 par le Groupe des Douzes – l’équivalent du Goncourt) et des traductions en 30 langues.
Antonis Samarakis, actif en littérature depuis plus de quarante ans (son premier recueil de nouvelles, On demande un espoir, date de 1954), a fait partie de la Résistance pendant la Guerre, a déjà été condamné à mort (ce à quoi il avait échappé par une tumultueuse évasion) puis privé de son passeport par la junte au pouvoir de 1967 à 1974.
Nuit blanche : Pourquoi écrivez-vous ?
Antonis Samarakis : Je ne sais pas, écrire est un travail concret qui me donne du plaisir, indépendamment du résultat. Ce qui m’intéresse avant tout c’est de jeter dans la mer un message, une possibilité de communication avec un autre. Je n’appartiens pas à ce genre d’écrivains pour qui l’écriture est un besoin impératif.
Quel est le destinataire de ce message jeté dans la mer ?
A. S. : J’écris pour tout le monde. La communication entre l’écrivain et le lecteur inconnu se fait à un niveau quasi érotique : la lecture est un peu comme l’amour, on aime ou on n’aime pas. Lorsqu’il existe certains points communs qui te lient au lecteur, qui font que ton texte entre en coïncidence avec l’esprit et l’âme de l’autre, il se construit un pont – et je paraphrase le titre d’un livre d’un de nos poètes : en écrivant je m’adresse à des amis d’une autre sorte de plaisir. La littérature est un des derniers îlots du dialogue spontané, chaleureux et désintéressé avec l’autre, dans ce monde, c’est pourquoi je suis préoccupé par la solitude de l’homme contemporain, son aliénation, son incertitude. Mes héros sont des gens simples dans un quotidien angoissant devant la fragilité de la paix, devant la famine, le chômage, la pauvreté. Je relate leur oppression par des pouvoirs politiques, religieux, militaires et idéologiques. Je veux démasquer le totalitarisme de notre époque.
Un univers policier
Vous avez souvent recours à une intrigue de type policier. Est-ce une question de style ou une façon d’attirer l’intérêt d’un plus grand nombre de lecteurs ?
A. S. : Il ne s’agit ni de l’une ni de l’autre : je crois tout simplement que nous vivons dans un univers policier. Autrefois certains pays pouvaient être qualifiés d’États policiers, maintenant c’est le monde entier qui mérite l’étiquette avec sa violence, ses pouvoirs totalitaires, sa course aux armements sous le couvert du secret.
Quel est le rôle de l’écrivain dans ce contexte plutôt noir ?
A. S. : À condition d’exprimer pleinement et fidèlement le chaos de notre monde, la littérature, comme toute autre forme d’art, offre une certaine issue de secours à l’homme traqué d’aujourd’hui. L’écrivain a une responsabilité de témoin. Il sait qu’il se joue une sale farce dans le dos des gens. Il a le devoir de contester, de dénoncer, d’appeler à la révolte. Ceux qui ne peuvent pas parler, constater, se faire entendre, comptent sur la voix de l’écrivain, son initiative, son support actif. Dans sa conversation avec l’autre, l’écrivain tente, par la suggestion et l’émotion, de l’aider à formuler clairement ses interrogations et ses inquiétudes tout en lui insufflant espoir et esprit combatif dans la quête d’une vie meilleure. Cette insertion s’opère lentement mais profondément. L’Histoire rapporte plusieurs exemples de l’action souterraine de la littérature et de ses conséquences dans les révolutions, la destruction des préjugés et des idoles et la prise de conscience de leur exploitation par des milliers d’humains.
Le policier, le politique
Quels thèmes ont privilégiés les écrivains grecs ?
A. S. : Les thèmes de la prose contemporaine – tout comme sa forme – sont plus synthétiques que dans le passé. Ils sont le reflet des moments cruciaux que nous sommes en train de vivre. Par sa nature même et grâce à la gamme de possibilités d’expression qu’elle possède, la prose est en mesure de repérer les profonds changements qui s’accomplissent non seulement en Grèce mais dans le monde entier. La prose ne peut pas fonctionner indépendamment de la réalité comme elle est en train de se former. Il n’existe pas, à notre époque, de points étanches. Car, il y a eu, dirais-je, la constitution spontanée d’une communauté universelle de douleur, d’angoisse, de combat et d’espoir et notre prose veut précisément exprimer cette universalité. L’écrivain a eu de tout temps une telle responsabilité, mais nous sommes aux prises avec un univers technocratique, nous voyons la menace nucléaire peser sur les simples joies humaines, la tranquillité de l’âme, la passion de la création. Comment l’écrivain grec ne s’inspirerait-il pas de tout cela, de la confusion idéologique, de la crise des institutions et des valeurs, de cette vague de violence aux limites prévisibles ?
Comment voyez-vous la Grèce contemporaine ?
A. S. : Elle a comme toujours ses problèmes mais, en même temps, elle a réussi à accomplir beaucoup de choses. La jeune génération me donne beaucoup d’espoir : elle mène un combat socialement et économiquement dur, mais elle a su échapper à l’hypocrisie et à la rhétorique du passé. Elle constitue la majorité des lecteurs, une majorité attentive à la création culturelle.
Quelles relations la politique et la littérature entretiennent-elles en Grèce ?
A. S. : L’écrivain a le droit d’avoir sa propre idéologie. Le domaine dans lequel il travaille demeure ouvert à tous les points de vue, à tous les vents. Il y a des écrivains qui s’inspirent du vent transportant un parfum de rose, du son envoûtant de la vague au bord de la mer, des souvenirs de moments de bonheur personnel. C’est leur droit. Mais il y en a d’autres qui sont ébranlés, secoués par d’autres vents, dont le cri déchirant dans la nuit de notre monde répand la senteur dégoûtante du sang versé de millions d’êtres humains, les plaintes d’innombrables victimes désespérées de notre planète. Ces écrivains ne peuvent pas se taire, parce qu’autrement, ils seraient coupables de haute trahison, envers eux-mêmes d’abord, et, ensuite, envers la douleur profonde, infligée quotidiennement au corps de l’humanité. Nous vivons des temps ombrageux. Nous soupçonnons tout, et toute forme de rapport avec le politique nous rend méfiants. Nous transposons ainsi le problème et nous ne parlons plus que de la littérature qui « fait de la politique » ! George Orwell s’est exprimé très clairement sur la question quand il a dit, dans Pourquoi j’écris : « Le point de vue selon lequel l’art n’aurait aucun rapport avec la politique est aussi une attitude politique. »
Qu’est-ce que la liberté pour vous ?
A. S. : Il ne manque pas de mots pour parler de liberté, ce qui manque c’est la liberté même. Qui sauvera la liberté de ses sauveurs ? Qui la sauvera de ses exécuteurs ? La littérature qui parle de liberté est saturée. J’ose cependant ajouter que la liberté existe quand vous me demandez ouvertement de vous en parler et que moi je peux vous répondre, sans peur.
Aucun titre d’Antonis Samarakis n’apparaît présentement aux catalogues des éditeurs de langue française, pas même La faille, publié en 1970 chez Stock et repris pendant longtemps par le Livre de poche (no 3517).