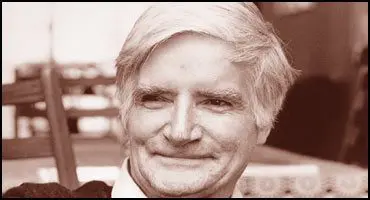Les souvenirs que j’ai de la Faculté des Lettres de l’Université de Montréal ont peu à voir au fond avec les cours que j’ai suivis. Si j’ai gardé mémoire de certains professeurs d’histoire, j’ai bien conscience d’avoir été tout compte fait un mauvais étudiant. Distrait, occupé que j’étais à travailler manuellement pour régler les frais d’inscription, je ne songeais qu’au jour où certificat en main je deviendrais professeur de littérature dans une maison d’enseignement.
Je n’oublierai jamais toutefois les conversations que j’ai eues lors d’interminables déambulations dans les corridors presque déserts de l’université avec un ami qui deviendrait plus tard écrivain. Claude Mathieu était mon aîné de trois ans. À l’âge que j’avais alors, cette différence paraissait énorme. De plus, Claude avait une culture que je n’avais pas, semblait avoir tout lu. Pendant les cours de littérature et de langue latine, il donnait l’impression de nager dans une culture qui à moi préfigurait l’ennui.
Nous parlions des livres que nous écririons, d’autres que nous lisions ou que nous lirions. Claude écrirait sur les poètes français de la Renaissance et songeait déjà à un essai sur Anacréon et les anacréontiques. Avec Richard Pérusse et Jacques Brault, il avait publié un tout petit livre intitulé Trinôme. On m’avait demandé de me joindre au trio, j’avais refusé. Sagement. Je ne me sentais pas prêt. D’ailleurs, si j’y pense bien, je ne me suis jamais senti prêt. J’ai plongé tout simplement. Je ne l’ai pas toujours regretté.
Je me souviens aussi d’un roman que j’ai acheté en ces temps-là et que je n’ai jamais lu. De James Joyce, je connaissais déjà Dedalus et Gens de Dublin. Certaines nouvelles de ce dernier ouvrage m’étaient proches. Je les avais découvertes à l’heure du déjeuner dans la cave de l’épicerie où je travaillais. J’avais vingt ans, j’avais la vie devant moi. Après m’être plongé dans l’univers joycien, je retrouvais mon quotidien qui, à distance, ne me paraît pas si détestable. Restait Ulysse. Introduit en France par Valery Larbaud, que j’admirais, ce livre me fascinait et me faisait peur tout à la fois. Sa démesure finissait même par me terrifier.
Et je ne parle pas uniquement de sa facture, des galeries souterraines qui le traversent, mais aussi des témoignages d’admiration qu’il a suscités. Je me sentais convié malgré moi à une fête pour laquelle je n’étais pas préparé.
Je possède toujours l’exemplaire Gallimard jauni que je m’étais procuré alors. À six ou sept reprises tout au long des années qui ont suivi, j’ai tenté de vaincre mes atermoiements. Au mieux, j’ai atteint la page cent. La plupart du temps, je me suis arrêté à la vingtième.
Des raisons, je m’en suis trouvées. L’impression était trop serrée, le papier avait jauni, le bouquin était trop lourd. N’importe quoi. Tout m’était bon pour justifier ma flemmardise.
Je sais maintenant que je ne lirai jamais Ulysse. Je ne prétends pas que ce livre n’est pas fait pour moi, qu’on a surfait son importance, qu’on l’a depuis longtemps dépassé en audace. Je dis tout simplement qu’il est probable que mes goûts en littérature me porteront ailleurs dans les années qu’il me reste à vivre.
De même ai-je réussi à me consoler de ne jamais avoir lu au complet La recherche du temps perdu ni le théâtre de Shakespeare.
Je crois qu’il serait sot de ma part de noter trop lourdement ces insuffisances, ces carences alors que ce que j’appellerais « ma culture », si j’étais encore plus suffisant que je ne le suis, comporte tellement de trous qu’ils occupent tout l’espace.
Je n’ai jamais cessé de lire. À peu près jamais les romans que me proposait l’air du temps. J’ai très tôt eu horreur des best-sellers, de ces livres qu’il faut avoir lus pour être renseignés ou pour le paraître.
Petit à petit, j’ai épousé cette volonté d’indépendance au point de ne plus m’engager que dans des œuvres qui me parlaient directement. J’ai recherché – et je recherche – les auteurs qui ont par rapport à l’écriture et à la vie des approches qui me sont intimes. Les idées, je m’en suis méfié très tôt, acceptant qu’un écrivain dont je ne partageais pas les avis en politique par exemple soit pour moi un phare en ce qui a trait à l’écriture. Ainsi ai-je été et suis-je encore lecteur assidu d’un Jacques Chardonne dont l’attitude pendant l’Occupation nazie en France me révulse.
De même ai-je trouvé mon miel dans la fréquentation d’écrivains dits mineurs dont le discours me convenait mieux que les phrase ampoulées de tel grand prosateur au style trop drapé.
Maintenant que j’approche de la septantaine, je sais que je n’ai qu’effleuré la magie du verbe. Des chef-d’œuvres incontestables me seront à jamais interdits parce que j’ai été distrait, parce que le temps m’a manqué, parce que je n’ai pas osé en temps opportun.
Mais il n’est pas question que je le déplore trop ardemment. Je suis trop porté à m’étonner de ce que moi, enfant du peuple, aie eu la chance de déroger du sort qui aurait pu être le mien, celui de la parfaite ignorance du monde des livres. Aux malheurs que j’ai ressentis j’ai pu trouver une explication (jamais valable, mais qui sécurisait tout de même). J’ai su qu’à travers les âges les hommes avaient expérimenté des tourments semblables aux miens et surtout qu’ils en avaient fait des livres dont la consultation et la fréquentation m’étaient un baume essentiel.
Après tout, c’est porté par ces devanciers que je me suis mis à écrire. Décision qui n’a eu d’importance que pour moi. Je suis le premier à l’admettre.
C’est un peu pour cette manie de l’écriture qui me facilite parfois l’horreur de vivre que je ne déplore pas trop ne pas avoir lu Ulysse. La raison au fond tient peut-être de ce que j’ai craint que cette symphonie ne nuise au petit air de flûte dont je me sens capable parfois.