C’est à l’automne 2012, lors d’une soirée de lectures organisée par le Département d’études françaises de l’Université de Moncton, que j’ai découvert la poésie de Jonathan Roy. Il était encore étudiant à la maîtrise et son premier recueil venait de paraître.
La carrière de celui qui dirige maintenant le Festival acadien de poésie a depuis pris son envol. En plus d’avoir publié son deuxième livre en 2019 et reçu de multiples prix et distinctions, il a participé à divers projets individuels ou collectifs, que ce soit en littérature, en arts visuels, en chanson ou en cinéma.
Au printemps 2022, j’assistais à un événement monté autour de l’ouvrage collectif En cas d’incendie, prière de ne pas sauver ce livre1, présenté dans le cadre du Festival Frye de Moncton. En tant que coauteur, Jonathan lisait sur la scène. À la fin de la représentation, je me suis entretenu avec lui et j’en ai profité pour lui confier à quel point j’avais toujours été impressionné par sa capacité à livrer ses textes, par son rythme, par son flow, par sa manière de s’investir physiquement dans sa poésie. Quelques semaines plus tard, j’ai eu envie de poursuivre notre conversation. En voici le résultat.
Louis-Martin Savard : Jusqu’à quel point accordes-tu de l’importance à la dimension « performance scénique » en poésie ?
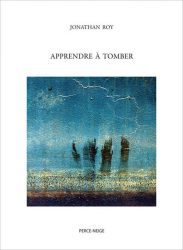 Jonathan Roy : J’y en accorde beaucoup, autant qu’au texte dans le fond. En fait, de plus en en plus, je constate le pouvoir de dissémination d’une bonne performance sur scène, surtout quand le public est constitué à la fois de néophytes et d’habitués de la littérature. J’ai l’impression que cette posture me vient de mon travail comme organisateur de festival. C’est un autre moyen par lequel le texte atteint le public, différent de la lecture dans un recueil. Et comme mon contact avec la poésie s’est fait rapidement par la scène, c’est devenu une chose avec laquelle j’ai vite voulu être à l’aise pour faire honneur au texte que j’allais porter, pour faire honneur au public qui était là, lui qui ne vient pas juste entendre des mots s’enchaînant, mais qui vient aussi les entendre incarnés par le souffle, par la vocalité du poète. Pour moi, la professionnalisation en littérature, c’est aussi ça. Pendant une représentation, il m’importe de donner tout ce que j’ai pour que le texte transcende les mots sur la page. Et probablement que ça influence ma façon d’écrire. Depuis deux ans, je travaille de la façon suivante : j’écris un texte, ensuite je l’enregistre pour m’entendre le dire – je le teste, en fait –, surtout quand je sais qu’il sera assurément destiné à être porté devant public. Forcément, ça oriente les sonorités, le rythme et les coupures des vers. Cette conscience de la scène a donc des implications esthétiques. Cela dit, il m’importe tout autant que le texte seul, quand il est soumis à l’exercice de la lecture, se tienne, et même que des sens supplémentaires s’en dégagent.
Jonathan Roy : J’y en accorde beaucoup, autant qu’au texte dans le fond. En fait, de plus en en plus, je constate le pouvoir de dissémination d’une bonne performance sur scène, surtout quand le public est constitué à la fois de néophytes et d’habitués de la littérature. J’ai l’impression que cette posture me vient de mon travail comme organisateur de festival. C’est un autre moyen par lequel le texte atteint le public, différent de la lecture dans un recueil. Et comme mon contact avec la poésie s’est fait rapidement par la scène, c’est devenu une chose avec laquelle j’ai vite voulu être à l’aise pour faire honneur au texte que j’allais porter, pour faire honneur au public qui était là, lui qui ne vient pas juste entendre des mots s’enchaînant, mais qui vient aussi les entendre incarnés par le souffle, par la vocalité du poète. Pour moi, la professionnalisation en littérature, c’est aussi ça. Pendant une représentation, il m’importe de donner tout ce que j’ai pour que le texte transcende les mots sur la page. Et probablement que ça influence ma façon d’écrire. Depuis deux ans, je travaille de la façon suivante : j’écris un texte, ensuite je l’enregistre pour m’entendre le dire – je le teste, en fait –, surtout quand je sais qu’il sera assurément destiné à être porté devant public. Forcément, ça oriente les sonorités, le rythme et les coupures des vers. Cette conscience de la scène a donc des implications esthétiques. Cela dit, il m’importe tout autant que le texte seul, quand il est soumis à l’exercice de la lecture, se tienne, et même que des sens supplémentaires s’en dégagent.
« ça en fait de la vidange quand même / des road trips dans le vraimonde »
Savèches à fragmentation, p. 93.
L.-M. S. : À la suite de ta participation au spectacle Manifeste scalène en compagnie des poètes Sébastien Bérubé et Gabriel Robichaud, tu as présenté une seconde version, dans Savèches à fragmentation, du poème « Voix rurale » initialement paru dans ton premier recueil. J’imagine qu’il y a un lien entre le fait d’avoir lu ce texte devant un public et la volonté d’en faire publier une nouvelle version.

R. : Oui et non. En fait, « Voix rurale » a été le dernier poème composé pour Apprendre à tomber, qui réunit des textes de 2006-2007 à 2011. Il a été écrit au printemps 2012, donc peu de temps avant d’envoyer ce qui allait devenir les dernières versions du manuscrit. Il a été publié comme un texte complet, mais qui, je crois, faisait partie d’un nouveau cycle d’écriture. En 2013, j’ai été invité au Mois de la Poésie, à Montréal, pour une lecture. J’étais alors naïvement porté par l’idée un peu romantique que j’allais représenter l’Acadie et que je devais arriver avec un texte engagé, sinon engageant pour le public, et par l’idée qu’il me fallait impressionner, que je débarquais en ville pour faire mes preuves. Depuis un moment, je notais dans mon cellulaire des vers qui auraient pu faire partie de « Voix rurale ». Je devais alors faire cinq minutes avec un texte qui n’en faisait que trois… J’ai donc rajouté des vers, et c’est là que j’ai constaté que c’était une espèce de poème remodelable à l’infini, que sa structure permettait ce remodelage, par certains motifs qui revenaient, certains mouvements fixés. Car oui, avec sa trame, son canevas, il reste un peu un poème jamais fini.
En ce qui concerne le Manifeste scalène, il faut revenir à une soirée du Festival acadien de poésie, à Caraquet, où Sébastien Bérubé a livré « Hymne2 », un texte qui traite de ruralité à l’intérieur d’une structure basée sur la répétition ; cela ajouté au fait que je venais d’entendre Gabriel Robichaud lire son « Manifeste diasporeux3 » qui est construit selon le même modèle. À ce moment-là, je me suis dit : « C’est bizarre que nous soyons trois jeunes auteurs de la même génération qui ont créé ces trois textes adoptant une forme plutôt similaire tout en parlant de façon complémentaire de l’Acadie ». C’est ainsi que nous en sommes venus à monter Manifeste scalène. Puis, quand est venu le temps de préparer Savèches, je trouvais intéressant de ramener ce poème en « version 2.0 », assumant qu’une version avait été publiée, oui, mais qu’il y en aurait peut-être d’autres.
« Sous un soleil de plomb la beauté / s’est jetée dans les bras / de la fenêtre »
Apprendre à tomber, p. 36.
L.-M. S. : Beaucoup de jeunes poètes publient au rythme relativement rapide d’environ un livre tous les deux ans. Ce n’est pas ton cas. Comment expliques-tu ta « lenteur » ?
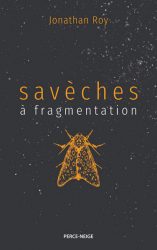 R. : J’aimerais publier plus rapidement. (Rires.) Je l’attribue, cette lenteur, à la diversité de mes pratiques, au fait que mon temps est divisé entre la création et la direction d’un festival [Festival acadien de poésie]. Ainsi, lorsque je suis dans un état d’esprit, j’ai de la misère à en sortir. J’ai travaillé récemment sur différents projets : une anthologie [à paraître], la direction littéraire dans une collection, chez Perce-Neige ; en création, il y a eu l’expérience du spectacle de Savèches. J’ai également des projets d’écriture qui passent par les arts visuels, j’ai un peu touché le vidéopoème, la performance. Pour moi, ce sont toutes des choses qui m’intéressent véritablement, qui sont imbriquées les unes dans les autres et qui font que toutes mes explorations évoluent simultanément. Quand je travaille sur un recueil, j’avance davantage à pas de loup, de façon concentrique vers l’objectif. Au bout du compte, tous ces projets sur lesquels je travaille en même temps finissent par se contaminer et par atteindre une cohérence, je crois.
R. : J’aimerais publier plus rapidement. (Rires.) Je l’attribue, cette lenteur, à la diversité de mes pratiques, au fait que mon temps est divisé entre la création et la direction d’un festival [Festival acadien de poésie]. Ainsi, lorsque je suis dans un état d’esprit, j’ai de la misère à en sortir. J’ai travaillé récemment sur différents projets : une anthologie [à paraître], la direction littéraire dans une collection, chez Perce-Neige ; en création, il y a eu l’expérience du spectacle de Savèches. J’ai également des projets d’écriture qui passent par les arts visuels, j’ai un peu touché le vidéopoème, la performance. Pour moi, ce sont toutes des choses qui m’intéressent véritablement, qui sont imbriquées les unes dans les autres et qui font que toutes mes explorations évoluent simultanément. Quand je travaille sur un recueil, j’avance davantage à pas de loup, de façon concentrique vers l’objectif. Au bout du compte, tous ces projets sur lesquels je travaille en même temps finissent par se contaminer et par atteindre une cohérence, je crois.
« La métaphore est une perdrix / qu’il faut abattre à bout portant »
Savèches à fragmentation, p. 59.
L.-M. S. : Quel est ton rapport à l’image poétique, à la métaphore ?
R. : Quand j’écris, je recherche l’image qui surprend au détour, qui enrichit le texte et qui s’enrichit d’elle-même, c’est-à-dire une image qui peut à la fois jouer sur la langue, le rythme, qui se nourrit elle-même de ses multiples sens. Je trouve que c’est dans les métaphores qu’on finit peut-être par dire le monde le plus honnêtement, parce que, pour moi, les métaphores existent comme des vérités profondes et senties, au-delà des vérités concrètes. En fait, je pense que c’est par là que passe la littérature, du moins la conception que j’en ai. Et ça ne veut pas dire utiliser des mots compliqués. Il y a tout un lexique acadien contemporain, moderne ou rural ; des mots courants, que j’utilise, mais qui n’ont pas encore accédé à la littérature malgré un potentiel de métaphore, de figure tout aussi fort que les « grands mots de la langue française » et qui rendent possibles de nouveaux amalgames d’images. Et c’est là où je trouve mon plaisir : découvrir la perle, trouver une image tellement engageante qu’elle te fait plonger dans un texte au complet, et que les quelques mots qui la composent parviennent à résumer une réalité entière.
L.-M. S. : Serais-tu en mesure de me décrire le recueil que tu n’as pas encore publié, mais dont tu fantasmes parfois les grandes lignes et les contours, ce recueil qui éventuellement deviendrait ton chef-d’œuvre ?

R. : Je ne le sais pas… Ça se module d’une fois à l’autre… Ce que je sais, par contre, c’est que je n’ai pas l’ambition de devenir un auteur de renommée internationale. Ce que je veux faire, c’est parler en même temps aux gens de la littérature et aux gens qui ne lisent pas. Je pense avoir réussi à le faire avec Savèches et j’espère continuer dans ce sens. J’essaie de dire la complexité du monde, vue par mon prisme. J’essaie d’avoir une rythmique, une richesse d’images en trouvant la parfaite balance entre une langue aussi complexe que riche et des référents parfois rares ou obscurs, cela conjugué à une langue hyperréaliste qui provient de l’oralité, de celle de chez nous, de gens que je côtoie au quotidien. Ainsi, et pour revenir à ta question initiale, je pense que je voudrais écrire une œuvre littéraire qui serait à la fois humaniste et très proche de la réalité acadienne, cela sans tomber dans les clichés. En fait, je suis surtout curieux de ce qui m’attend, du point de vue littéraire, dans dix ans, parce que j’ai l’impression que je n’aurai pas les mêmes ambitions ni les mêmes préoccupations.
L.-M. S. : Tu as écrit quelques chansons pour l’auteur-compositeur Cédric Vieno. Tu as même enregistré une performance (« Chemin Lavigne »), que j’ai écoutée dernièrement. As-tu déjà songé à pousser cela davantage ? Je parle évidemment de la musique et de la chanson.
R. : Oui, j’y pense souvent. Les collaborations avec Cédric Vieno ont été très ponctuelles. La chanson « Rose45 », par exemple, est issue d’une commande autour d’un projet qui n’a jamais abouti. Pour l’instant, j’ai surtout travaillé avec des amis qui faisaient de la chanson. C’est le cas des Hôtesses d’Hilaire, avec qui j’ai coécrit quelques « tounes » ou agi en tant que tierce plume. Ce sont des expériences que j’aime. Savoir que ce n’est pas moi qui les porterai me donne une certaine liberté. Le rapport à la chanson est vraiment différent, en raison de la contrainte métrique qui ne fait pas partie de mon écriture habituellement. C’est autant un défi que quelque chose de libérateur – comme toute contrainte, j’imagine. Cela dit, j’ai de la misère à m’y mettre. Peut-être parce que je n’ai pas tout à fait l’oreille musicale. « Chemin Lavigne », c’est autre chose. Cédric m’avait demandé si je voulais écouter son album Maltempête5 en primeur, pour lui composer une espèce de poème-bio qui lui servirait dans la promo de l’album. Finalement, le texte que je lui ai soumis « fittait » sur une pièce instrumentale qui s’intitulait « Chemin Lavigne ». On avait alors nos ateliers de travail côte à côte et, un après-midi, je suis allé l’enregistrer avec lui. Donc, à ce jour, mon rapport à la chanson est très spontané, dans le sens qu’il est né d’amitiés, de relations préexistantes, parfois même carrément de hasards. Récemment, par contre, avec des amis, j’ai commencé à travailler pour le plaisir à un podcast et, dans le contexte de ce balado (Podcass poclair), nous nous lançons le défi d’utiliser nos discussions pour générer des créations, des poèmes, des « tounes ». Ce procédé complètement libre fait en sorte que j’ai commencé à écrire, en utilisant un dictaphone, des chansons un peu improvisées. C’est en marge de ma pratique de la littérature, mais ça m’ouvre de nouvelles façons de travailler. L’écriture de chansons pourrait donc éventuellement prendre plus de place, si le contexte l’appelle.
« je suis le seul mot / d’une phrase qui s’endort / tu me liras demain »
Apprendre à tomber, p. 80.
L.-M. S. : Et si je terminais l’entretien en évitant de te poser une question directement liée à l’Acadie. Ça te choquerait ?
(Rires.) Non, pas du tout ! En fait, je pense que le simple fait d’écrire en Acadie suffit. Et pour en revenir à ta question concernant mon recueil idéal, disons que celui-ci serait hyper-acadien, mais sans nécessairement nommer l’Acadie. En fin de compte, je suis un adulte semi-jeune qui vit au XXIe siècle et qui a des préoccupations qui sont beaucoup plus vastes que le coin de pays où j’habite… Mais bon, je pense que tu posais la question juste pour la blague… Mais oui, évitons de parler de l’Acadie encore une fois.
Jonathan Roy a publié :
Apprendre à tomber, Perce-Neige, Moncton, 2012, 84 p. ; 17,95 $.
Savèches à fragmentation, Perce-Neige, Moncton, 2019, 130 p. ; 20 $.
* Louis-Martin Savard, originaire du Lac-Saint-Jean, vit en Acadie depuis près de quinze ans où il enseigne le français à l’Université de Moncton. Il a publié des nouvelles et des textes poétiques dans les revues Exit, Virages et Zinc. Son premier recueil, Le char de mon père, est paru à l’automne 2021 chez Perce-Neige. Depuis 2022, il codirige la collection « Prose » chez le même éditeur.
1. Catherine Voyer-Léger (sous la dir. de), En cas d’incendie, prière de ne pas sauver ce livre, Prise de parole, Sudbury, 2021, 98 p. ; 12 $.
2. Sébastien Bérubé, Là où les chemins de terre finissent, Perce-Neige, Moncton, 2017, 61 p. ; 15 $.
3. Gabriel Robichaud, Acadie Road, Perce-Neige, Moncton, 2018, 165 p. ; 20 $.
4. Cédric Vieno, Maquiller l’âne, 2014.
5. Cédric Vieno, Maltempête, 2020.











