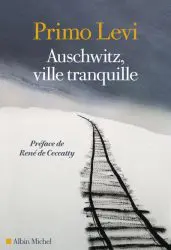Dans Les naufragés et les rescapés, son dernier livre, Primo Levi rappelle un fait de la plus haute importance pour appréhender, si tant est que faire se peut, la Shoah. Des deux côtés, celui des victimes et celui des oppresseurs, souligne-t-il avec force, il y avait une conscience vive de l’énormité de ce qui se passait dans les Lager1.
On dit souvent que la réalité dépasse la fiction et que celle-ci est un mensonge qui dit la vérité. Primo Levi, le chimiste littéraire, va si loin dans sa fiction que, en comparaison, les témoignages des Jorge Semprún, Imre Kertész, Charlotte Delbo ou Robert Antelme semblent presque se mieux tolérer. Ainsi, en lisant le « Papillon angélique », la deuxième nouvelle de Auschwitz, ville tranquille2, recueil qui en compte dix encadrées de deux poèmes, la stupeur nous gagne. Armé de son esprit scientifique, l’écrivain, docteur en chimie, explore divers phénomènes, ceux de la cryogénisation ou de l’eugénisme qui taisent leur nom, ceux de la suppression de la douleur par des drogues ou de la mise en esclavage d’une jeune femme par un prédateur sexuel. Chacun de ces phénomènes évoque l’enfer des Lager.
Celui qui croyait que la réalité des réseaux humains dans les camps n’était pas simple – d’une part les victimes, de l’autre, eux, les tortionnaires – use d’une large gamme de nuances pour incarner l’ambiguïté de la légendaire zone grise des Lager qu’il s’est employé à autopsier dans son œuvre. Le prisonnier-fonctionnaire (le kapo), version troublante du collaborateur, est mis en fiction dans le texte d’une ironie grinçante « Le roi des Juifs ». Fort du principe paradoxal que la douleur est la gardienne de la vie et que le plaisir est son but, il convertit dans « Versamine » la souffrance en plaisir par une expérimentation pseudoscientifique qui ramène à celles abjectes des nazis. Ses flirts avec le fantastique s’approchant de la science-fiction, comme dans « La belle endormie dans le frigo », ne sont pas dépourvus d’humour, malgré la pire cruauté.
Les distinctions fines auxquelles il s’oblige n’empêchent nullement Primo Levi d’être formel : c’est une maladie mentale ou une coquetterie esthétique, ou encore un signe de complicité, que de confondre victimes et assassins. La préface du recueil et une postface suivie de la nomenclature de la parution de chacun des textes, entre 1959 et 1986, offrent des clés qui déverrouillent, en partie tout au moins, la complexité littéraire de l’écrivain juif italien.
Symbole du grand collapsus moral du XXe siècle, Auschwitz engloutissait 10 000 vies chaque jour. Primo Levi n’aura de cesse d’interroger les trois espèces humaines qui s’y côtoyaient, les tortionnaires, leurs collaborateurs, les victimes, et de témoigner de ce voyage « vers en-bas ». Même s’il estime que c’est chose quasi impossible, dans son recueil de nouvelles il emprunte des voies multiples pour arpenter un même sujet : l’inhumanité aussi bien que l’humanité des labyrinthiques Lager, ce monde de dégradation, d’exactions, de perdition créé de la main de l’homme. À l’instar de son amie proche Edith Bruck, il croit qu’un déporté ne parle jamais en son nom propre, et il recourt à plusieurs formes littéraires, la poésie, le conte, le fantastique pour tenter d’incarner l’inique, l’indicible œuvre du diable.
À la fin de la guerre, l’horreur n’arrive pas à trouver les mots pour la dire. Cette impossibilité de dire et de décrire la réalité des camps se heurte au refus d’écouter, car, devant la désolation semée partout, personne ne veut ou ne peut plus affronter ces horreurs. Plusieurs témoins qui avaient regagné leur chez-soi ont été reçus comme des pestiférés. Dans Les naufragés et les rescapés, Primo Levi écrit : « Dans la majorité des cas l’heure de la libération n’a été ni joyeuse ni insouciante ». Pour cette raison précise, la résistante communiste Charlotte Delbo attendra vingt ans avant de publier son œuvre3.
En janvier 1945, les bombardements annonçaient l’arrivée des Russes. Devant leur chute imminente, les nazis ordonnent la marche d’évacuation d’Auschwitz vers d’autres camps pour effacer les traces des atrocités commises hors de l’Allemagne. Cette marche de la mort engouffrera plusieurs dizaines de milliers de déplacés dont Alberto, l’ami et complice de Primo Levi. De ce deuil, il ne s’est peut-être jamais remis, car, dans son expérience des camps, l’amitié était une denrée rarissime.
Son décès, survenu le 11 avril 1987, à Turin, demeure énigmatique. Suicide ? D’aucuns déclarent : impossible. Il avait ses projets. D’autres, plus nombreux, récusent la thèse de la mort accidentelle. Edith Bruck, poète, exprime son désarroi : « Notre devoir est / de vivre et jamais de mourir ! / Pourquoi Primo ? »
1. Lager est le terme générique allemand qui regroupe une trentaine de dénominations de camps – du camp de travail au camp d’extermination, du camp de femmes au camp de transit – qui ont vu le jour sous le national-socialisme.
2. Primo Levi, Auschwitz, ville tranquille, Albin Michel, Paris, 2022, 199 p. ; 29,95 $.
3. Charlotte Delbo, Auschwitz et après (trois tomes dont le premier et le plus connu est intitulé Aucun de nous ne reviendra). En 2013, l’écrivain Jean Hatzfeld estime dans le quotidien Le Monde que cette œuvre est « d’une beauté littéraire à couper le souffle ».