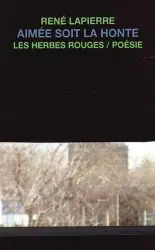L’œuvre remarquable de René Lapierre montre, depuis une trentaine d’années, un intérêt soutenu pour la question de la communauté, qui se traduit notamment par une mise en question du seuil de négociation entre l’espace intime et l’espace réel partagé. Celle-ci est récemment devenue plus explicite, en se saisissant de l’expérience du sujet migrant et en se situant, avec Traité de physique (2008), en régime soviétique. L’apparition d’une énonciation au nous, venant abstraire et sonder, à une profondeur philosophique, les enjeux s’adressant aux personnages, signalait une tentative de redéfinir la collectivité à partir de la rupture avec l’origine et l’espace social, sur une logique de l’intersubjectivité.
La transposition de cette tentative en sol québécois, avec Aimée soit la honte, est saisissante. Elle prend la forme d’un dialogue intensif avec le lecteur, par lequel s’effectue une recherche active et inquiète de lieux communs, sans acquis du côté de la mémoire collective. La réalité politique et sociale apparaît étrangère, totalitaire, répondant à une raison extrinsèque qui détermine une forme d’exil intérieur : «Ce que nous sommes, ce que nous savons nous est retiré. Nous apprenons des lois inhumaines.» (p. 19) Lapierre entreprend de revaloriser la honte, parle dans l’orbite de cette émotion déconcertante qui lui semble garante de notre capacité de distanciation et lui laisse entrevoir la possibilité d’un rapport autonome, intuitif à la morale et à l’identité. Il montre aussi en elle le domaine du privé, du caché, la part d’invisible qui absente les sujets et que les œuvres et la parole s’emploient à relier, de l’une à l’autre: «D’où parlons-nous, à quoi nos voix touchent-elles? Que font-elles dans le désordre, dans les chambres des mots?» (p.67) Se dessine ainsi une figure de l’espace intérieur, qui permet à l’écrivain d’imaginer et de s’associer à une communauté de réfugiés, en un pays pourtant chaque fois singulier, tapissé des voix qui nous ont atteints, reconnus. Mosaïque de temps et de lieux, comme en témoigne le réseau de références intertextuelles que tisse de livre en livre une œuvre, qui, dans un paradoxe apparent, tend à susciter une prise de conscience collective en rendant caduque l’idée même de singularité culturelle.